Edmond About, romancier et journaliste, séjourna à Istanbul en 1883. Dans un des textes de son livre "De Pontoise à Stamboul", il évoque l'atmosphère de la Ville, son histoire, ses monuments, les stanbouliotes, la "vraie" ville et celle que fantasment les occidentaux.
Edmond About (1828-1885), romancier (Le Roi des Montagnes en 1857, L'homme à l'oreille cassée en 1862 etc) fut aussi un grand journaliste au Moniteur, au Figaro et à l'Opinion nationale.
Il participa, en octobre 1883, en compagnie de personnalités, à l'inauguration de l'Orient Express qui les amena à Varna ; de là, il alla jusqu'à Istanbul en bateau et visita la ville du 4 au 16 octobre. C'est ce récit qui parut dans "De Pontoise à Stamboul". Nous ne reproduisons ici que la partie de l'ouvrage consacrée à Istanbul.
Nous avons ajouté des intertitres et les transcriptions des noms propres en Turc moderne.
Edmond About, De Pontoise à Stamboul, Hachette, 1884
In-12, 286 pages
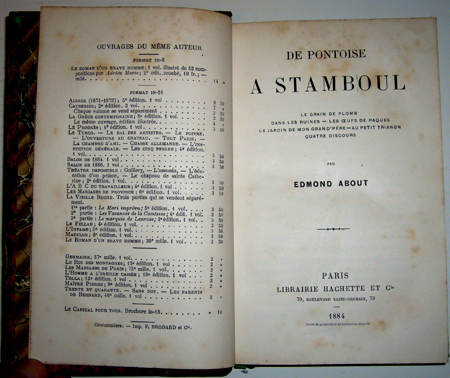
[Arrivée à Istanbul]
En effet, nous étions à l'entrée du Bosphore. La prudence du gouvernement turc en interdit l'accès même aux bâtiments de commerce depuis le crépuscule jusqu'au lever du soleil. Mais le soleil s'était levé avant moi, les formalités de police et de santé étaient remplies ; déjà notre aimable Missak-Effendi s'était fait débarquer sur la côte de Thrace, où sa famille l'attendait pour quatre jours après quatre ans d'absence. Déjà nous avions embarqué le drogman et un conseiller de la légation belge, ainsi que M. Weil, inspecteur général des agences de la Compagnie Nagelmackers. Ce jeune Français, décoré comme officier en 1871, s'était chargé obligeamment de préparer notre séjour, d'organiser nos promenades, d'obtenir les firmans, de faire les logements à l'hôtel. Et il s'était acquitté de sa tâche avec tant de zèle et d'esprit, que nous n'eûmes, pour ainsi dire, qu'à nous laisser vivre, car les spectacles et les plaisirs vinrent spontanément à nous, sans nous donner le temps de désirer la moindre chose.
[Le Bosphore]
Nous trouvons maintenant que l'Espero [le bateau qui transporte l'auteur] marche trop vite : ce ne serait pas trop d'une demi-journée pour détailler les deux panoramas qui se déroulent simultanément sous nos yeux. Ce profond et rapide canal d'eau presque douce, qui emporte à la mer de Marmara le large tribut du Danube, du Don, du Dniester, du Dnieper et des cinq ou six autres fleuves de la mer Noire, tient une place énorme dans l'histoire du genre humain. Il a eu pour marraine une maîtresse de Jupiter, la belle Europe, qui le traversa à cheval ou, pour parler correctement, à taureau, sur la croupe du maître des dieux. Que d'autres aventures depuis celle-là, jusqu'à la fanfaronnade de lord Byron nageant vers la tour de Léandre ! Ici, l'histoire est aussi merveilleuse que la légende : rappelez-vous le passage de Darius, le pont de bateaux de Xerxès, la mer fouettée de verges par ce grand fou qui tomba amoureux d'un platane et lui donna plus de bijoux que jamais financier n'en promit à une danseuse de l'Opéra. Les barbares, les demi-barbares et les civilisés, les païens et les chrétiens, les orthodoxes, les schismatiques, les musulmans, se sont donné rendez-vous dans ce champ clos pendant plus de deux mille ans pour disputer l'empire du monde. Et tout n'est pas fini, puisque Constantinople est le centre autour duquel gravite depuis un siècle au moins la politique européenne.
[La Ville]
Quoique la ville ne compte pas, selon toute apparence, un million d'habitants, elle s'étend par ses faubourgs depuis l'entrée de la mer Noire jusqu'à la mer de Marmara, sur toute la rive d'Europe, sans parler de Scutari et de cette banlieue asiatique qui va de Béicos [Beykoz] à Kadikeui [Kadiköy]. Il est vrai d'ajouter que les magnificences de ces bords enchantés sont presque toutes en façade. Les palais, les villas, les kiosques, s'étalent à nos yeux comme un décor de théâtre derrière lequel on ne trouve souvent que des montagnes et des ravins. Des bâtiments de grande apparence ne sont que des chalets peints en pierre, comme l'ambassade de France à Thérapia. Le sultan qui en fit largesse à Napoléon n'avait certes pas lésiné sur la dépense ; mais l'humidité du détroit est si pénétrante en hiver qu'elle démolirait les murailles les plus solides ; les cloisons lui résistent mieux. Cependant le bois peint se désagrège avec le temps. Nous remarquons beaucoup d'habitations en ruines que l'on ne songe pas à réparer, soit que le propriétaire ait éprouvé des revers de fortune, soit qu'il ait eu la fantaisie de porter ses pénates ailleurs. Les lieux communs qui se débitent encore de temps en temps sur les Turcs campés en Europe prennent ici une apparence de vérité. Les Arméniens, les Grecs, les Francs, les Turcs surtout, lorsqu'ils étaient maîtres de l'Orient, ont fait ici, pour leur plaisir ou pour leur vanité, des dépenses incalculables. Un seul kiosque, construit sur la rive d'Asie et offert au sultan par Méhémet-Ali, a coûté six millions de francs ; il est abandonné depuis longtemps et tombe en ruines. Le khédive Ismaïl-Pacha s'est fait bâtir ici une résidence royale, entourée de jardins comme on n'en voit que dans les Mille et une Nuits ou dans le service de M. Alphand à Paris ; l'ancien sultan Mourad est confiné à Tchéragan [Çıragan], dans un palais immense, et l'empereur régnant Abd-ul-Hamid logerait aisément dix mille hommes derrière les façades marmoréennes et les énormes grilles dorées de Dolma-Bagtché [Dolmabaçe]. Eh bien, faut-il vous l'avouer ? ce que j'ai aperçu de plus beau sur la rive d'Europe, c'est un ouvrage militaire du xve siècle, Rouméli-Hissar [Rumeli Hisarı], élevé par Mahomet II.
Un jeune passager arménien qui a appris le français à Constantinople, et qui par conséquent le parle bien, nous a fait les honneurs du Bosphore depuis Bujukdéré [Büyükdere] jusqu'à Top-Hané. Nous avons mesuré en passant la profondeur du canal, grâce à un paquebot des Messageries françaises, la Provence, qui a été coulé à pic et qui élève hors de l'eau juste la pointe de son grand mât. L'Espero stoppe, les embarcations nous abordent, les interprètes nous envahissent ; il ne nous reste plus qu'à descendre, mais nous ne sommes pas pressés, car ce qu'il y a de plus beau dans cette ville, je le sais par expérience, c'est le premier coup d'oeil, le profil des collines, la découpure des dômes et des minarets sur le ciel, la couleur chaude et variée des édifices petits et grands, le va-et-vient des navires et des calques sur le Bosphore et dans la Corne d'Or, la merveilleuse diversité des types et des costumes. Le voyageur assez heureux ou assez courageux pour s'en tenir à la première impression, s'extasier franchement un quart d'heure et retourner chez lui sans demander son reste, ne ferait pas un mauvais calcul. Mais la Mouche du Lloyd qu'on a mise obligeamment à notre service est déjà lestée des bagages. Éveillons-nous d'un trop beau rêve ; allons perdre nos illusions.
[Tophane]
Grâce à la qualité officielle de M. Olin, qui doit nous attirer des faveurs de toute sorte, nous débarquons à la grille de Top-Hané, qui est la fonderie impériale des canons. Huit ou dix landaus de grande remise, à cochers galonnés, nous attendent avec les interprètes sur le siège ; nos bagages suivront sur le dos des hammals ou portefaix turcs, qui sont les plus honnêtes gens du monde. Et nous voilà galopant en file indienne sur le pavé capricieux et dans la boue gluante de Galata, le long des boucheries, des cafés, des gargotes, des épiceries ou baccals [bakkal] dont la seule odeur fournirait douze chapitres à M. Zola, des boutiques de fruitiers admirables où resplendissent l'or des raisins, le corail des piments, la pourpre des tomates, le grenat des jujubes, l'améthyste épiscopale des aubergines. Je me sens rajeunir de trente ans aux cris de la rue, en entendant brailler un gamin grec qui vend des radis rouges : « hokkina rapanakia ! » et un jeune Turc qui colporte presque aussi bruyamment le lait caillé ou yaourt. Nous sommes arrêtés un moment par la rencontre de quatre Turcs superbes qui portent, suspendu à des arceaux de bois, un tonneau presque aussi monumental et aussi lourd que le foudre de Heidelberg. Les mendiants profitent de l'occasion pour s'abattre sur nous. Toujours les mêmes, ces gaillards-là ! J'ai bien cru en reconnaître un ; ce serait pourtant grand miracle si en trente ans il n'avait pas vieilli. Les chiens pullulent toujours dans les rues, et ils sont plus laids, plus crottés, plus galeux et plus bruyants que jamais. Mais voici du nouveau, de l'inconnu, de l'inédit. Devinez quoi ? Je vous le donne en mille : un tramway, mais un tramway assurément comme vous n'en avez pas vu : les rails posés sur une rampe de sept centimètres par mètre, une vieille voiture qui doit avoir été dans son temps diligence en Auvergne ou coucou dans quelque banlieue, deux chevaux qui descendent la montagne au grand galop, et un saïs qui dégringole plus vite encore, car son métier consiste à précéder la voiture et à repousser les passants qui voudraient se faire écraser. Je dois dire que toutes les lignes ne sont pas également vertigineuses et qu'on y voit rouler par-ci par-là du matériel presque neuf. Les fiacres sont encore assez rares, faute de rues suffisamment carrossables, et les chevaux de selle à la disposition du public stationnent comme autrefois dans les carrefours, chaque animal flanqué de son propriétaire, qui suit à pied le cavalier au galop et le devance quelquefois. Peu ou point de charrettes en ville, mais force caravanes de baudets, de chevaux de bât et même de chameaux chargés de briques, de pierres, de planches et autres matériaux de construction. Car on bâtit beaucoup de maisons neuves à Péra, et même de fort belles, au milieu des baraques de bois qui s'effondrent et des ruines qu'on abandonne à leur destin. Quelques masures d'autrefois, les plus vieilles et les plus déjetées, ont conservé l'aspect mystérieux des habitations turques: mais ce sont de très rares exceptions, de même que les maisons chrétiennes à Stamboul : la population de la ville tend à se cantonner de plus en plus par affinités électives, selon les cultes et les nationalités.
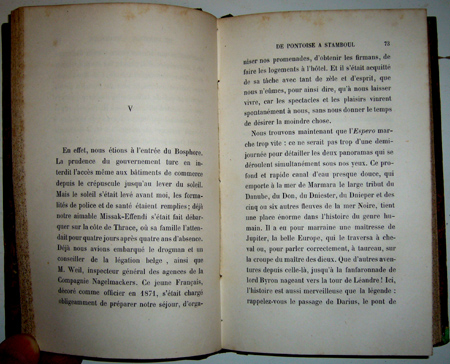
[A Péra]
L'hôtel du Luxembourg, appelé aussi Grand Hôtel, qui doit nous héberger presque tous, est établi en bonne place et en bon air dans la grande rue de Péra. C'est une vaste maison presque neuve et très propre, bâtie économiquement par des spéculateurs qui en tirent un bon loyer. Notre hôtelier, M. Flament-Belon, est un Français actif et intelligent qui a passé sa vie en Orient, fait et défait plusieurs fois sa fortune et honorablement élevé une famille de sept enfants. Hélas ! l'aubergiste français est un type qui tend à disparaître. Il sera bientôt remplacé, même en France, par une espèce de diplomate allemand qui porte la cravate blanche et les mains sales et dont la politesse, insolente et rapace, fait tourner le lait dans les tasses et aigrit le vin dans les bouteilles. Les braves gens qui ont hébergé ma jeunesse voyageuse nous logeaient moins confortablement, à coup sûr, ne nous alimentaient peut-être pas beaucoup mieux et ne nous donnaient pas pour rien ce qu'on vend très cher aujourd'hui ; mais leur visage nous servait, dès l'arrivée, un plat de bonne mine. Ils avaient une façon de souhaiter la bienvenue qui disait : Vous êtes chez vous. Ils reconnaissaient un client au bout de dix années et lui demandaient des nouvelles de sa famille. S'ils vous voyaient pour la première fois, ils s'excusaient, ou peu s'en faut, de ne pas vous connaître encore et vous posaient assez de questions pour vous connaître à fond dans un instant. Bref, on était chez eux un peu moins qu'un ami, mais beaucoup plus qu'un numéro, et, la note acquittée, on ne dérogeait pas en les remerciant des attentions qu'ils vous avaient données par-dessus le marché. Voilà ce qu'on ne rencontre plus guère à Cauterets, à Nice ou à Trouvilie ; voilà ce que nous avons trouvé avec un peu de surprise et beaucoup de plaisir chez ces bonnes gens du Grand Hôtel de Péra. Ils avaient fait l'impossible pour nous loger convenablement aux deux premiers étages de la maison, et les voyageurs arrivés avant nous les y avaient aidés avec une bonne grâce vraiment rare : par exemple, j'ai su que ma chambre avait été cédée obligeamment par le jeune prince Grégoire Soutzo, fils de l'ancien ministre des affaires étrangères, Athénien de naissance, Roumain par naturalisation et licencié es lettres de la Faculté de Paris. Après une heure d'ablutions qui m'eût semblé délicieuse si l'eau de Constantinople était moins sale, un déjeuner passable réunit à la table d'hôte toute la bande joyeuse des wagons-lits ; puis, sans perdre un moment, dociles et disciplinés comme les clients anglais de l'agence Cook, nous nous mettons en devoir d'épuiser l'ordre du jour tel que M. Weil l'a rédigé.
[Le palais de Dolmabaçe]
Notre guide est un aide de camp du sultan, le général Ahmed, qui a terminé ses études à Paris non pas, comme on pourrait le croire, à l'École d'état-major, mais dans l'atelier de Gérome. II était peintre, et même assez bon peintre pour que Courbet lui demandât un de ses paysages et que le jury du Salon lui décernât une mention honorable. C'est que la spécialité ne sévit pas aussi despotiquement chez les Orientaux que chez nous. Fuad-Pacha, le grand Fuad, était médecin militaire avant de devenir le second personnage de l'État. J'ai retrouvé à Bucarest un grand garçon fort intelligent, M. Obedenare, que j'avais connu étudiant en médecine. Quand je lui demandai ce qu'il était devenu depuis le temps, cet excellent docteur me répondit qu'il était premier secrétaire à la légation de Rome. Le général Ahmed fait monter le ministre du roi des Belges dans une magnifique voiture à la livrée du sultan ; nous retrouvons les landaus qui nous ont amenés à l'hôtel et nous partons en troupe pour le palais de Dolma-Bagtché. Ce qui caractérise aujourd'hui le luxe oriental, c'est qu'il est fabriqué de toutes pièces à Paris, à Aubusson, à Saint-Gobain, à Baccarat, dans toutes les manufactures de France. Tandis que nous nous disputons à l'hôtel Drouot les tapis de la Perse, de l'Inde et de la Turquie, on n'apprécie ici que nos moquettes ; les meubles fabriqués au faubourg Saint-Antoine sont tendus invariablement en soieries de Lyon. Rien de plus riche que ces intérieurs où l'on n'a regardé à la dépense que pour la pousser au maximum ; mais la moindre vieillerie originale et nationale ferait beaucoup mieux notre affaire. Les glaces de trente mètres carrés, les candélabres de cristal à deux cent cinquante bougies, les cheminées revêtues de malachite ou enrichies des porcelaines les plus élégantes de la rue Paradis-Poissonnière, ne valent pas pour nous une lampe de mosquée ou même un seul carreau de belle majorque. Plusieurs choses m'ont intéressé dans ce palais immense et ruineux, par exemple les salles de bain construites en albâtre oriental et une petite galerie de tableaux modernes où l'on est tout heureux de retrouver le Gynécée de Gérome (est-ce bien ainsi qu'on l'appelle?) et quelques-unes des meilleures toiles de Fromentin, de Berchère et de Pasini. Mais la salle des fêtes où l'on posait une petite bande de carpette extrêmement simple pour la réception du Courbam-Beïram [Kurban bayrami] m'a seule émerveillé par la hardiesse de sa construction et la noblesse de ses lignes. Lorsqu'une œuvre d'architecture a été conçue grandement, les incorrections de détail sont noyées dans la beauté de l'ensemble. Témoin l'effet de Saint-Pierre de Rome, où le détail est souvent des plus défectueux.
[Beylerbey]
Nous n'avons vu de Dolma-Bagtché que le selamlik, c'est-à-dire les bâtiments à l'usage du maître. Un autre palais aussi grand, peut-être plus grand, et renfermé dans la même enceinte, est occupé par le harem du sultan, qui est tout un monde et un monde soigneusement fermé, comme on sait. Mais nous avons pu effleurer sans indiscrétion les délices et les splendeurs de la vie de famille chez un musulman couronné, car, au sortir de Dolma-Bagtché, Ahmed-Pacha nous a conduits au kiosque de Beylerbey, dont les fenêtres étroitement grillées prouvent qu'Abd-ul-Azis n'y habitait pas seul. Un petit vapeur du sultan et quatre caïques impériaux enlevés (c'est le mot) par des rameurs vêtus de blanc nous transportent à la rive d'Asie et nous déposent sur l'escalier déjà quelque peu délabré de ce joli palais. C'est là que l'impératrice Eugénie a reçu l'hospitalité en 1869, dans la dernière année de sa gloire et de son bonheur. La prise de possession d'un tel nid par la princesse la plus gracieuse de l'Europe et sa petite cour en belle humeur fut assurément une fête comme le Bosphore en avait peu vu. Figurez-vous les étonnements et les curiosités, les cris d'admiration et les éclats de rire de quelques fines Parisiennes introduites dans cette sorte de cloître conjugal qui s'appelle un harem. Il devait être délicieux, le kiosque de Beylerbey ; il l'est encore, et beaucoup, puisque nous en sortons enchantés sous un ciel noir, pour aller visiter ses jardins sous une pluie battante.
Deux mots sans plus à l'adresse des poètes et des jardiniers. Les uns, par leurs descriptions plus brillantes que véridiques, ont abusé les autres sur le climat et la végétation de ce pays. La géographie elle-même a pu accréditer beaucoup d'erreurs en nous montrant Constantinople sur le même degré de latitude que Naples. Hélas ! Constantinople n'a pas le climat de Naples, il s'en faut! Le ciel y est très dur au pauvre monde; il y vente à force, il y neige à profusion et il y gèle à pierre fendre. Aussi la nature y est-elle assez exactement ce qu'elle est à Paris. La Grèce a de beaux orangers, voire des palmiers assez grands qui vont jusqu'à promettre des dattes : ici, vous ne rencontrerez pas même un olivier. Aussi les jardins d'agrément, fût-ce autour des palais impériaux, ont les mêmes massifs et les mêmes corbeilles que nos squares ; troènes et fusains par-ci, coleus, anthémis, fuchsias et géraniums par là, et rosiers de Bengale à profusion. Je n'en ai pas aperçu beaucoup d'autres. Mais un vrai sage se peut contenter à ce prix; je ne suis pas venu ici pour voir mûrir les ananas en pleine terre, et ce n'est pas sans un secret contentement que je retrouve si loin de chez nous mon modeste jardin de Pontoise. Pour couronner dignement cette excursion en Asie, nous gravissons deux ou trois étages de terrasses et nous allons déranger deux malheureux couples de tigres fort beaux d'ailleurs et bien nourris derrière leurs barreaux de fer. Ce sont les derniers survivants de la ménagerie d'Abdul-Azis.
[Topkapi]
Nous nous rembarquons pour l'Europe, et l'on nous met à terre à la pointe du vieux sérail. C'est tout ce qu'il y a de plus curieux dans Stamboul, le beau du beau, le fin du fin, la quintessence, quoique le vieux sérail (ou palais) soit brûlé, comme presque tous les monuments qui datent de la conquête. Ahmed-Pacha, qui n'a point mandat de nous épargner les émotions, au contraire, nous introduit d'abord dans le trésor des sultans, dont la clef seule est un morceau qui mériterait le voyage. Elle n'a pas encore tourné dans la serrure que le joyeux représentant du Times nous propose un coup analogue à celui que les Anglais ont exécuté en Egypte : « Messieurs, dit-il, nous sommes trente et les gardiens ne sont que quatre. Égorgeons-les et prenons tout ». Comme il disait ces mots, trente ou quarante jeunes Turcs semblent sortir de terre et prennent position devant les vitrines, non certes pour les défendre, mais plutôt pour nous en faire les honneurs. Ce trésor est surtout précieux comme musée. Je ferais assez bon marché des métaux précieux et des pierreries qu'il contient, sans excepter le trône d'or massif tout incrusté de joyaux, et les coussins brodés de perles, et les boisseaux de diamants, de saphirs, d'émeraudes et de rubis. Tout cela vaut bon nombre de millions, j'en conviens; mais parlez-moi des armes, des armures, des étoffes, des broderies, de cette collection fabuleuse qui contient les costumes d'apparat de tous les sultans depuis Mahomet II, avec tous leurs poignards et leurs aigrettes impériales. Devant cet amoncellement de belles choses, on est pris d'une certaine reconnaissance pour les despotes qui les ont conservées religieusement au milieu de nécessités quelquefois très urgentes. Abd-ul-Azis est le seul, dit-on, qui ait puisé parfois dans les boisseaux de diamants pour donner des parures à ses femmes ; mais, à l'époque où il l'a fait, n'était-il pas déjà irresponsable?
On dit que la mosquée d'Irène renferme un précieux dépôt d'antiquités musulmanes et des armes du temps des croisades ; mais les simples giaours comme nous ne sont point admis à les voir. Par compensation, l'on nous a régalés d'une visite au kiosque de Bagdad. C'est la seule fantaisie archéologique qui soit jamais éclose dans l'esprit d'un sultan; mais quelle heureuse idée d'employer à la décoration d'un édifice du xve siècle les débris les plus beaux et les plus curieux de l'antique industrie musulmane ! Les revêtements de faïence, empruntés apparemment à quelques mosquées hors d'usage, suffiraient seuls à la gloire et à la fortune d'un musée d'art décoratif. Il y a eu de grands artistes turcs, par exemple celui qui a martelé ce magnifique dais de cuivre doré, vrai chef-d'œuvre de chaudronnerie qu'on admire dans le jardin. Les riches exemplaires du Koran, qu'on garde ici dans la petite bibliothèque du vieux sérail et que nous n'avons pas eu le temps d'admirer à notre aise, valent bien nos missels du moyen âge par la beauté des ornements et le fini de l'exécution.
A force d'aller, de venir et de tourner sur cet étrange et précieux coin de terre où l'on voit de vieux jardins avec des ifs taillés à la mode de Versailles, de vieux serviteurs du palais , et même un vieux harem peuplé de sultanes en retraite, nous avions fini par sentir la fatigue. Ahmed-Pacha s'en aperçut et nous fit asseoir dans le kiosque d'Abd-ul-Medjid, qui n'est pas très beau par lui-même, mais qui jouit d'une vue incomparable sur la mer. On nous y servit un café délicieux, précédé d'une cuillerée de sorbet à la rose et du verre d'eau de rigueur avec la cigarette de Djebeli, qui remplace décidément le chibouque dans le cérémonial hospitalier. Autrefois, la moindre visite entraînait non seulement toute une manœuvre, mais toute une cuisine. Le chiboudgi de la maison s'avançait vers vous gravement, une longue pipe à la main. Il mesurait avec soin la distance, posait à terre un petit plateau de cuivre ou d'argent, y déposait le fourneau de l'instrument, puis décrivait savamment un arc de cercle avec le bout d'ambre pour l'amener tout juste à vos lèvres. Ce travail accompli, il mettait le charbon sur la pipe s'il n'avait commencé par la fumer lui-même au seuil de la porte avec une douce familiarité. Mais ce n'était pas tout : il fallait que chaque tuyau fût gratté, lavé, parfumé, lorsqu'on en avait fait usage ; le bout d'ambre surtout, qu'il fût ou non chargé de diamants à sa base, exigeait un entretien méticuleux, car la nicotine ne manquait jamais de s'y condenser. Il fallait tout un personnel attaché aux chibouques dans les maisons qui recevaient beaucoup. Avec un demi-cent de cigarettes sur un plateau, la politesse est faite, la tradition respectée, l'honneur de l'hospitalité orientale sauvegardé et le tracas réduit à rien. Comme nous remarquions l'air aisé et les bonnes façons des jeunes gens qui nous offraient les rafraîchissements d'usage, on nous apprit que dans tous les palais impériaux le service est fait par les fils des meilleures familles que leurs parents destinent aux emplois de la cour. C'est ainsi qu'autrefois, chez nous, les gentilshommes de grandes maisons débutaient comme pages à la cour du roi ou chez les princes du sang. Non seulement on ne déroge pas en servant le maître suprême, mais plus les fonctions qu'on remplit auprès de lui ont un caractère intime, plus elles sont considérées et honorées. C'est ce qui vous fera comprendre comment le kislar-agha [kizlar aga] marche de pair avec le grand vizir. Si l'un de ces deux personnages est le plus haut instrument de la volonté souveraine, l'autre, le chef des eunuques, est le gardien de l'honneur. Pour nous autres badauds de l'Occident, c'est toujours un objet de curiosité que la face glabre, luisante et molle d'un de ces hommes incomplets quand nous l'apercevons dans la rue à côté du cocher sur le siège d'une voiture de femme, ou les mains dans les poches devant la porte d'un palais. Les Orientaux, au contraire, considèrent l'eunuque comme un des éléments de la famille musulmane; ils ne raillent jamais son malheur, estiment son courage et son dévouement au maître et envient quelquefois sa fortune, car il est souvent riche et toujours charitable au point d'épouser une veuve chargée de famille pour léguer ses économies à quelqu'un. Je ne crois pourtant pas qu'un seul de ceux qui s'offrent à nos yeux ait choisi de plein gré sa carrière. Or, il y en a de très jeunes : d'où viennent-ils ? où les fabrique-t-on ? La route du voyageur en ce pays est littéralement hérissée de points d'interrogation. Depuis longtemps la traite des esclaves blancs ou noirs, mâles ou femelles, est interdite par la loi. Cependant il y a toujours des esclaves, et la société musulmane se désorganiserait s'il n'y en avait plus.
Mais nous ne sommes pas ici pour raisonner ni pour comprendre ; on fait avancer nos voitures, nous traversons au trot de vieilles cours vastes et dépavées, nous passons en revue des fantômes de cyprès séculaires et de platanes antédiluviens, nous débouchons sur la place du Séraskiérat, où des conscrits fraîchement débarqués dans le costume de leurs villages, quelques-uns en vestes de cotonnade rose et en caleçons lilas tendre, apprennent une manœuvre assez agréable, qui consiste à se baisser pour prendre la gamelle et à manger le repas du soir. Le soldat turc est payé très irrégulièrement, et il a cela de commun avec presque tous les fonctionnaires de l'empire, mais il est bien logé, bien vêtu et nourri paternellement. Outre sa ration de pain, qui est la même que chez nous, il reçoit deux fois chaque jour un rata de viande et de légumes, deux fois par semaine un plat sucré, de temps à autre une distribution de tabac. Sur les revenus de l'empire qui ont sensiblement décru avec le territoire et qui consistent surtout aujourd'hui dans le produit des douanes et la dime des provinces asiatiques, c'est l'armée qui prend la grosse part. Le sultan, qui règne et gouverne avec un sérieux auquel tous les partis rendent hommage, veut être prêt à tout événement et défendre avec honneur ce qu'il possède encore en Europe. Je serais bien surpris si, le cas échéant, il n'était pas héroïquement soutenu par son armée et par son peuple entier. Qui vivra verra. Pour l'instant, c'est-à-dire à la sortie du vieux sérail, nous voyons les bons Turcs absorbés par une œuvre très pacifique : ils choisissent, achètent et emportent les moutons qu'ils vont immoler et manger à la fête du Gourbam-Beïram. Ce sacrifice renouvelé d'Abraham est de devoir étroit, comme l'agape qui s'ensuit. Ce qui restera du mouton sera distribué aux pauvres qu'un musulman n'oublie jamais dans les fêtes privées ou publiques. Un grand marché improvisé remplit la place où nous défilons. Plusieurs troupeaux dont la laine est marquée aux couleurs de leur propriétaire nous montrent divers types de la race ovine. Le plus recherché paraît être le mouton à queue grasse, qui traîne après lui quatre ou cinq kilogrammes de suif. L'amateur tâte l'animal sur toutes les coutures en même temps qu'il le marchande, et, lorsque l'affaire est conclue, il charge son mouton sur le dos et l'emporte comme un enfant. Nous rencontrons à chaque pas un de ces groupes comiques, et cependant ni la bête ni l'homme ne devinent pourquoi nous rions. Le char impérial de ce bon M. Olin nous fraye un passage à travers la foule multicolore qui encombre à toute heure le pont de Galata. Nous montons à Péra, nous regagnons l'hôtel, nous dînons de grand appétit, et nous dormons comme des hommes qui ont roulé sans interruption du jeudi soir au mardi soir. Les plaisirs les plus vifs et les plus variés ne nous tiennent pas lieu de repos; je parle en homme de mon âge.
***
VI
Il paraît que les chiens ont fait rage toute la nuit sous nos fenêtres et dans les rues voisines ; mais c'est tant pis pour eux, je ne me suis pas réveillé. Ces chiffonniers à quatre pattes sont assez tranquilles le soir; ils se querellent de préférence au petit jour, quand on jette dehors les os et les débris de cuisine. Lorsque j'ouvris les yeux à huit heures, l'ordre régnait dans ce monde grouillant et une grosse chienne jaune, les deux pieds de devant sur le trottoir de l'hôtel, les deux pieds de derrière dans le ruisseau, allaitait bien tranquillement ses quatre petits. Je trouvai en ouvrant les yeux les dernières nouvelles de Paris, que le représentant de l'agence Havas, M. de Ridder, prit l'aimable habitude de m'adresser tous les matins à domicile. Presque au même moment, on introduisait dans ma chambre Hamdy-Bey, fils du ministre de l'intérieur et directeur des musées impériaux. Ce jeune homme très distingué, qui a étudié la peinture à Paris, dans l'atelier de mon ami Gustave Boulanger, m'invite à visiter les collections qu'il a formées et l'École de dessin dont il est à la fois le fondateur et le directeur. Le tout est situé à deux cents pas de Sainte-Sophie où nous devons aller après midi ; je ferai donc d'une pierre deux coups. Vient ensuite le correspondant du Temps, M. Domenger, écrivain de talent et bon Français. Je m'empare avidement de lui et j'abuse de sa courtoisie pour l'assassiner de questions. La première de toutes, vous la devinez bien : « Que sommes-nous ici? Qu'y faisons-nous ? Comment y sommes-nous vus et traités ? Que devient l'influence française en Turquie? » Eh bien, il paraît que nos affaires, sans être très brillantes, pourraient aller plus mal. Le sultan qui reçoit beaucoup et qui aime à traiter le corps diplomatique, apprécie particulièrement notre ambassadeur M. de Noailles, et ne se cache pas d'aimer la France qui d'ailleurs est la seule amie désintéressée de l'empire ottoman.
Le collège de Galata-Séraï [Lycée de Galatasaray], fondé par M. Victor Duruy dans l'intérêt de l'influence française, compte sept cents élèves dont six cents internes qui tous mènent de front l'étude du turc et du français. Le directeur, Ismaîl-Bey, est comme de juste un musulman, et le sous-directeur, M. d'Hollys, un Français. Ismaîl-Bey, homme éclairé et juste, est peut-être le seul chef de service dont les subordonnés soient payés régulièrement en or le premier jour de chaque mois ; il a même obtenu qu'on soldât leur arriéré jusqu'au dernier centime, et ces bons procédés envers nous mériteraient peut-être du gouvernement de la République un témoignage de reconnaissance. Son second, M. d'Hollys, est un vrai sage, aussi modeste que capable, sans aucune ambition personnelle et exclusivement dévoué aux intérêts de l'enseignement. Fidèle à son pays, sincère admirateur de M. Duruy, qui s'est fait une place dans l'histoire universitaire de France entre M. Guizot et M. Jules Ferry, il estime les Turcs comme tous ceux qui les ont vus de près et comprend les susceptibilités légitimes d'un peuple dont les malheurs n'ont pas abattu la fierté, tout au contraire. Plus l'empire ottoman est à l'étroit dans ses nouvelles frontières d'Europe, plus il tient à honneur de prouver qu'il est maître chez lui. Les juridictions étrangères, les postes étrangères qui se sont impatronisées à Péra, toute ingérence étrangère, en un mot, leur apparaît comme une offense, comme un souvenir injurieux du vieux temps où les puissances occidentales avaient à protéger leurs nationaux contre les avanies du musulman. Les revendications patriotiques d'Abd-ul-Hamid sont admirablement secondées, me dit-on, par le grand-vizir Saïd-Pacha, homme de haut mérite, infatigable travailleur et, chose rare en ce pays, ministre pauvre. En voilà certes plus qu'il ne faut pour recommander la Turquie contemporaine à notre estime et à nos sympathies; mais ne nous leurrons pas, mes amis. Depuis la guerre de 1870, les Allemands sont dans la place. Non seulement leurs instructeurs et leurs officiers ont su se rendre indispensables dans l'armée, mais on trouve un sous-secrétaire d'État allemand plus ou moins officiellement installé dans tous les ministères. On peut compter que ces bons messieurs de Berlin défendraient l'empire ottoman contre une nouvelle agression de la Russie; rien ne prouve qu'ils le protègeraient aussi bien contre leurs alliés d'Autriche. Nous avons vu passer hier, au pied du vieux sérail, un train du chemin de Roumélie. Cette ligne n'est qu'un tronçon interrompu volontairement par les Turcs. Ils ont lu dans Musset qu'une porte doit être ouverte ou fermée, et ils aiment mieux fermer leur porte. Mais qui sait si les Russes ne les mettront pas en demeure de rouvrir ? ou si l'Autriche, à défaut de la Russie, ne dira pas que ses marchandises ont hâte d'arriver à Salonique? Assez de politique pour aujourd'hui : on nous mène à Sainte-Sophie.
{mospagebreak}
[Sainte-Sophie]
Les musulmans se sont approprié ce chef-d'œuvre de l'architecture byzantine en construisant des minarets, en badigeonnant quelques fresques, en cachant sous une feuille de cuivre doré quelques têtes de chérubins et en accrochant dans les angles des inscriptions turques sur des panneaux de tôle ou de bois qui ressemblent à des enseignes colossales. Les prêtres ou peut-être les sacristains exploitent la beauté et la gloire du monument, d'abord en faisant payer aux chrétiens un droit d'entrée de quatre ou cinq francs par tête, ensuite en contraignant les visiteurs d'acheter les cubes de mosaïque que ces vandales arrachent à poignée le long des murs. Malgré ces horreurs, l'édifice est splendide, moins fini, moins complet et plus fruste que Saint-Marc, mais bien plus grand et plus hardi avec sa coupole de proportions cyclopéennes qui repose exclusivement sur quatre piliers. L'art gréco-romain était vieux sous Justinien au vie siècle de notre ère, mais il était encore bien robuste et je ne sais si notre science, notre argent et nos prétentions pourraient rivaliser avec lui. Ni les photographies du commerce, ni les études d'ensemble et de détail que les pensionnaires de Rome ont exposées au Salon ne vous donneront une idée de la majesté de Sainte-Sophie. Pour juger la grandeur de l'édifice, il faut le mesurer à soi-même et voir le peu de place qu'on y tient. Il faut jauger, pour ainsi dire, la massé des matériaux précieux qui y sont accumulés, granit, porphyre, serpentin, brèche antique et ce beau marbre cipollin dont on a fait non seulement des colonnes, mais le pavage entier des galeries. Si les conquérants en délire ont pillé l'or, l'argent, les pierreries, en un mot toutes les richesses accumulées par la dévotion des empereurs d'Orient, ils ont laissé debout les colonnes que l'architecte Anthémius avait empruntées à tous les temples de la Grèce, de l'Asie et de l'Egypte. Tout ce que les sultans ont ajouté au monument primitif pour transformer la basilique en mosquée est peu de chose, à part les quatre minarets qui entourent la grande coupole ; et il nous semble que le Dieu des chrétiens, s'il reprenait possession de ce temple, comme le veut une antique légende chère aux Grecs, après cinq ou six jours de balayage, se retrouverait chez lui. Mais les brutalités de la conquête, la fureur des éléments et le temps, ce grand destructeur silencieux, ont cruellement altéré tout ce qui reste encore debout. Il a fallu étayer des arcades, consolider des murs, fretter de fer ou de bronze presque tous les chapiteaux, et tout cela s'est fait grossièrement, d'une main lourde. Le jour approche où Sainte-Sophie ne pourra plus être sauvée que par une restauration complète. Les Turcs entreprendront-ils ce travail ? Non, jamais [la restauration de Sainte-Sophie a été achevée cette année 2010]. C'est le peuple le moins réparateur qui soit au monde ; d'ailleurs, où prendraient-ils les cent millions que cela doit coûter au bas mot ? Les Russes seuls... Mais ici notre archéologie devient un peu révolutionnaire. Démolir un empire pour réparer une basilique, ce n'est pas une solution.
[Le musée d'Hamdy-Bey]
Les trois quarts de nos compagnons, sans respect du programme tracé par M. Weil, veulent absolument aller voir, tout au fond de la Corne d'Or, des hommes barbus qui lèvent les mains au ciel et tournent pendant un quart d'heure sur un air de valse à deux temps afin d'enseigner aux profanes que Dieu est partout à la fois. J'ai vu cet exercice au Caire, et comme il est peu vraisemblable qu'on l'ait perfectionné depuis 1868, j'aime mieux visiter Hamdy-Bey dans son petit musée. Il n'est pas encore très riche, d'abord parce qu'il est nouveau, ensuite parce que les Turcs se sont laissé reprendre tous les chefs-d'œuvre qu'ils avaient pris. La Vénus de Milo est à Paris ; les marbres du Parthénon sont à Londres et le fronton du temple d'Egine à Munich. Tout récemment encore les Allemands du Nord ont fait main basse sur l'admirable frise de Pergame qui a plus de cent mètres de long et que le pauvre Tourgueneff me décrivait dans une lettre enthousiaste la première fois qu'il la vit à Berlin. Le savant épicier Schliemann a trafiqué du trésor de Priam et des reliques d'Agamemnon sans rien offrir à la Turquie, si ce n'est un collier moderne, mais dont l'or est antique, à ce qu'il dit, et je le crois sans difficulté, car la nature ne fabrique plus d'or depuis quelques milliers de siècles. Les Prussiens ont donné à Hamdy-Bey quelques mètres, en plâtre s'entend, de cette belle frise qui rappelle un peu la manière si vivante et si française de Pierre Puget ; le Louvre a mis à sa disposition tous les moulages dont il pourrait avoir envie ; les Bavarois et les Anglais ne lui ont rien offert du tout. Aussi ne possède-t-il guère jusqu'à présent que des marbres de peu de prix, sarcophages, tombeaux, statues, bustes déterrés dans les îles et particulièrement à Chypre ; des figurines de terre cuite dans le style de Tanagra, quelques jolis fragments de bronze, quelques vases antiques et un certain nombre d'inscriptions; le tout catalogué avec soin par un membre de l'École d'Athènes, M. Salomon Reinach. Peut-être le tombeau d'Antiochus qu'Hamdy-Bey a découvert lui-même dans les neiges, à deux mille mètres au-dessus du niveau de la mer, livrera-t-il un certain nombre de sculptures précieuses. J'en ai eu comme un avant-goût en voyant des estampages assez beaux. Ce jeune musulman érudit voudrait aussi, dans son patriotisme, réunir et classer les meilleurs ouvrages de la vieille industrie nationale. Il possède déjà neuf ou dix lampes de mosquées, tant en verre qu'en majolique, des meubles incrustés, des casques du temps des croisades ; et, s'il disposait d'un budget suffisant, il ferait encore, dit-il, des trouvailles intéressantes dans quelques villes d'Asie où les amateurs en boutique n'ont pas encore mis les pieds.
Nous terminons la promenade par une visite à l'École de dessin, vaste, propre et bien exposée, où une vingtaine de jeunes Turcs, dont quelques-uns sont déjà passablement avancés, travaillent avec intelligence, les uns d'après la bosse, les autres d'après les modèles édités par la maison Goupil.
[Flânerie]
Ah! si j'avais quelques jours de plus devant moi, quel plaisir je prendrais à parcourir la ville en compagnie d'un homme de goût, d'un connaisseur éclairé comme Hamdy-Bey ! Constantinople est un vrai fouillis de merveilles que ni les guides européens ni les Turcs eux-mêmes ne connaîtront ou n'apprécieront jamais. La divine fontaine d'Ahmed III, ce bijou qui pourrait être en or sans valoir un centime de plus, ce monument sculpté en dentelle de marbre, n'est pas une œuvre unique en son genre. La cité impériale fourmille de tombeaux historiques, de colonnes gréco-romaines, de citernes monumentales ; tout cela est abandonné, perdu, noyé dans des propriétés privées. L'ancien Hippodrome illustré par les rivalités sanglantes des Verts et des Bleus, avec les trois bornes monumentales qui limitaient trois pistes d'inégale grandeur, l'obélisque de Théodose, la Serpentine et la colonne d'airain dont une cupidité imbécile a détruit le revêtement, sera fouillé assurément un jour ou l'autre, et, à deux ou trois mètres au-dessous du sol actuel, l'archéologue y découvrira des trésors. Sans creuser si profondément, en flânant devant nous le nez en l'air, nous allons de surprise en surprise. C'est quelquefois un reste de palais, quelquefois un débris de forteresse intérieure, une façade étrange et menaçante comme la maison des Strozzi à Florence, ou une fantaisie lapidaire d'un style aimable et léger, un coin de pavillon, une grille de fer ouvrée un petit bout de jardin qui nous rappelle les contes orientaux du bon temps, le mariage de la princesse avec un barbier jeune et beau, les amours mélodieuses et embaumées du rossignol et de la rose. Mais l'heure nous talonne et l'implacable tradition nous commande. Il faut bon gré mal gré arpenter, au milieu des courtiers officieux et des mendiants opiniâtres, les ruelles boueuses du Bazar, cette ville de khans, de boutiques et d'échoppes où Ton ne débite plus que des marchandises européennes. Il faut chercher en vain des médailles antiques chez le saraf ou changeur qui agiote du matin au soir sur toutes les monnaies du monde civilisé ; il faut choisir des bijoux à bas titre et autres articles orientaux chez des marchands cosmopolites, moins bien assortis et plus chers que les juifs algériens de Paris. Et lorsque l'on s'est acquitté de ce fastidieux devoir, il faut rentrer vivement à l'hôtel et mettre une cravate blanche, car l'excellent M. Delloye-Matthieu, qui nous héberge depuis six jours, croirait manquer à ses devoirs s'il ne nous offrait pas un festin magnifique et délicieux, émaillé de toutes les constellations qui se portent à la boutonnière, se suspendent au col ou s'accrochent au revers de l'habit.
La fête fut superbe et fort bien ordonnée ;
le cuisinier de l'hôtel se surpassa, les meilleurs vins de France coulèrent à flots, les toasts joyeux et sérieux se succèdent aux applaudissements des convives, et l'un de nous, que la modestie ne me permet pas de nommer, s'exprima en assez bous termes sur les paysans, les ouvriers, les soldats, ces éléments modestes, honnêtes et vigoureux qui constituent le fond du peuple turc. Ahmed-Pacha, qui siégeait à la droite de notre cher amphitryon, répondit non seulement en homme du monde, mais en homme de cœur, et la fête se prolongea assez tard sans fatiguer personne, car au lieu de se mettre au lit à dix heures, comme la veille, on alla finir la soirée dans un lieu de perdition qui se nomme Concordia. C'est un café-concert où de jolies personnes décolletées chantent des barcaroles parisiennes que je m'accuse de n'avoir jamais entendues à Paris. Derrière le théâtre on joue à la roulette, comme on faisait jadis au doux pays de Baden-Baden. On y peut même, paraît-il, perdre beaucoup d'argent, car après le traité de San-Stefano, à l'entrée des officiers russes, cet établissement philanthropique, avec ses deux zéros et ses vingt-quatre numéros, encaissa, dit-on, quatre cent mille francs. C'est ainsi qu'en 1815 les Cosaques ont fait la fortune du Palais-Royal.
Jeudi 11 octobre. — Hier à six heures, en rentrant à l'hôtel, nous avons croisé dans une rue de Péra un coupé attelé de deux chevaux de race et qui se ferait remarquer au bois de Boulogne dans Tallée des Acacias. Notre guide, assis sur le siège, s'est retourné et nous a jeté ces trois mots : « Le prince Izeddin ». J'ai regardé dans la voiture avec une curiosité intense, et j'ai eu tout juste le temps d'apercevoir un jeune homme au teint mat, aux grands yeux, à la moustache fine et luisante , qui semblait profondément ennuyé. C'est le fils aîné de ce pauvre Abd-ul-Azis, le prince qui causa peut-être, et bien innocemment, la mort de son père. Le sultan qui périt dans son harem, suicidé par des mains inconnues, avait accordé ou vendu au khédive Ismaîl un firman contraire en tous points à la tradition musulmane. Il avait décidé qu'en Egypte le fils aîné du vice-roi hériterait du pouvoir de son père, à l'exclusion des collatéraux, dont le premier en ligne était le prince Halim, fils de Méhémet-Ali. On supposa qu'il préparait une révolution du même genre en faveur d'Izeddin et il accrédita lui-même ce soupçon par les faveurs inusitées dont il comblait imprudemment son aîné. De là le drame sanglant dans lequel les journaux d'Europe, toujours enclins à mettre les choses au pis, enveloppèrent un instant, sans preuve aucune, la mère et le fils aîné d'Abd-ul-Azis. Il y a du bon et du mauvais dans l'ordre de succession au trône tel qu'il est établi chez les Turcs. D'un côté, l'intérêt des peuples veut que dans aucun cas le pouvoir ne puisse tomber aux mains d'un enfant; mais le cœur humain est ainsi fait, qu'un père préférera toujours son fils à ses frères ou à ses oncles, et qu'un despote, accoutumé à voir plier toutes les volontés devant la sienne, résistera difficilement à la tentation d'aplanir les obstacles qui séparent son fils du trône. Notez, en outre, que des exemples mémorables, tant anciens que nouveaux, conseillent au maître de l'empire certaines précautions contre son héritier collatéral, fût-il son propre frère. Au moyen âge, il prévenait les conspirations de palais, en faisant le vide autour de lui. Les mœurs modernes sont infiniment plus douces. Toutefois le sultan garde à sa cour et ne perd pas de vue son héritier présomptif. Il existe encore plusieurs fils d'Abd-ul-Medjid qui succéderont, inchallah! (s'il plaît à Dieu) à l'empereur Abd-ul-Hamid, leur auguste frère, avant qu'il soit question de couronner Yousouf Izeddin. Ce jeune prince a donc bien des années devant lui pour s'ennuyer ou pour s'instruire.
Nous avons fait partie d'aller voir aujourd'hui les derviches hurleurs qui fonctionnent dans une sorte de couvent à Scutari. Comme leurs portes ne s'ouvrent pas avant deux heures de relevée, je puis vaquer à mon aise dès le matin à travers les rues de la ville turque. J'y vais seul, sans ami, sans guide, comme au bon temps de la jeunesse où je n'avais pas même un plan dans la poche, et pourtant je ne m'égarais jamais, pas plus à Londres qu'à Stamboul. Il me semble que bien des choses ont changé par ici ; les rues sont plus larges, plus droites ; on dirait que le baron Haussmann y a passé. Si ce n'est lui, c'est l'incendie qui a rasé les vieux quartiers construits en bois et entraîné les habitants à rebâtir leurs maisons en pierre. On en voit de fort propres et même d'assez belles, qui révèlent à la fois un supplément d'aisance et un surcroît de sécurité. Vous connaissez ce mot d'un raïa grec à qui l'on demandait : « Pourquoi ne plantes-tu pas d'arbres autour de ta maison ? » Il répondit : « Si j'étais assez fou pour en planter un seul, le premier Turc qui passerait devant chez moi s'installerait à l'ombre avec ses serviteurs ; il me commanderait de faire le café et de rôtir un agneau. » Ce n'était pas seulement le Grec, l'Arménien ou l'Israélite qui cachait sa richesse comme un crime ; jadis le Turc lui-même faisait le pauvre pour éviter les impôts, les exactions et les confiscations. Les vieux abus ont fait leur temps ; peut-être l'arbitraire a-t-il encore ses coudées franches dans quelques recoins des provinces d'Anatolie ; mais dans la capitale il est certain que la loi, les moeurs, l'opinion publique garantissent les droits de chacun. Par une contradiction singulière, mais non pas inexplicable, le luxe des vêtements, des équipages, du domestique, parait avoir sensiblement décru. Il y a trente ans, l'élégance des femmes savait fort bien se faire valoir sous le féredjé comme leur beauté triomphait sous la finesse transparente du yachmak. Les grands nigauds d'Europe qui rêvaient des aventures impossibles rencontraient au bazar ou dans les rues, en moins d'une demi-journée, cent hanouns assez bien vêtues et assez brillamment entourées pour mettre une imagination parisienne en feu. Le changement qui me frappe est-il dans les objets ou dans mes yeux ? Est-ce parce que j'ai vieilli que les bourgeoises de Stamboul me paraissent moins jeunes et moins bien faites, mal fagotées et chaussées en dépit du sens commun dans leurs bottines d'Europe éculées? Un observateur moins superficiel que je ne suis forcé de l'être me dit qu'en effet, grâce au crédit illimité que l'Occident ouvrait à la Turquie, Stamboul a traversé une phase de prospérité dont tous ses nouveaux bâtiments gardent la trace ; mais un krach financier, politique et militaire à la fois, a défait beaucoup de fortunes, mis à mal plus d'une famille, fait vendre quantité de diamants, réduit le train général de la population et singulièrement attristé ce bal masqué quotidien qui réjouissait nos yeux dans la rue.
[A Scutari]
Je rapporte à l'hôtel une impression de mélancolie que le soleil lui-même n'a pas su dissiper, et j'augure assez mal du spectacle qu'on nous a promis pour remplir notre après-dînée ; il me semble que les hurleurs doivent être proches parents des jongleurs africains que Paris a sifflés sous le nom d'Aïssaouas. Eh bien ! non, nous n'avons pas perdu notre temps et la journée a été bonne. D'abord la traversée du Bosphore en caïque lorsqu'il fait beau est toujours une partie de plaisir. Le caïque est aussi léger que la gondole vénitienne est pesante, aussi clair qu'elle est sombre, aussi gai qu'elle est triste. L'instabilité même de ce véhicule étonnant, qu'un souffle ferait chavirer, ajoute au charme du voyage. Et puis les caïdgis sont des gaillards si pittoresques ! et puis on fait tant de rencontres en moins d'une demi-heure, paquebots, bateaux-mouches, gros voiliers chargés à couler, goélettes, caravelles, tartanes, tous les modèles des bateaux qui vont sur l'eau, sans excepter la fameuse galère qui a joué son rôle dans les Fourberies de Scapin ! Nous touchons tous ensemble à l'échelle de Scutari et nous débarquons pêle-mêle sur les planches pourries, au milieu d'un concert d'imprécations polyglottes. Nous prenons des chevaux de selle ou des fiacres, chacun selon son goût, et nous escaladons au trot, au galop, à travers une foule compacte, la grande rue boueuse et mal pavée de Scutari. L'encombrement n'y est pas moins touffu que dans un faubourg de Paris le matin d'une fête nationale. Hommes, femmes, enfants, soldats en permission, bergers venus de loin, marchands ambulants, oisifs qui chôment par avance la solennité du lendemain, se pressent et se coudoient bruyamment, mais sans brutalité, comme gens de la même famille. On vend encore des moutons ; on vend aussi des couteaux pour les immoler et des grils pour les faire cuire. Je remarque un jeune bourgeois de vingt à vingt-deux ans qui s'est emmailloté la figure dans un mouchoir à carreaux et qui pousse gravement devant lui un grand commissionnaire et un énorme mouton, l'un portant l'autre. Si tu as mal aux dents, mon garçon, comme il est permis de le croire, ton mouton fraîchement tué ne sera pas tendre demain !
[Derviches hurleurs]
Scutari fourmille d'enfants et vous n'avez jamais rien vu de plus beau que les petits Turcs, garçons et filles. Tous ces marmots, riches ou pauvres, mais les pauvres surtout, sont accoutrés de la façon la plus pittoresque et comme enluminés de couleurs vives et fraîches. En voilà cinq ou six que le hasard a groupés sur la crête d'un vieux mur. Je défie le printemps lui-même de faire fleurir un tel bouquet. A cent pas de la petite mosquée des Derviches, la pente que nous gravissons devient si raide qu'il nous faut mettre pied à terre. Nous arrivons à une petite cour; un sacristain du plus beau noir nous débarrasse de nos cannes et de nos parapluies, nous pousse dans un bâtiment qui a l'air d'une église de village et nous fait asseoir sur des bancs, les uns au rez-de-chaussée, les autres dans une espèce de soupente. Quelques chuchotements discrets et quelques rires étouffés attirent notre attention sur une tribune grillée. Il y a des curieuses ailleurs que dans la pièce de Meilhac. La mise en scène de l'ouvrage qu'on va représenter devant nous est plus bizarre que terrible. Nous voyons tout un jeu de tambours de basque pendus au mur, en face d'instruments dont la forme et l'emploi nous sont moins connus. Vous diriez de petits mortiers de pharmaciens tendus en peau d'âne. Il y a bien aussi quelques armes, mais des armes trop formidables pour être inquiétantes; par exemple des masses de fer empruntées à quelque panoplie du moyen âge. Une sorte de niche qui parait tenir lieu d'autel est encombrée d'objets divers et mystérieux dont les uns semblent destinés à l'exercice du culte, les autres m'ont tout l'air d'être de simples ex-voto. Le pavé du temple est couvert d'une natte, mais on y voit aussi quelques tapis de prière assez beaux et quantité de peaux de mouton que le bedeau range et dérange inutilement avec un soin minutieux, comme pour amuser le tapis. Après une attente assez longue, un chant grave et passablement mélodieux s'élève dans la cour et nous prépare à la cérémonie. Presque aussitôt nous voyons entrer quatre derviches vêtus de noir avec un peu de blanc, très sérieux et visiblement convaincus de leur importance. Un homme d'une quarantaine d'années, fort digne, est comme le curé de cette petite paroisse. Nous remarquons parmi ses vicaires un jeune ascète au profil d'aigle qu'on croirait détaché d'une toile de Murillo. Ces bons messieurs, qui nous ont fait payer à la porte de leur établissement et qui viennent d'encaisser environ cent francs de recette, débutent par une prière à notre intention : ils demandent pardon à Dieu d'avoir laissé entrer ces chiens de chrétiens dans son temple. Mais vous voyez que dans l'Église musulmane la fin justifie les moyens. Les hurlements que nous sommes venus écouter se font espérer très longtemps.
Le clergé paroissial prélude par une cérémonie assez imposante, accompagnée d'un beau plain-chant, aux exercices violents qu'il ne fait pas lui-même, car les derviches hurleurs sont des hommes qui ne hurlent pas, mais qui donnent à hurler. Les vrais acteurs du mélodrame se recrutent parmi les fanatiques de la rue, tandis que les prêtres récitent des oraisons, font des génuflexions, baisent la terre, brûlent de l'encens, échangent des accolades et reproduisent maint détail du rituel catholique. L'enceinte se remplit peu à peu de curieux et de dévots qui entrent l'un après l'autre, saluent respectueusement le sanctuaire et vont s'accroupir sur les nattes ou dans la galerie, acteurs ou spectateurs, à leur choix. Ce personnel composite comprend surtout, à ce qu'il semble, des artisans, des domestiques, des matelots; des soldats, sans préjudice des bons bourgeois qui s'y mêlent de temps à autre, entraînés par l'exemple, gagnés par la contagion, comme autrefois chez nous les convulsionnaires de Saint-Médard. L'espèce humaine est moins variée que l'on ne croit, et, comme le soleil, la folie luit pour tout le monde. Au milieu du service religieux qui suit son cours et des prières chantées qui vont leur train, il s'est formé petit à petit dans le fond de la salle un groupe d'hommes coiffes du fez ou du turban, vêtus comme les gens de la rue et même un peu déguenillés par-ci par-là. Ils se tiennent debout, serrés les uns contre les autres, et ils invoquent Dieu en chœur. Leur prière n'est ni longue ni compliquée : les prêtres psalmodient des versets et des répons ; quatre vieillards assis sur des peaux de mouton chantent des choses curieuses dont Félicien David a su tirer un bon parti. Quant à nos fanatiques, ils ne disent qu'un mot : « Allah ! » et chaque fois qu'ils le prononcent ils inclinent la tête en signe de respect. Mais, au bout d'un quart d'heure, la fatigue et l'excitation font si bien qu'au lieu de prier on crie, et qu'au lieu d'incliner la tête on la jette en avant par un mouvement saccadé. Un quart d'heure encore et les cris se changeront en hurlements, les secousses en contorsions. Bientôt une sorte d'ivresse s'empare de ces malheureux. Haletants, ruisselants de sueur, demi-nus, car ils ont rejeté tout ce qui pesait à leur corps, ils se tordent le cou en faisant pivoter leur tête avec une telle impétuosité qu'on ne serait pas surpris de la voir s'arracher et tomber à terre. La voix leur manque, l'air siffle dans leurs bronches, on n'entend presque plus qu'un concert de râles étouffes.
Mais gardez-vous bien de les plaindre : on lit sur leur visage convulsé une grossière béatitude, et même, j'en ai peur, un avant-goût solitaire et malsain du paradis de Mahomet. Grand bien leur fasse ! Nous n'envions pas leur plaisir. Mais la vue de ces exercices éveille une certaine émulation dans l'assistance musulmane. Plus d'un spectateur, homme grave, coiffé du fez, vêtu de la redingote longue, porteur d'une de ces belles barbes teintes en bleu qui faisaient croire à Gérard de Nerval qu'un musulman est toujours jeune, suit le mouvement peu à peu, commence par dodeliner de la tête, fredonne ensuite à l'unisson et finit par entrer en danse. Un monsieur qu'on prendrait volontiers pour un colonel en retraite, tant sa tenue est correcte et sa figure respectable, s'était assis à trois pas de nous, à l'intérieur de la nef, sur la natte. Il a fait comme beaucoup d'autres, et le voici qui exécute sa partie dans l'ensemble sans hurler, mais en accompagnant les hurleurs sur le tambour de basque. Les instruments ont été décrochés au nombre de vingt ou trente par un petit bossu sans bosse, gamin difforme et grimaçant qui remplit les fonctions d'enfant de chœur. Je crois bien que ce gnome commence à débaucher quelques autres moutards du quartier, car deux apprentis de son âge se tortillent et s'égosillent avec lui. Quand je vivrais cent ans, je n'oublierais pas les grimaces de ce singe de Mahomet, ni surtout les contorsions héroïques d'un beau grand nègre dont la dévotion expansive et aromatique triomphe des parfums d'Arabie et atteste la vanité de l'encens.
Lorsque la passion religieuse est assez exaltée pour que l'homme ne diffère plus sensiblement de la bête, les thaumaturges ont beau jeu. Aussi voyons-nous le curé de cette étrange paroisse donner publiquement audience à des malades qui lui demandent tous un miracle, ni plus ni moins. Le premier est un artisan d'une cinquantaine d'années ; il marche avec difficulté et tient ses côtes comme un homme qui souffrirait du lumbago. On le fait couchera plat ventre et le prêtre lui marche sur le corps sans aucune difficulté. Vient ensuite le jeune homme de bonne famille que j'ai remarqué dans la rue avec son grand madras en mentonnière et son mouton à dos de portefaix. II est arrivé un quart d'heure après nous et il a assisté pieusement à la deuxième moitié de l'office en balançant la télé et en murmurant des prières. Ainsi préparé, il s'avance vers le chef des derviches qui lui fourre les doigts dans les oreilles en marmottant un exorcisme ou une bénédiction. Le troisième malade est un pauvre bébé de trois ans tout au plus qui braille du haut de sa tête; il n'est pas moins couché sur le tapis et piétiné par le derviche, très prudemment, je dois le dire, et avec les plus grandes précautions. Nous n'en avons pas vu davantage : la laideur du spectacle, l'atrocité du bruit et l'odeur de nègre échauffé nous décidèrent à partir au bout d'une heure et demie environ sans demander notre reste. En résumé, cet exercice religieux, s'il n'est pas des plus ragoûtants, ne doit point être confondu avec la jonglerie funambulesque des Aissaouas. C'est un ensemble de pratiques grossières, malsaines, abrutissantes, que les musulmans éclairés tiennent en médiocre estime et qu'Ibrahim-Pacha avait raison d'interdire aux soldats égyptiens sous les peines les plus sévères. Cependant, faut-il l'avouer? cette débauche du fanatisme musulman ne nous a pas laissés indifférents et nous éprouvions autre chose que du mépris devant cette somme effrayante d'énergie mal employée. Un des nombreux vapeurs qui parcourent le Bosphore en tous sens nous transporta au pont de Galata. Je fis encore un tour dans Stamboul, j'assistai à un coucher de soleil où le profil de la ville turque, esquissé en gris sur le ciel, réveilla ma vieille admiration pour Ziem, et je rentrai à Péra par la ficelle. C'est un petit chemin de fer souterrain où deux trains se croisent régulièrement toutes les cinq minutes, la descente de l'un faisant monter l'autre. On ne voyage pas autrement entre la Croix-Rousse et Lyon. La soirée et la nuit furent belles ; on put grimper à la tour de Galata et voir d'un seul coup d'œil la Corne d'Or et le Bosphore illuminés en l'honneur de la fête du lendemain.
***
VIII
[Kurban Bayrami, la prière du sultan]
Cette fête du Gourbam-Beïram nous inspirait à tous une assez vive curiosité. Les Belges, nos amis, avaient obtenu, par l'entremise de leur légation, six places de tribune dans le splendide hall de Dolma-Bagtché, où le sultan devait recevoir les diplomates étrangers et les grands dignitaires de l'État. Les autres, moins ambitieux ou moins favorisés, se promettaient au moins de voir défiler le cortège impérial, dont la magnificence est légendaire. Mais rien n'est simple dans ce pays ; il faut intriguer pour savoir quel sera le jour de la fête, et d'habitude on ne le sait positivement que la veille. Il faut intriguer sur nouveaux frais pour connaître le nom de la mosquée qui recevra la visite du sultan. Les précautions dont on entoure sa personne sacrée réduisent ses promenades au strict nécessaire. Aujourd'hui, par exemple, il a quitté sa résidence de Yeldiz-Kiosk [Yıldız köşk], traversé son parc en voiture, fait un petit bout de chemin dans la rue pour atteindre une mosquée des plus modestes et des moins connues, et, sa prière faite, il a gagné à cheval, en quelques minutes, le palais de Dolma-Bagtché. Le chemin qu'il a suivi était exclusivement bordé de soldats, et toutes les rues adjacentes barrées par la cavalerie. Ajoutez que les curieux n'ont pas ici, comme à Paris, la ressource de louer une fenêtre : tous les étages supérieurs des maisons sont hermétiquement clos par ordonnance de police. Nous nous sommes mis en route à six heures du matin, nous avons longé des casernes, des casernes et encore des casernes, jusqu'à la rue où tous les habitants de ces casernes étaient rangés le sabre au poing ou l'arme au pied. Nous sommes descendus de voiture entre deux haies de fantassins, tous esclaves de la consigne et fort peu disposés à nous ouvrir leurs rangs. Il a fallu que M. Weil fit des prodiges de souplesse et d'insinuation pour nous donner l'accès d'un petit café grec dont les fenêtres nous laissaient voir, entre les croupes des chevaux et les têtes de l'infanterie, fort peu de chose en vérité. L'attente fut assez longue, mais nous ne perdions pas notre temps. La rue était incessamment sillonnée par des voitures de gala, des généraux à cheval en grand uniforme, des musiques militaires. Une étroite ruelle qui s'ouvrait sur le côté de notre café était barrée par une demi-douzaine de Tcherkesses, bons cavaliers et soldats finis. A tout moment, des ordonnances, des cochers ou des valets de pied de grandes maisons forçaient leur ligne pour introduire et emmagasiner dans la ruelle, soit un cheval d'officier, soit une voiture, soit une paire de carrossiers dételés. Ils se prêtaient à tout sur l'ordre de leur chef avec une souplesse étonnante et se reformaient aussitôt. J'ai vu ce jour-là un bon lot de soldats turcs, et dans le nombre des gaillards vraiment pittoresques, comme les zouaves du Soudan. Tous ces hommes, sans exception, m'ont frappé par leur tenue, leur discipline, leur physionomie martiale. Je comprends que les Roumains et les Russes victorieux en parlent avec tant d'estime. Un des traits caractéristiques de cette armée est qu'elle compte beaucoup d'hommes faits, de vieux soldats, de sous-officiers émérites. Hélas! faut-il venir si loin de France pour retrouver le grognard de trente ans, ce type éminemment français !
[Arrivée du sultan à la mosquée]
Une immense acclamation, accompagnée d'un déchaînement de musique, nous annonce l'arrivée du sultan. Tout ce que j'en ai distingué, c'est un carrosse magnifique conduit par un cocher rouge et or. Non loin de là, devant la mosquée, un obligeant voisin me montre des féredjés de soie et de jolis enfants dans des voitures dételées : c'est la famille du sultan. Je me suis fait traduire les acclamations qui tout à l'heure ont salué le passage d'Abd-ul-Medjid. Les soldats ont crié littéralement : « Qu'il vive beaucoup ! » Et une autre voix, la voix de l'esclave romain qui suivait le char de triomphe : « Ne t'enivre point de ta gloire et songe que Dieu est bien plus grand que toi ! » Mais le commandeur des croyants, l'héritier des khalifes, a fini sa prière; il est sorti de la mosquée et il passe devant nous, grave, un peu triste, sur un magnifique cheval blanc. Il répond aux vivais de ses soldats par le salut militaire. Sa figure, plus allongée que je ne supposais et plus conforme au type persan qu'au type turc, est d'une régularité parfaite; il a le geste noble et l'air majestueux. On me montre le grand vizir Saïd Pacha, qui n'est pas beau de la même façon que son auguste maître, il s'en faut de tout; mais l'intelligence, le travail et la volonté se lisent à livre ouvert sur cette physionomie d'honnête homme. Je ne suis pas bien sûr d'avoir vu l'illustre Osman-Ghazi-Pacha, et je le regrette sincèrement; mais j'ai vu le cheikh-ul-islam, chef de la religion, ou plutôt cardinal-vicaire du sultan qui est pape dans son empire, et même hors de son empire, dans l'extrême Orient, en Afrique, partout où le Koran résume la foi et la loi. Les curieux remarquaient aussi un cavalier gros comme le poing et affublé d'un costume de général. C'est le bouffon du sultan et très probablement le dernier fou en titre d'office dont il sera fait mention dans l'Almanach de Gotha. Le cortège impérial est vraiment beau ; je n'ai qu'un reproche à lui faire ; c'est qu'il a passé devant nous comme un tourbillon, sans nous laisser le temps d'admirer. Quelques chercheurs de petite bête assurent que, même dans ces splendeurs, le laisser aller propre au Turc se trahit par certaines négligences de détail. Ils ont remarqué, par exemple, d'admirables chevaux du Nedj qui avaient la gourmette rouillée et des harnais dorés à l'or fin qui laissaient voir un peu de bourre; mais. Dieu merci! je n'ai pas d'assez bons yeux pour perdre toute illusion. Aussitôt que la route est un peu déblayée, nous sortons de notre cabaret et nous courons reprendre nos voitures. Le retour est fort gai : nous rencontrons à chaque instant, dans des coupés ou des landaus bien attelés, des femmes élégantes, fort jolies dans le peu qu'on en voit, et que le krach dont nous parlions hier n'a certainement pas atteintes ni même effleurées. Il parait qu'un récent édit du sultan met aux abois ces gazelles aux grands yeux peints. Le maître a décidé qu'elles remplaceraient leur voile transparent par dès voiles sérieux. Ce serait en vérité grand dommage, car le yachmak, tel qu'on le porte aujourd'hui , donne une satisfaction raisonnable au passé sans assombrir le présent; il embellit même les jolies Circassiennes, et généreusement toutes les Turques, en allongeant leur aimable visage, que la nature a fait un peu trop large et trop court. Un concert de protestations s'élèvent déjà de tous côtés contre la nouvelle loi somptuaire. Ce n'est pas seulement le beau sexe qui réclame ; on compte dans l'empire ottoman soixante-dix mille fabricants de yackmaks qui ne se laisseront pas ruiner sans crier, et Abd-ul-Hamid n'est pas sourd aux doléances de ses sujets.
L'infatigable organisateur de nos plaisirs, M. Weil, ne veut pas que nous quittions ce pays sans avoir goûté aux douceurs de la villégiature. Un déjeuner nous attend à Thérapia, sur la côte d'Europe, au milieu des palais et des villas du monde diplomatique et de la haute finance. Il est dit qu'en sortant de table nous irons fumer un cigare aux Eaux-Douces d'Asie. Les bateaux à vapeur du Bosphore vont partout et font constamment la navette entre les diverses échelles.
Thérapia ne perd pas trop à être admiré de tout près ; la cuisine de l'hôtel d'Angleterre et son vin plat de Roumélie sont supportables. Les petits stationnaires des ambassades, dont un seul, le nôtre, a le droit d'avoir sa planche à terre, animent et égayent le paysage. Le palais de France a grand air entre le quai et un vaste jardin plein de vieux arbres et de fiers rochers. Le marquis de Noailles ne doit pas regretter trop amèrement ici l'admirable château de ses pères et les beautés classiques du parc de Maintenon. Malheureusement l'homme, ou du moins le Français, ne sait jouir de rien sous la pluie; cette infirmité de notre race donne aux citoyens d'Angleterre un notable avantage sur nous. Arrivés à Thérapia par un temps assez morne, nous avons été légèrement mouillés avant de nous asseoir à table ; puis le ciel a paru se remettre, et nous sommes partis à pied pour l'échelle de Buyukdere, où nous espérions prendre le bateau qui touche à Beïcos en Asie. Mais nous n'étions pas encore à cinq cents mètres de l'ambassade d'Angleterre qu'un vrai déluge s'est abattu sur nous. Le ciel fondait en eau ; la pluie criblait la mer, aussi calme que le lac d'Enghien en juillet. Bon gré mal gré, il fallut revenir sur nos pas, rentrer à l'hôtel et retourner piteusement à Constantinople par le vapeur qui nous avait amenés ; mais le climat est si capricieux dans ce pays que nous trouvons le ciel bleu et la mer houleuse en rentrant à Constantinople. L'averse a été pour nous seuls ; il n'a pas plu en ville de la journée.
Grande fête le soir à notre hôtel. Le patron, M. Flament, a profité de notre passage pour faire baptiser son dernier enfant, qui est une fillette de six mois; elle s'appellera Léopoldine, en l'honneur du roi des Belges, qui s'intéresse à la Compagnie des wagons-lits, encourage toutes les œuvres de progrès et jette noblement les millions de sa cassette particulière dans l'entreprise internationale du Congo. Le parrain est M. Mathieu-Delloye et la marraine Mme Von Scala. On boit force vin de Champagne à la santé de l'enfant, qui s'excuse par interprète de ne pas rendre toast pour toast, les gobelets dont elle a coutume de se servir ne figurant pas sur la table.
[Karagöz]
Nous devions couronner la fête par une représentation de Karagheuz [Karagöz] et par un ballet de tziganes. Les tziganes ont fait défaut, soit que la police turque ait été une fois par hasard en veine de puritanisme, soit plutôt, je le crains, parce que les intermédiaires auront fait des conditions inacceptables. Mais Karagheuz nous a donné la comédie dans un cabaret de Péra frété ad hoc. Ce personnage est un guignol excessivement libre, une impudente ombre chinoise qui de tout temps a eu le privilège d'égayer non seulement les hommes, mais les femmes, les gamins et les petites filles, durant les nuits du Rhamadan. Mais nous ne sommes pas en Rhamadan, et la grosse gaieté de Karagheuz se réserve pour des temps meilleurs. Peut-être aussi n'a-t-on pu nous offrir qu'un Karagheuz de pacotille; le fait est qu'il nous a médiocrement amusés.
Le samedi 13 octobre était pour le gros de notre caravane le jour du départ, et déjà, pour quelques-uns d'entre nous, le jour des adieux. M. de Blowitz ne voulait pas quitter Constantinople sans avoir obtenu une audience du sultan. Il s'était bouté en tête d'interviewer Abd-ul-Hamid, peut-être même de le décorer; et, pour mener à bonne fin ce projet qui n'allait pas tout seul, il avait mis sur pied l'ambassade de France, l'ambassade d'Angleterre, l'ambassade d'Italie, une bonne moitié du corps diplomatique. Nous allions donc le laisser là, et, avec lui, son secrétaire, le fils d'Ernest Daudet, qui nous avait tous charmés. Le jeune Tréfeu, du Gaulois, avait reçu de son journal une mission en Bulgarie; on l'envoyait à Sofia chez le prince de Battenberg, qui n'était pas sans avoir besoin de l'appui des journaux monarchiques. Cet aimable garçon se disposait à chevaucher trois ou quatre jours dans la boue; mais, comme il est aussi bon cavalier que mauvais marin, il était homme à entreprendre le voyage de Kéraban le Têtu plutôt que de passer à nouveau la mer Noire.