 Marie de Ujfalvy-Bourdon (née en 1845) accompagna son mari, le linguiste et explorateur Charles-Eugène Ujfalvy de Mezö Kösvesd (1842-1904) dans une expédition en Asie centrale et en fit le récit qui parut dans la revue "Le Tour du monde" en 1879.
Marie de Ujfalvy-Bourdon (née en 1845) accompagna son mari, le linguiste et explorateur Charles-Eugène Ujfalvy de Mezö Kösvesd (1842-1904) dans une expédition en Asie centrale et en fit le récit qui parut dans la revue "Le Tour du monde" en 1879.
Né à Vienne, Charles-Eugène Ujfalvy était de nationalité hongroise, mais francophone. Spécialiste des langues finno-ougriennes et de l'Asie centrale, il est envoyé en 1876, par le Ministère de l'instruction publique en Russie, dans les régions nouvellement conquises de l'Asie Centrale.
Sa femme l'accompagne alors et fera le récit de ce voyage, qui vient compléter les rapports écrits par son mari.
Il est rare à cette époque qu'une femme s'aventurât dans de si lointaines contrées, même pour accompagner son mari. C'est donc un témoignage plutôt exceptionnel, mais qui n'est pas exempt des préjugés de son temps.
Pendant ce voyage, les Ujfalvy rencontrèrent de nombreuses populations d'Asie centrale parlant des langues turciques : Kirghizes (le terme « Kirghize » désignait à cette époque les Kirghizes [Kyrgyzs] et les Kazakhs actuels), Ouzbeks, Karakalpaks… A noter le terme Sartes, une création de l'administration russe, qui désigne une partie des Kirghizes [Sergej Abašin, « « Les Sartes, un peuple d’avenir » : l’ethnographie et l’Empire au Turkestan russe », Cahiers d’Asie centrale [En ligne], 17/18 | 2009, mis en ligne le 26 mai 2010, consulté le 11 mars 2015. URL : http://asiecentrale.revues.org/1251 ].

LE TOUR DU MONDE 1879. NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES
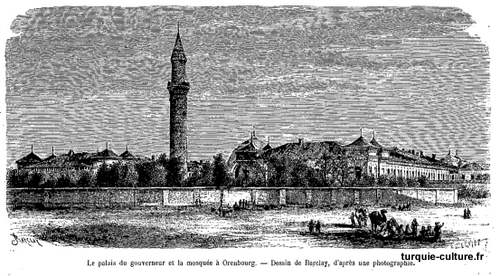
D'ORENBOURG A SAMARKAND. LE FERGHANAH, KOULDJA ET LA SIBÉRIE OCCIDENTALE. IMPRESSIONS DE VOYAGE D'UNE PARISIENNE
PAR MADAME MARIE DE UJFALVY-BOURDON.
1876-1878 – texte et dessins inédits
I Orenbourg – La Sacmara – Le quartier pauvre des Cosaques – Le marché – La mosquée – Visite chez le mollah – Le musicien bachkir – L'ex-khan de Khokand – Un sultan kirghise
Mon mari, M. de Ujfalvy, ayant été chargé par le ministre de l'instruction publique d'une mission pour la Russie, la Sibérie et l'Asie centrale, je résolus de le suivre notre départ de Paris fut fixé au 10 août 1876. Je ne dirai rien ici de notre voyage jusqu'à Moscou. Cet itinéraire est bien connu des lecteurs du Tour du Monde. Je les prie donc de partir de l'ancienne capitale de la Russie et de se transporter avec nous tout d'un trait en chemin de fer à Orenbourg.
Orenbourg est une ville de quarante mille habitants environ, située sur les confins de l'Europe et de l'Asie. Son aspect est assez agréable, ses maisons ont un air honnête. Un magasin, entre autres, frappa mes regards ; il est situé dans la belle grande rue d'Orenbourg et porte en français l'inscription « Soieries de Lyon ». Cette enseigne, égarée au milieu d'une population de Kirghises, de Bachkirs et de Tatars, était bien faite pour surprendre et intéresser une Parisienne.
Du haut d'une espèce de terrasse, on voit se dérouler à ses pieds la Sacmara, rivière qui se jette dans l'Oural, séparant majestueusement l'Europe et l'Asie. Au loin s'étendent les steppes ! Sur le bord de la rivière, opposé à la terrasse, s'élèvent des arbres et de jolies maisons de campagne à demi submergées au printemps par la débâcle ; elles sont ravissantes en été. Nous nous sommes arrêtés quelque temps pour jouir de ce beau spectacle derrière nous l'Europe, en face de nous l'Asie
Du côté de l'Europe la rivière est bordée de misérables cabanes échafaudées de manière à ne pas être envahies par les hautes eaux. C'est le quartier pauvre des Cosaques. Chaque Cosaque doit avoir au service de la Russie un habillement et un cheval. Aucune femme de cette race ne se résigne à la domesticité ; lui offrît-on l'emploi de femme de chambre, elle refuserait et aimerait mieux mourir de faim. Le ménavoï dwor, grand marché du commerce limitrophe est le plus curieux spectacle d'Orenbourg. Nous nous y rendîmes en traîneau. Le froid était si vif que je dus me plonger la figure dans mon manchon ; la curiosité seule me décidait à laisser un peu de jour pour mes yeux. Nous nous engageâmes bravement dans la le tumulte était complet ; c'était une tour de Babel en raccourci; j'entends que toutes les langues et quelles langues, juste ciel ! s’entremêlaient, s'entre-croisaient, déroutaient l'attention, chacun voulant crier et vanter sa marchandise plus fort que son voisin. Ainsi que le langage, le costume était des plus variés ; on y frôlait la longue robe du Tatar, le manteau fourré du Kirghise, le khalat (caftan) ouaté du Sarte ; le tout surmonté des coiffures les plus diverses, depuis le bonnet pointu garni de fourrures du Bachkir jusqu'au turban du marchand boukharien. Nous avancions toujours dans cet immense caravansérail que je renonce à décrire en détail. Les objets d'art n'y tenaient pas la plus grande place, loin de là. C'est en effet au marché surtout qu'on apprécie la part léonine des besoins matériels et l'impérieuse revendication des exigences de l'estomac. Mais, si banal qu'il soit, le spectacle devient grandiose dans cette ville frontière, marché européen et asiatique à la fois, où l'on a comme le pressentiment d'un monde rajeuni qui fermente pour une nouvelle existence. Quels sont les instincts dominants de cette foule ? Quelle idée commune agite ces têtes ? Un sentiment général fait-il battre ces coeurs ? Cette avant-garde, derrière laquelle on devine des hordes immenses, descendra-t-elle encore un jour vers l'Occident ? Ces énigmes nuageuses, qui se présentaient à mon imagination, étaient condensées par un froid de vingt-six degrés Réaumur. A sept heures du soir on me conduisit, en compagnie, de Mme L. fille du gouverneur général d'Orenbourg, à la mosquée que nous avait déjà annoncée la tour élancée de son minaret d'où le mollah parle à la lune et crie cinq fois par jour les heures de la prière. Elle était éclairée pour notre visite et tous ses vitraux resplendissaient. L'édifice est une réduction des mosquées de Constantinople, cylindrique, avec une coupole dont les parois sont gracieusement sculptées. Les murs sont en marbre et couverts d'inscriptions en lettres d'or tirées du Coran. Elle a été bâtie en 1840. Le mollah nous souhaita la bienvenue et un heureux voyage et nous proposa de visiter sa demeure qui n'était qu'à deux pas de là. L'invitation. fut acceptée avec empressement. Un instant après, nous entrions dans un salon carré, meublé de chaises, d'un canapé, de coffres, d'une glace moderne et d'une nombreuse collection de coussins. Devant le canapé, une table était dressée pour le thé.

Notre hôte nous invita à visiter aussi son harem
"Comment, dit-il, ne montrerais-je pas il la fille de l'Étoile et à son illustre amie tout ce que je puis leur faire voir !": Il ouvrit une porte masquée par une tenture en toile blanche et nous fit pénétrer dans une autre chambre ; ici les meubles se réduisaient à des coussins et, près d'une muraille, à un grand lit, très-haut, semblable à ceux de nos paysans, mais totalement dépourvu de draps. Deux femmes charmantes vinrent nous saluer; nous leur tendîmes la main, ainsi qu'à une troisième, beaucoup plus âgée, la mère du mollah.
Près d'elles étaient deux enfants ; une fille et un garçon la fillette, âgée de huit ans, était remarquablement jolie de grands yeux noirs, le nez bien fait, le visage nuancé d'une expression de mélancolie ; elle paraissait avoir plus que son âge, avec sa longue robe garnie de fourrures, son collier de sequins et son petit bonnet à la napolitaine. Le petit garçon, bambin de quatre à cinq ans, était aussi laid que sa soeur était charmante.
Nous revînmes au salon, où notre hôte nous servit lui-même le thé et nous offrit un gâteau fait dans sa maison avec du miel et du riz ; il accompagna cette légère collation de fruits secs.
Nous montâmes le lendemain dans le minaret, à la suite d'un homme que j'appellerai le suisse de la mosquée. Il nous fit gravir un escalier assez raide, mais nous fûmes dédommagés au terme de notre ascension par un coup d'ail splendide à nos pieds la ville d'Orenbourg ; d'un côté l'Asie et les steppes perte de vue, de l'autre l'Europe où le railway qui nous avait amenés semblait avec son cordon de fer rattacher au monde occidental les solitudes du monde oriental. Si nous avions su gré au suisse de la mosquée de nous avoir mis en présence d'un tel spectacle, nous ne tardâmes pas à adresser d'autres remerciements, plus vifs, à un musulman d'origine tatare, M. Bektchourine, qui s'est fait la réputation de savant orientaliste. Voulant nous gratifier d'une sérénade à la mode locale, il fit venir un aveugle bachkir porteur d'une sorte de flûte façonnée avec un fragment de roseau de soixante à quatre-vingts centimètres de longueur. Cet étrange musicien tira de son étrange instrument des sons fort doux et nous fit entendre des airs nationaux d'une mélodie agréable, peu variée, il est vrai, mais d'un rhythme bien accentué; un de ces morceaux, entre autres, me frappa par sa tristesse. Je ne pouvais me lasser d'admirer le savoir-faire de cet homme qui pouvait tirer d'un bout de roseau des sons aussi mélodieux que ceux d'une véritable flûte. Quand il eut cessé de jouer, M. de Ujfalvy le gratifia d'un rouble; il le prit, le tâta, le glissa dans une de ses bottes, une singulière bourse, il faut en convenir renferma précieusement son bout de roseau dans un étui qui ressemblait à un parapluie chinois et se retira en compagnie de deux guides, Bachkirs comme lui, vieux comme lui, mais d'un type beaucoup moins beau que le sien.

Le personnage le plus curieux d'Orenbourg est Khoudaïar, ex-khan de Khokand, qui est interné dans cette ville; il nous fut impossible de régaler notre curiosité de la vue de cet ex-souverain ; il était souffrant. On nous assura que son mal n'avait trouvé de prise que sur ce que Xavier de Maistre appelle la Bête, le remords n'ayant pas trouvé chez lui une conscience à laquelle il pût s'attaquer. Pourtant ce Néron minuscule avait inventé d'abattre dix mille têtes en quelques jours pour mettre fin à la révolte de ses sujets. La Russie lui fait une pension viagère de quinze mille francs.
La servitude n'a rien adouci de sa férocité. Un beau soir à table, entre la poire et le fromage, tous les convives étant de bonne humeur, le khan les contemple quelques instants, semble réfléchir, et, trouvant sans doute ses voisins gras à point, il demande brusquement au gouverneur général « Pourriez-vous faire couper la tête à tous ces gens-là? » Cette question posée avec un flegme asiatique jette naturellement un froid dans l'animation du festin, on frémit involontairement sous le regard d'acier de ce tyran captif. Mon autorité, dit le gouverneur, ne va pas jusque-là. - Alors je vous plains! » Et il reprend sa posture indolente de félin au repos.
A la place de l'ex-souverain du Khokand nous eûmes la bonne fortune de faire la connaissance d'un sultan kirghise gros personnage resplendissant de parures et de santé, qui fut très-gracieux pour nous. Il paraissait franc et honnête et n'avait rien de cet air de perfide dissimulation qui, nous dit-on, caractérise Khoudaïar.
II Départ en traîneaux - La neige- L'Oural - Orsk - Les steppes - Irghis - Loups - Terekli - Le désert du Kara-Koum - Ak-Djoulpasse - Un aoul - Les Kirghises.
Le 8 février 1877, nous partons d'Orenbourg. Il serait difficile de dire tout ce que nous avons entassé dans nos traîneaux provisions, fourrures, lanterne à huile, bougies, torche même en prévision de la possibilité de nous égarer la nuit. Notre domcstique, Paul, loué à Saint-Pétersbourg,
est un Allemand des provinces baltiques: outre sa langue maternelle, il parle le russe, ce qui nous sera d'un grand secours.
Le froid était de vingt degrés; il neigeait un peu; à notre traîneau étaient attelés de vigoureux et durs chevaux de la steppe. Le chemin ne se reconnaissait qu'aux gerbes de paille ou aux fagots plantés de distance en distance sur l'immense nappe neigeuse. Le paysage, décoré de la sorte, était si monotone, que je me laissai aller à regarder presque constamment le mouvement des clochettes attachées à la douga, grand cercle de bois affectant la forme d'un fer aimanté et que portait notre cheval du milieu. De la neige, toujours de la neige, agrémentée de temps à autre par les fascines indicatrices. Nous en avions peut-être ainsi pour une vingtaine de jours.
La troisième journée fut rude. Le vent soulevait tant de neige que le soleil en était obscurci. Il fallut atteler cinq chevaux au traîneau. Notre pauvre guide eut une oreille gelée; elle pendait sanguinolente; il fallut le soigner et il s'y prêta de mauvaise grâce.
Les chevaux soufflent péniblement, nous montons dc plus en plus; ce doit être l'un des premiers versants de l'Oural. Les mamelons se rapprochent, et malgré le danger, le vent et le froid, nous contemplons émus le magnifique panorama qui se déroule à nos yeux; de gigantesques masses de granit sont ensevelies sous la neige ; dans un lointain brumeux nous distinguons des bosquets, des ravins, des vallées plus lointaines encore et des villages. Puissions-nous en atteindre un avant la nuit qui tombe Le chemin monte encore, les gorges se rétrécissent il arrive un moment où nous sommes obligés de descendre; la montagne est si haute, le passage si étroit, qu'un mouvement de recul des chevaux ou une glissade du traîneau nous précipiterait dans l’abîme. Mais peu à peu la descente commence, nous sommes sur l'autre versant de l'Oural, l'Asie est devant nous! Le paysage est plus gracieux, des bosquets ornent la route, des coqs de bois s'enfuient à notre approche.
Le jour suivant, nous franchissons la rivière de l'Oural sur une glace solide, et Orsk apparaît à nos yeux; un poteau blanc et noir marque la fin de l'Europe et le commencement de l'Asie administrative. Orsk est un marché renommé et un centre de transit commercial pour Orenbourg.
Nous entrons ensuite dans les steppes, les vraies steppes kirghises. On ne voit plus rien à l'horizon; de loin, on dirait la mer.
Nous rencontrons de nombreuses caravanes de chameaux conduits par des Kirghises coiffés de leurs sempiternels bonnets. Les villages, tapis sous la neige, ne laissent voir de leurs habitations que juste ce qu'il faut pour être aperçus.
De station en station, et par des chemins défoncés, nous atteignons Irghis, où se trouve une garnison russe. Cette petite ville a quelques maisons bâties sur une hauteur. A son entrée elle est décorée de bouquets d'arbres si maigres, si qu'ils semblent tout honteux d'avoir grandi au milieu dc ces déserts. Le lendemain, l'éternelle monotonie de la route est égayée par l'apparition des loups; de beaux loups, grands comme des poulains et très-intelligents, ma foi; car ils se doutent que leur peau est convoitée et se tiennent obstinément hors de la portée des carabines.
Bientôt les loups eux-mêmes disparaissent et nous retrouvons l'immensité du désert. Plus rien à l'horizon; nos chevaux semblent impatients de cette solitude et avancent, bride abattue, à travers une interminable steppe de huit lieues de longueur qui se termine à Terékli, sur la frontière du Turkestan. Depuis Orenhourg les stations étaient bâties en bois; à partir de Terékli, elles seront construites en terre avec des toits plats.
Nous franchissons le désert du Kara-Koum (sable noir). La route est parsemée d'ossements; les chameaux ont tracé avec leurs pauvres carcasses le chemin des caravanes.
Nous passons une nuit et un jour à Ak-Djoulpasse, station située sur les bords de la mer d'Aral. La mer inerte sous l'étreinte de l'hiver a l'aspect d'une vaste nappe de glace.
Le lendemain, mon mari se rend dans un aoul (village) kirghise pour visiter l'intérieur des tentes en feutre et y faire des mensurations anthropologiques. Chaque Kirghise, homme et femme, qui veut bien se prêter à cette inoffensive expérience, reçoit une petite gratification. Aussi, lors de notre départ, ces braves Kirghises nous font la conduite à cheval. Nous voilà tout fiers d'une si belle escorte, mais le chef de la poste tempère notre orgueil en nous racontant la conversation qu'il a eue avec un de nos gardes d'honneur. "Je n'ai, disait-il, en parlant de M. de Ujfalvy, jamais vu d'homme aussi sot que ce seigneur qui nous donne de l'argent pour nous tâter la tête." Le fait est que l'objet de l'expérimentation était d'une malpropreté dégoûtante.
Les Kirghises, dont les moeurs ont été si admirablement décrites par Mme Atkinson, se subdivisent en six hordes
1° Les Kara-Kirghises dans le Sémirétché (province des sept rivières), dans le Ferghanah et sur une partie du fameux plateau de Pamir.
2° La grande horde (oulou djouse) dans le Turkestan,
3° La moyenne horde (kourtou djouse) dans les gouvernements de Sémipalatinsk et d'Akmollinsk de la Sibéric occidentale.
4. La petite horde (ktché djouse) dans les gouvernements d'Orenhourg, d'Oural et de Tourgaï, et dans les environs de la mer d'Aral. C'est la plus nombreuse.
5° La horde de Boukéï, près de la mer Caspienne, dans le gouvernement d'Astrakhan, dans la Russie d'Europe (depuis 1801 seulement).
6° Les Kirghises de la Chine occidentale, quelques familles qui se sont détachées à différentes occasions de ces diverses hordes.
La première horde s'appelle Kirghise, les autres communément Kazaks ou Kaïzaks. Mais, au fond, c'est le même peuple. Ils parlent la même langue, ils présentent le même type et ils ont les mêmes mœurs, les mêmes usages, jusqu'aux mêmes superstitions. Les Kara-Kirghises sont les nomades des montagnes, les autres ceux de la plaine.
Au physique, les Kirghises sont d'une taille ordinaire; ils ont le visage carré, les pommettes saillantes, les yeux relevés aux coins, la bouche grande et les dents d'une blancheur incomparable. Les femmes ont des prunelles qui brillent comme des escarboucles. Leur torse est carré, les mains et les pieds sont très petits, les parties nues de la peau sont hâlées et les parties couvertes au contraire très-blanches. Au moral le Kirghise est sympathique, il est franc, honnête; on peut voir une entière confiance dans sa parole il est bien supérieur aux Sartes habitants des villes de l'Asie centrale. Quand un marchand russe envoie des marchandises à Khiva ou à Boukhara, il les confie de préférence à des Kirghises, car il est sûr qu'elles arriveront à bon port s'il n'y a pas impossibilité matérielle. Depuis que les Russes ont anéanti pour toujours les hordes turcomanes qui venaient infester la steppe jusqu'au nord de la mer d'Aral, les Kirghises vaquent paisiblement à leurs affaires, le commerce se fait en toute sécurité, et tout le monde est satisfait du nouvel ordre de choses. Ils sont musulmans, mais musulmans assez tièdes, et leurs femmes sortent toujours visage découvert; elles montent admirablement à cheval.
Nous repartîmes le surlendemain par un temps superbe, non plus en traîneau, la neige avait disparu, mais en tarantasse, Quel instrument de martyre !
III DE KAZALINSK A TURKESTAN. Kazalinsk. Le Syr-Daria - Ruines - Une kibitka - Intérieur kirghise - Mœurs - En route sur un fleuve glacé - Cimetières - Perofski - Tigres et faisans - Lait jaune - Inondations - Turkestan - La mosquée Hazret - Le bazar.
Un petit fortin, posté en éclaireur pour un corps d'armée, et d'énormes moulins à vent qui tournaient à cœur joie nous annoncèrent l'approche de Kazalinsk. Les premières maisons que nous apercevons sont gentilles et attestent un certain bien-être; elles sont ornées de petites terrasses travaillées à jour. Une maison nous fut offerte avec une bonne grâce charmante. Le major du district, d'origine française, mais qui ne parlait pas un mot de notre langue, mit (par l'entremise de son interprète) à notre disposition sa voiture et un soldat.
Nous en profitâmes pour parcourir la ville et admirer le Syr-Daria dont la glace brillait comme un miroir. La ville, quoique forteresse, ressemble un peu à un de nos grands villages; les maisons sont toutes en briques séchées au soleil; quelques-unes possèdent des jardins, si l'on peut appeler ainsi des groupes d'arbres ressemblant à des manches à balai; les rues sont malpropres, sans trottoirs, bien entendu et la voirie y est abandonnée aux caprices du temps. Il y a un seul joli monument, le Club, en style oriental. Après avoir,franchi le Syr-Daria sur la glace, nous arrivons en vue d'un vaste emplacement jonché de briques; ce sont les ruines de Djanekend, situées à trente-huit kilomètres de Kazalinsk.
A ce moment un kirghise à cheval vint à notre rencontre et nous pria de visiter sa kibitka. On sait que la kibitka est une tente de feutre qui a pour carcasse un treillage de bois cylindrique formant au sommet un dôme un peu aplati et percé d'un trou pour laisser passer la fumée. Le feutre qui enveloppe cette sorte de tonnelle préserve du froid, de la chaleur, de la pluie et de la neige.
La kibitka où nous entrâmes était très-propre et très-grande; de beaux tapis couvraient le sol; pour meubles il y avait des coffrets incrustés d'argent; de chaises, il n'en était pas question, puisque les musulmans s'asseyent à la façon des tailleurs. Nous n'y trouvâmes qu'une jeune femme avec sa mère, mais son seigneur et maître se proposait d'en prendre une autre. Mon mari lui ayant fait observer qu'il pouvait bien se contenter de celle qu'il avait, il répondit qu'il aurait une autre femme au printemps prochain, et une autre femme au printemps d'ensuite. Question de printemps, paraît-il. Pourtant la jeune femme du printemps dernier était charmante et surtout très propre ; elle nous montra son fils qu'elle nourrissait tout en se préoccupant de lui rabattre les oreilles pour le mettre à la mode du pays. Cette opération est justifiée par la croyance que l'ouïe en devient plus subtile.
Ce chef kirghise nous offrit le thé, qu'on nous servit dans deux bols accompagnés de deux cuillers présentées sur un coffret en métal avec une espèce de petite serviette; les autres personnes burent leur thé dans des bols et sans cuiller la femme seule ne prit rien.
Pendant que nous nous désaltérions, l'enfant vint à crier; la mère, le prenant d'une main par une jambe, le tint au-dessus d'un seau d'eau et, de l'autre main, versa sur le pauvre petit de l'eau toute froide; elle le remit ensuite dans le berceau, l'enfant avait cessé de pleurer.
Chez les Kirghises nomades, les femmes font tout, soignent même les chevaux; les hommes restent absolument oisifs. Véritable politique d'équilibre; de cette manière le ménage va toujours bien; une dispute est-elle possible quand l'un a tous les droits, l'autre tous les devoirs? Chez les Sartes (habitants des villes de l'Asie centrale) c'est tout le contraire, les femmes ne s'occupent que de leur toilette, ne s'abaissent pas aux soins du ménage, qu'elles abandonnent à leurs serviteurs; le mari n'est que le serviteur en chef, il tient le balai, brode et coud.
Les Kirghises riches se distinguent assez, au point de vue du costume du moins, des Kirghises pauvres. Ils sont aussi plus propres et plus soignés dans leur toilette.
Le gouvernement a eu soin d'abolir les bamanta, (guerre qui éclatait à chaque moment entre les familles d'une même tribu), et d'imposer la vaccination pour mettre fin aux cruelles épidémies de petite vérole qui décimaient chaque année ces nomades. Depuis cette double mesure la population augmente, mais aussi la misère. L'élevage ne suffit plus à leur existence, et de nombreuses familles sont obligées de s'adonner à l'agriculture pour pouvoir subsister. Il se produit donc le curieux spectacle d'un peuple chez lequel l'état d'agriculteur est un signe de misère et de décadence. Le Kirghise est né nomade, il l'a été depuis les temps les plus reculés, quand Rubrequis et Plan Carpin ont visité ce pays; en se faisant agriculteur et sédentaire il se transforme, il est sarte. Au lieu de monter dans l'échelle de la civilisation humaine, il descend, il perd sa franchise et son honnêteté et il devient rapidement lâche, cruel et dissimulé, défauts qui caractérisent la population sédentaire et agricole de l'Asie centrale.
Il fallait prendre congé de nos hôtes, dont l'hospitalité toute kirghise nous enchanta; elle était faite avec tant de bonne grâce, malgré le calme et la froideur inséparables du caractère musulman, que nous aurions-été mal venus de nous en plaindre.
En sortant de Kazalinsk nous suivîmes le cours du Syr, ravissant d'un bout à l'autre avec ses nombreuses petites îles et ses pittoresques kibitkas. Nous fîmes toute une étape sur le fleuve gelé, où notre voiture roulait admirablement.
Le fleuve est quelquefois si large qu'on en discerne à peine à la fois les deux rives. Des troupeaux paissent çà et là, et mangent les racines qui sont restées dans la terre.
Les stations sont meilleures, et, quoique bâties en terre, elles ont au moins deux chambres pour recevoir les voyageurs; les portes et les fenêtres sont ornées de rideaux; des divans en terre sont appuyés au mur et offrent un lit supportable quand ils sont doublés de matelas; je me hâte d'ajouter qu'il ne faut pas être douillette. Nous avons quelquefois du lait et des œufs. De droite et de gauche nous apercevons des cimetières assez curieux. Ils ne sont pas fermés; les tombes des riches ont une espèce de portique carré avec une entrée au milieu; elles sont plus ou moins grandes, plus ou moins travaillées, mais toutes en terre séchée au soleil. Dans l'un de ces cimetières, les portiques supérieurs étaient travaillés à jour avec des colonnades, témoignage du goût architectural de ces peuples.
Avant d'arriver à Perofski, petite ville dans le genre de Kazalinsk, le paysage s'égaya de plus en plus. Nous rencontrâmes quantité de Kirghises nomades, les femmes avec leurs enfants et les hommes montés sur leurs chameaux attachés les uns aux autres par les naseaux, celui de derrière chargé de la kibitka, cette maison portative de la famille. Les femmes marchaient à pied et conduisaient les bètes, tandis que leurs maris se prélassaient à cheval.
Nous avons été obligés de quitter le Syr-Daria pour contourner un marécage qui va depuis le fort Karmaktchi jusqu'à Perofski et qu'on appelle Bakali-kapa. Au milieu de ces marécages nous rencontrâmes un homme qui travaillait la terre; c'était le premier depuis que nous étions sortis d'Orenbourg.
A notre départ de Perofski, on nous raconta qu'à trente verstes de la ville on avait tué trois tigres dans la semaine. Le gouvernement russe donne vingt roubles par corps d'animal, laissant aux chasseurs la peau, qu'ils vendent dix roubles. Ce n'est pas cher pour une peau de tigre, car ces dix roubles, au cours du jour, n'équivalent qu'à vingt-cinq ou trente francs. Nous n'aperçûmes aucun de ces félins. En compensation, nous admirâmes nombre de beaux faisans. A une station, je bus pour la première fois un lait jaune clair, nuance produite sans doute par les herbes que les bestiaux mangent dans ces contrées. Cependant nous avancions cahin-caha d'une station à l'autre, lorsqu'il nous fallut compter avec les inondations. Un starosta nous prévint qu'à vingt verstes environ il y avait tant d'eau qu'il faudrait envoyer un de nos yemchiks à la prochaine station pour y chercher du renfort.
En effet, au bout d'un ravin qu'on avait pavé de bois et de paille, nous nous trouvâmes en face d'un lac improvisé. Après avoir tenté de le traverser, il nous fallut nous arrêter, et attendre jusqu'à une heure avancée du soir que l'on vint de notre dernière station avec des chevaux pour nous tirer de ce mauvais pas. Ce jour-là et le lendemain, nous passâmes devant plusieurs forteresses anciennes en terre, Séna-Kourgane, Yani-Kourgane, Saourane. Près de ces dernières ruines nous eûmes la malchance d'avoir à traverser une rivière à onze heures du soir, au mois de mars, à vingt kilomètres de la station. Enfin nous approchions de Turkestan. Le temps était superbe, nous pouvions admirer la belle montagne du Kara-taou avec ses pics couverts de neige. L'effet était vraiment merveilleux et nous dédommageait un peu de l'aspect monotone de ces éternelles steppes que nous avions retrouvées depuis Yani-Kourgane. Mais l'aspect de celles-ci était bien différent, on commençait à les voir verdir, et cette première végétation fut saluée par nous avec bonheur. Il y avait encore une rivière à traverser avant d'atteindre Turkestan. Nous y trouvâmes une foule de chameaux qui faisaient partie d'une immense caravane; des hommes nus jusqu'à la ceinture étaient dans l'eau, les excitant par leurs cris à traverser. Malgré leur haute taille, ces animaux en avaient jusqu'au poitrail. D'autres hommes nous firent monter sur une de ces énormes charrettes qu'on appelle arba; nos bagages y prirent ensuite place, et nous descendîmes la berge où un cavalier nous précéda dans la rivière pour nous secourir au besoin.
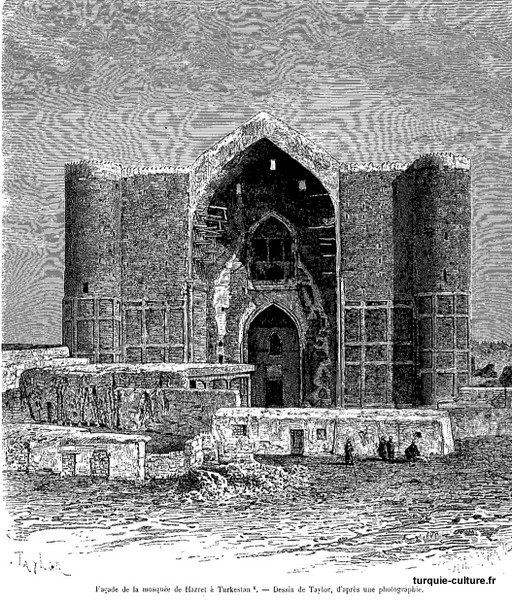
La merveille de Turkestan est la mosquée appelée Hazret : c'est une colossale basilique voûtée que flanquent deux superbes tours carrées. Quel effet cela devait produire quand tout était couvert de briques émaillées aux mille couleurs scintillant au soleil et dont les reflets entouraient cet ensemble d'une auréole brillante
Aujourd'hui, hélas! ces briques ont disparu en grande partie; il n'en reste que ce qu'il faut pour témoigner de la splendeur d'autrefois.
Nous entrâmes par une porte relativement petite si on la compare à l'immensité de l'édifice. Des mollahs de tout âge et des enfants étaient rangés des deux côtés de l'entrée. L'intérieur est, dans son genre, aussi beau que l'extérieur; c'est une grande salle carrée, surmontée d'une voûte sublime, découpée en cellules ornementées. L'architecture de la voûte, laissant filtrer de minces filets de lumière, est d'une harmonie de lignes remarquable. L'architecte de ce monument était à la fois un homme de génie et un homme de goût. Les grandes lignes sont d'une hardiesse inouïe, et les détails aussi sont traités avec une scrupuleuse attention. Au milieu de cette salle se dresse un énorme chaudron, destiné jadis par quelque fondation pieuse à préparer le repas des pèlerins. Devant cet appareil culinaire, du côté de la porte d'entrée, nous remarquons deux grands chandeliers de bronze. Le métal est ouvragé avec beaucoup d'art; on voit encore les traces d'une couche d'émail qui a dû certainement rehausser l'éclat de ces objets. C'est devant eux aujourd'hui que les Kirghises privés d'enfants sacrifient des moutons pour obtenir la perpétuation de leur famille.
Au fond de la salle nous apercevons une porte en bois sculpté; la sculpture est un vrai chef-d'œuvre, ainsi que la fermeture en métal ouvragé et émaillé. Cette porte conduit à une espèce de nef où repose le saint de l'endroit, Hazret ou Djassavi, au-dessus des cendres duquel Tamerlan avait fait élever en 1404, par un nommé Khodja-Houssein, natif de Chiraz en Perse, cette grande mosquée. Dans plusieurs petites pièces se dressent des pierres tombales recouvertes d'inscriptions; beaucoup sont sculptées avec un certain goût; la plus belle recouvre les restes d'un sultan kirghise. A côté s'élèvent des tumuli plus simples, et plus loin de petits amas de sable plantés de plumes. Aujourd'hui il faudrait des millions pour restaurer ce beau monüment; le moment n'est pas éloigné où il ne se survivra plus que dans un amas de ruines informes.
Tout près de la grande mosquée s'élève une mosquée plus petite consacrée à une des filles de Tamerlan c'est encore un élégant édifice recouvert aussi de belles briques en couleur.
1. Au moment où l'on commence à imprimer ces pages, nous recevons deux photographies qui représentent la mosquée Hazret nous en publierons les gravures dans une de nos prochaines livraisons.
Le bazar de Turkestan est bien fourni en objets du pays; nous achetâmes quelques curiosités, entre autres une couverture de cheval brodée au point de chaînette; les couleurs, quoique vives, sont harmonisées avec infiniment de goût.
Cet ornement recouvre le cheval de la fiancée kirghise lorsqu'elle se rend à la kibitka de son mari.
IV DE TURKESTAN A TACHKEND. Femme d'un chef de poste - Tchemkend - Tadjiks - Uzbegs - Sartes - Le Thiau-Chan - Tachkend - La prison - Le général Kaufmann - Anecdotes - Cruauté asiatique - Prestige de l'autorité - Le Tachkend sarte.
Après Turkestan, le premier grand village sarte que nous ayons traversé est Ikân; mais quelle différence avec nos villages animés par la vie extérieure de nos paysans. Ici tout est silence et tranquillité, hormis le bazar, composé de quelques baraques semblables à des écuries et où sont couchés quelques hommes qui nous regardent passer avec l'indifférence particuIière aux musulmans. Il nous sembla traverser des ruines.
La femme du chef de poste d'une station entre Turkestan et Tchemkend était Tatare comme son mari. C'est peut-être la première jolie musulmane que j'aie vue depuis mon départ d'Orenbourg. Elle était grande et élancée, avec des cheveux superbes, des traits agréables, un joli teint, mais surtout avec des yeux et des dents d'une beauté surprenante. Sa vaste robe de soie bleue à larges manches lui allait à ravir, et ses bottes pointues à dessins en cuir vert étaient fort originales. Mon mari me dit qu'elle doit être d'origine iranienne.
De Turkestan à Tchemkend, rien d'insolite, sinon les traversées de rivière auxquelles nous étions déjà habitués. Le plus périlleux de ces passages fut celui de l'Arisse, rivière comparable à la Marne et que la fonte des neiges avait considérablement grossie. n s'effectua à l'aide de l'arba.
Un soir, vers six heures, Tchemkend s'offrit à nos yeux tout entourée d'arbres. Des voyageurs indigènes, reconnaissables à leurs grandes robes et à leurs turbans, marchaient tranquillement au pas de leurs montures, les uns à cheval ou à âne, les autres à dos de chameau, dont ils paraissaient accepter les balancements avec une sorte de volupté. Ce mouvement inaccoutumé et l'aspect de poteaux télégraphiques nous réjouirent le coeur.
Tchemkend me parut assez jolie; le fort est situé sur une hauteur; les plantations lui font une ceinture de gazon dont le soleil à son déclin fonce le vert tendre et clair. Au jour, la ville présente un mélange d'habitations russes et orientales que fait resplendir le soleil déjà brûlant de ces pays en harmonisant leurs tons blancs et gris, la gaieté des uns corrigeant la tristesse des autres.
Tchemkend (la ville verte) est habitée par des Sartes et des Kirghises devenus sédentaires. On appelle Sarte en Asie centrale tout habitant d'une ville ou d'un village devenu sédentaire et agriculteur. Les Tadjiks, seuls d'origine persane ou iranienne, conservent cependant leur nom tadjik. Les plaines sont habitées par les Kirghises nomades et par les Uzbegs demi-nomades, tous deux de race turque. Les demi-nomades se distinguent des nomades en ce qu'ils ne voyagent qu'en été; en hiver ils habitent dans les villages.
Quand un Kirghise ou un Uzbeg se fixe dans une ville ou un village sarte, leurs descendants deviennent des Sartes. Les Tadjiks parlent un dialecte du persan et les Sartes le turc oriental.

A partir de Tchemkend le panorama devient tout autre sur notre gauche, le Thian-Ghau avec ses cimes glacées nous borne l'horizon; le terrain monte et descend à chaque instant, entrecoupé par des rivières et des ruisseaux où les bestiaux vont se désaltérer. La route étant très-mauvaise, par suite des pluies, notre yemchik se fraye un chemin sur les flancs de petites montagnes à pic.
Les stations se succèdent les unes aux autres; ce ne sont plus des maisons perdues dans le désert, elles sont entourées de villages. Enfin, après le passage d'un pont de bois, splendide en comparaison des autres, Tachkend apparaît à nos regards le soir du 14 mars, à quatre heures et demie.
La prison militaire est le premier édifice qui frappe nos regards; notre yemchik descend et attache la sonnette de notre voiture. Nous passons sous une porte bâtie en briques. La grande rue de la ville haute, bordée d'arbres des deux côtés, s'étend au loin devant nous; nous la traversons dans toute sa longueur. Çà et là, de jolies maisonnettes vertes, blanches rappellent les villas parisiennes. Nous prenons à droite une large avenue. Une église rose et blanche s'élève au milieu d'une belle place toute plantée d'arbres.
La voiture s’arrête devant une maison où mes yeux réjouis lisent en toutes lettres Restaurant - Hôtel Révillon. C'est un Français, c'est un compatriote qui vient nous recevoir. Avec quelle joie je saute de la voiture que de longtemps je ne serai plus obligée de reprendre !
La première visite de mon mari fut pour le gouverneur général du Turkestan le général Kaufmann, qui ne voulut pas entendre ses remerciements, le reçut d'une manière toute gracieuse et nous invita à dîner pour le lendemain.
Le lendemain, à cinq heures, sa voiture vint nous prendre. A notre arrivée au palais, le gouverneur général s'avança lui-même à ma rencontre dans l'antichambre; son aimable figure, ses manières courtoises me prévinrent en sa faveur.
Le diner fut servi dans une agréable et confortable salle à manger.
Le général nous raconta, entre autres anecdotes, une histoire qui montre encore combien est cruel le caractère de ces peuples d'Asie. Khoudaïar-khan, qui est en ce moment à Orenbourg, avait perdu son père à l'âge de quatorze ans. Avant de monter sur le trône, il resta sous les ordres d'un tuteur dont il redoutait l'usurpation. Quand il fut émancipé, le tuteur s'enfuit chez les Kirghises des montagnes. Comme la mère de Khoudaïar-Khan était Kirghise, que le tuteur était Sarte et que Kirghises et Sartes se détestent de la façon la plus cordiale, il fut facile à Khoudaïar de se faire livrer le fugitif avec six cents de ses partisans. Que faire de tous ces gens, sinon leur faire couper la tête ? C'est ce que fit Khoudaïar; mais, comme toute décapitation est un spectacle et par conséquent un plaisir, on fit durer ce plaisir le plus longtemps possible; les partisans de l'ex-tuteur furent décapités un à un, sous les yeux de leur chef. dont la tète fut abattue la dernière. Une pareille inauguration de la souveraineté montrait ce que devait être Khoudaïar; il se livra à tant d'excès que ses malheureux sujets subirent la conquête russe avec une sorte de satisfaction ; elle les débarrassait de leur oppresseur. Le prestige de l'autorité exerce une grande influence sur les peuples orientaux; le vice-empereur du Turkestan ne saurait s'en dépouiller. Vice-empereur, c'est bien le terme qui fit un jour demander par Alexandre II au général Kaufmann, alors en résidence à Saint-Pétersbourg « Est-il vrai qu'on t'appelle là-bas Yarim Padischah? Oui, sire. Et qu'est-ce que cela veut dire ? - Moitié d'empereur, sire. Ah! fit Alexandre, je voudrais bien savoir quelle moitié tu représentes. »
Un beau jour d'été, le général Kaufmann reçut à dîner un grand nombre d'officiers de retour d'une expédition dans la vallée de l'Alaï, aux environs du Pamir. On avait eu soin de donner à la montagne la plus élevée de la contrée nouvellement explorée le nom de « pic Kaufmann ». On dînait en plein air et les convives pouvaient rester couverts. Au potage, le général s'adressant à un jeune colonel du génie, lui dit : "Avez-vous rencontré des montagnes bien hautes dans l'Alaï? - Oui, Votre Haute Excellence. - Quelle est la montagne la plus élevée? demanda le général. - Le pic de Votre Haute Excellence, » réplique l'officier, debout, la main droite à son képi, la main gauche à la couture de son pantalon. Au relevé du potage, le général s'adresse de nouveau au colonel. Ces montagnes sont-elles en réalité si bien situées? Oui, Votre Haute Excellence. Où sont celles qui sont les mieux situées? - Autour du pic de Votre Haute Excellence, » répond l'officier, en se levant et en saluant de nouveau. Au rôti, le général lui demande pour la troisième fois : « Avez-vous vu beaucoup de neige dans la vallée de l'Alaï? - Oui, Votre Haute Excellence. Où avez-vous vu le plus de neige? Sur le pic de Votre Haute Excellence, » répondit l'officier, toujours en se levant et en posture militaire.
Le général cessa son interrogatoire car il voyait que le colonel aurait toujours trouvé moyen de le renvoyer sur le fameux pic de Sa Haute Excellence.
Le général Kaufmann, gouverneur du Turkestan, est un des premiers parmi les généraux russes; il est arrivé aux plus hauts grades et aux plus hautes dignités par son mérite personnel. Sa conquête de Khiva, pour ceux surtout qui connaissent la difficulté de ravitailler une armée au milieu du désert et par cela même d'y entretenir une grande quantité d'hommes, est une expédition extrêmement remarquable. Ses campagnes dans le district du Zerafchàn et ses dernières conquêtes dans le Ferghanah, qu'il fut obligé, dit-on, d'annexer au Turkestan, mirent le comble à sa réputation militaire. Aimé et estimé de l'empereur, qui lui avait confié le poste de gouverneur général de ces contrées, avec le droit de vie et de mort sur ses sujets et celui de déclarer la guerre et de faire la paix à sa volonté, il n'a jamais abusé de son pouvoir et a su se faire aimer de tous. Nous faisons de Tachkend notre quartier général, en
attendant que nous allions visiter Samarkand, la fameuse ville de Tamerlan, aussi sacrée pour les musulmans que Rome l'est pour les catholiques. Il s'agit maintenant de visiter le traditionnel Tachkend, qu'on appelle la vieille ville, et par un beau soleil nous nous mettons en route sur de bons et jolis chevaux.
Tachkend est composée de deux villes, la ville russe et la ville musulmane ou sarte; ce dernier nom est celui par lequel on la désigné. La ville russe est très-agréable; elle a de grandes et larges rues plantées de deux rangées d'arbres entre lesquelles coulent de profonds ruisseaux que l'on désigne sous le nom d'ariques. Comme il est peu de maisons qui n'aient leur jardin, elle ressemble à un immense parc. La végétation y est admirable et les arbres croissent avec une rapidité étonnante, grâce sans doute à la multiplicité des irrigations.
La maison du gouverneur général a peu d'apparence, parce qu'on l'a construite petit à petit en y ajoutant quelque appendice d'année en année. Mais l'intérieur en est vraiment splendide. Les salons, les serres, les chambres décorées à la manière du pays et embellies par des étoffes et des meubles européens en font un vrai palais. Le jardin, ouvert pendant l'été au public, est fort beau. La musique militaire y jette plusieurs fois par semaine.
Tachkend possède un grand nombre de magasins de toute espèce, dont plusieurs sont remarquables. La ville est éclairée la nuit au pétrole. Les scorpions, phalangides, tarentules sont une chose rare dans la ville russe, mais ils sont, en revanche, assez nombreux dans la ville sarte.
La ville sarte ressemble à toutes les autres cités musulmanes de l'Asie centrale. Les rues sont étroites, tortueuses et malpropres; les murs sont en argile couleur de terré, sans fenètres; à l'arrière des jardins sont plantés de grands arbres.
Le bazar est très-vaste et très-animé; tous les produits d'Asie centrale s'y trouvent réunis. Chaque rue du bazar est occupée par un genre particulier d'industrie, ce qui permet de s'orienter assez vite au milieu de ce dédale. Le tout est parsemé de boutiques où l'on boit le thé, dans une espèce de véranda couverte de tapis; dans d'autres, on vous rase la tète d'une façon assez primitive. Quelquefois des jeunes gens font entendre un chant qui frappe par sa monotonie des musiciens ambulants exécutent aussi des morceaux qui ne sont rien moins qu'harmonieux. Tout cela ne manque pas d'un certain caractère; mais il y règne une telle malpropreté, un tel sans-gêne, que toutes les illusions qu'on pourrait se faire sur le compte des Sartes sont bien vite dissipées. Quand nous eûmes tout vu, nous rentrâmes à la maison, en passant devant la forteresse, accablés de fatigue et brûlés par le soleil de l'Orient, déjà très chaud à cette époque. Que sera-ce donc en juillet?
V DE TACHKEND A SAMARKAND. La steppe de la Faim - Ondulations causées par le passage des tortues - Les montagnes, quel bonheur ! La porte de Tamerlan - A propos de poteaux - Nous retrouvons la dame au nez pointu - Une station meublée - Le Zérafchân - Un pont antique - Un fleuve à double fin.
Au moment de notre départ de Tachkend, le 14 avril, le temps était superbe, le soleil devint même très-brûlant vers le milieu du jour. La route, bien entretenue depuis Tachkend jusqu'au Syr-Daria, est assez agréable; elle a quelques ponts, privilège surprenant sur les autres routes du Turkestan. A droite et à gauche, se succèdent des habitations sartes uniformes et monotones; des hommes hâlés, nus jusqu'à la ceinture, bêchent ou labourent en fredonnant un air singulier dont la mélodie n'est pas à la portée d'une oreille européenne et dont les paroles sont toujours « Allah est Dieu et Mahomet est son prophète. » Sur les bords des ruisseaux et des ariques, des enfants bronzés, avec de grands yeux étonnés, se baignent ou jouent dans les roseaux. Leur costume ne les gène pas ; la plupart sont nus comme des vers, les plus scrupuleux sont vètus d'une simple chemise ouverte par devant et qui n'est pas longue à dépouiller. Chemin faisant, nous rencontrons beaucoup de cavaliers, souvent avec des femmes ayant quelquefois un enfant en croupe, familles kirghises à la recherche de pâturages meilleurs, juifs de Bokhara, bohémiens, derviches mendiants hissés sur des ânes, enfin quantité d'arbas chargées de toute espèce de marchandises. Dans l'après-midi, nous traversons la vieille ville de Djinase, fameuse par ses scorpions et ses tarentules; les Russes ont fondé une nouvelle cité à deux kilomètres et demi du Syr-Daria, avec un fort qui commande la vallée.
Le Syr-Daria se présente pour la deuxième fois à nos yeux; mais ici ce n'est plus une masse inerte et glacée, c'est un beau grand fleuve qui roule majestueusement ses eaux un peu jaunes. Deux bacs stationnent sur chaque rive, l'un en fer, l'autre en bois; nous nous embarquons sur le premier, et pêle-mêle avec nous, véhicule, chevaux, chameaux et nombre de voyageurs qui nous ont précédés. Je remarque même un petit âne qui goûte peu cette façon de voyager. Enfin, à partir de l'autre bord, nous entrons dans la steppe, après avoir passé près d'un petit lac marécageux ; ce désert fameux que les Russes ont appelé steppe de la Faim (Galodai steppe). A première vue, rien ne permet de s'expliquer cette sinistre dénomination; la steppe ressemble à un immense parterre de fleurs. Tantôt elle présente une teinte rougeâtre, tantôt un reflet mauve ou jaune d'or, selon que les tulipes ou d'autres charmantes fleurs dominent, c'est un tableau ravissant; nous admirons à coeur joie cette belle nature dont nous ignorions l'existence. Jamais steppe ne s'était offerte à nos yeux sous un aspect aussi séducteur, pour nous qui l'avions toujours trouvée couverte de neige et désolante dans son immensité. Elle venait de revêtir ses habits de fête et son horizon sans bornes se noyait dans une variété de couleurs dont l'oeil ne pouvait se rassasier.
Le soir, nous arrivons à la station de Malekskaia, désignée aussi sous le nom de station du Premier Puits. C'est une construction solide, flanquée de tours et parfaitement en état de supporter un siège; il y a là une petite garnison russe. Les chambres sont propres et leurs couchettes couvertes d'une toile cirée. Le lendemain, à six heures du matin, nous continuons notre route; la steppe est toujours aussi belle, mais elle a cependant changé de parure, sa beauté est devenue plus sévère. Une plante qui ressemble beaucoup à notre anis y étale son large feuillage et ses grandes fleurs jaunes disposées en grappes. Tout à coup le spectacle s'anime, la steppe parait se mouvoir comme la mer, les herbes ondoient, et cependant nous ne pouvons constater le plus léger zéphyr. Je donne à deviner en cent, en mille, la cause de ce mouvement. Ce sont des myriades de tortues qui se promènent en tous sens, enchantées de pouvoir chauffer leur carapace au soleil.
Dans l'air volent un grand nombre d'aigles, planant parfois si près de nous que nous entendons les battements de leurs ailes; ces grands corsaires, d'une couleur grise, brune, fauve, quelquefois blanchâtre, s'en viennent tout exprès des monts Célestes pour faire leur déjeuner d'une tortue.
Plus loin, la steppe est déjà brûlée par le soleil, la chaleur se fait sentir et une poussière épaisse rend le trajet désagréable. Nous longeons de petites mares sur le bord desquelles se promènent majestueusement d'énormes grues. Nous voyons aussi des oies sauvages couleur orange, une petite espèce de bécassine et des hochedueues, charmants, semblables à ceux qui se promènent dans les rues de Tachkend, comme les pigeons chez nous. Pour la première fois, à la station nous remarquons un caravansérail, seule oasis, encore: est-elle artificielle, que l'on rencontre dans ces contrées désolées dont la beauté est si vive le matin, et le soir s'évanouit déjà.
La station se trouve près d'un puits que, pour garantir des ardeurs du soleil, on entouré d'une bâtisse en briques très-haute et très-large, dont la forme ressemble à une immense cloche à fromage un peu pointue. Là les voyageurs peuvent abreuver leurs chevaux, quoique l'eau soit salée; quant à eux, s'ils veulent boire, ils doivent la faire bouillir occupation que remplissent sans aucune impatience de graves musulmans paisiblement couchés sur le sol en attendant que l'eau devienne potable.
Vers quatre heures, nous passons par la petite ville de Djizak; nous traversons le Sânzar, rivière qui vient du district du Zérafchân; enfin nous nous engageons dans les montagnes. Le pays change subitement d'aspect, il devient très-pittoresque; nous poussons un soupir de soulagement d'avoir quitté la steppe des heures chaudes et nous humons à grands traits l'air frais des montagnes. Un cours d'eau se présente à nous; ses méandres sont tellement nombreux que nous le traversons au moins huit ou dix fois avant d'arriver à la porte de Tamerlan, passage ainsi nommé parce qu'il eut l'honneur d’être frayé par ce grand conquérant.
La porte de Tamerlan! que de souvenirs évoque cet orifice de l'inondation humaine la plus dévastatrice que l'on ait jamais connue! Que de sang répandu dans ces vallées et dans ces plaines, maintenant si calmes, par ces conquérants à l'allure si inoffensive et dont la monture s'avançait d'un pas si paisible et si régulier
Sans remonter aussi loin, ces belles contrées ont été de nouveau ensanglantées par des scènes de carnage. Le même soleil a vu l'Occident prendre sa revanche sur ces inoffensifs cavaliers orientaux qui s'étaient encore une fois transformés en fougueux combattants; moins heureux que leurs ancêtres, leur valeur a dit céder aux armes supérieures de notre civilisation. Soudain la vallée se rétrécit et, des deux côtés de la route, deux immenses blocs de rochers se dressent à nos regards, séparés par un assez large espace. A gauche, une petite rivière baigne le pied de ce défilé; à droite, nous apercevons une pierre carrée
couverte d'inscriptions; elle semble comme encadrée dans ce roc gigantesque. Mon mari descend pour examiner de près les caractères qui sont tracés; personne n'a jamais pu les comprendre, et cependant beaucoup de savants ont déjà prétendu les avoir expliqués. Pendant que M. de Ujfalvy cherche à résoudre l'énigme du sphinx asiatique, j'admire ces puissantes portes que la nature semble avoir ouvertes là tout, exprès; plus hautes que larges, elles paraissent avoir eu souci de la perspective, car leurs masses informes sont en harmonie avec l'encadrement des montagnes; il semble que la nature ait voulu façonner à Tamerlan une, entrée en scène digne de ce formidable conquérant. De beaux aigles ont construit leurs nids sur ces hauteurs inaccessibles et planent fièrement au-dessus de nos tètes.
Après avoir contemplé les inscriptions, M. de Ujfalvy détache un cheval de la tarantasse, l'enfourche, traverse une petite, rivière sur notre gauche, met pied à terre et entre dans une excavation pratiquée à l'entrée de cet immense rocher. Il en ressort bientôt désappointé: cette caverne était sans profondeur et n'avait pas d'autre issue.
La porte de Tamerlan nous arrête quelque temps, et ce n'est pas sans effort que nous nous arrachons à celle contemplation pour continuer notre route. Sur les versants et sur le chemin nous voyons toujours beaucoup de tortues, mais surtout un nombre infini de belettes « ces dames au nez pointu .» sont jolies avec leur robe jaune et noire et leur désinvolture effrontée.
Nous passons la nuit à la station dé Saraï-Syk, située dans une délicieuse vallée bornée à droite par les monts Voudine, à gauche par les chaînes du Zérafchân, en arrière par les cimes neigeuses du Mouzabel; c'est un magnifique spectacle!
A cinq heures du matin, nous étions sur pied, et, le thé pris, nous partons avec le jour. Le temps est délicieux pour voyager; le soleil est couvert et ne transmet à travers les nuages qu'une tiède chaleur, qui nous pénètre sans nous brûler. La vallée est large, de gras et beaux bestiaux y paissent. Mais à l'horizon pas un arbre! moi qui les aime tant! Dieu sait si j'en aurais voulu voir dans ces éternelles steppes d'Orsk à Terekli En revanche, il m'est donné de contempler des poteaux en bois aux couleurs de la Russie, qui reposent sur un piédestal de maçonnerie assez originalement construit, indicateurs fidèles de chaque verste.
Je bénis le général Abramoff, ancien gouverneur de Samarkand. Ce haut fonctionnaire a du reste fait beaucoup pour son ancien gouvernement; aussi vient-il d'être nommé dans le Kokhand, qu'il saura, j'en suis aussi bien organiser que celui qu'il administrait auparavant.
Lorsque nous atteignîmes le plateau, nous nous trouvâmes presque subitement devant un assez grand fort situé près d'un pont, le premier pont de pierre que nous ayons trouvé dans l'Asie centrale. Il donne son nom à la station (Kaméni moste ou Tach-Kouprik).
Au départ de cette halte, le pays se transforme complètement. Voici de beaux jardins, des arbres, de petits kichlaks (villages) dont l'aspect toujours pauvre et délabré contraste avec la nature, qui s'embellit à vue d'oeil. Nous traversons les ruisseaux plus ou moins importants qui sillonnent ces parages; l'irrigation paraît fort bien entendue; nous avons sous les yeux des plantations de riz, d'orge, des terres labourées, le tout agrémenté de magnifiques arbres qu'on appelle Karagatches, espèce d'orme dont le bois est très-dur c'est le chêne du Turkestan. Au loin, dans les éclaircies de cette végétation, se dresse le mont Thian-Chan, dont la cime neigeuse est argentée de temps en temps par les faibles rayons du soleil. Son élévation augmente de plus en plus; quelquefois sa cime se dérobe à nos regards pour reparaître, derrière une chaîne de montagnes, encore plus fière et plus couverte de neige. Enfin, nous arrivons à la dernière station avant Samarkand réellement enivrés par le paysage. La route est d'ailleurs excellente et comparable à une véritable chaussée; elle me rappelle mes vieilles routes françaises. Quand on pense que toute cette région était couverte de marais, il faut constater que le travail d'assainissement exécuté en cinq ans par les Russes est assurément merveilleux; tout est leur ouvrage, hormis les grands et beaux arbres qu'ils ont su conserver et multiplier par d'autres plantations. La station de Djimbaï est la meilleure de toutes sans exception; elle est située sur une petite hauteur; un gentil escalier conduit à un beau vestibule; chaque voyageur a sa chambre séparée, précieux, inestimable avantage! et ces chambres ont des meubles! Le long d'une belle route le Zérafchân apparut à nos yeux en même temps qu'un pont antique (Chadmané-Melik) dont les voûtes encore debout attestent le génie d'un architecte oublié.
Les débris se dressent fièrement sur les revers de la.montagne; à leur pied le Zérafchân roule ses eaux, qui sont effectivement très-basses. Cette rivière prend sa source dans le glacier qui porte son nom; elle se dirige vers l'occident dans la plus grande partie de son cours supérieur. Depuis la ville de Pendjakend, à soixante verstes de Samarkand, où elle a déjà acquis tout son volume d'eau, elle suffit à l'irrigation de toute la vallée jusqu'à Boukhara. C'est par cette rivière que le général Kaufmann tient les Boukhariens en échec; il suffirait d'en détourner le cours pour réduire les habitants de Boukhara à la disette. On pourrait dire sans plaisanterie que cette rivière est une armée dont les habitants de Boukhara invoquent la présence et redoutent l'absence. Les montagnes qui l'encaissent sont connues sous les noms de monts du Turkestan, montagnes du Zénafchân et de Hissar.
En général, les affluents de cette rivière ne grossissent pas ses eaux ; ils sont tous détournés pour l'arrosage des champs et des vergers et surtout des jardins. L'homme a besoin de beaucoup d'eau dans ces régions où il ne pleut pas quelquefois pendant neuf mois de l'année ; aussi la présence de l'eau fluviale joue-t-elle un grand rôle dans la répartition des centres d'habitation. La rivière ou le ruisseau porte près de chaque village le nom du village, ou le village lui-même est baptisé du nom du cours d'eau. La fonte des neiges seule en grossit le volume. On pourrait presque dire que c'est un torrent car le Zérafchân roule avec une rapidité et un bruit effrayants, surtout au milieu des hautes montagnes bordées de précipices.
Zérafchân (le Segd du moyen âge) veut dire en persan Semeur d'or. Son nom est mérité, car il apporte avec lui la vie et la fertilité dans ce charmant vallon. Bientôt après, nous gravîmes une colline, laissant à notre gauche les hauteurs de Tehoupanc-Ala (le patron des bergers); à ce moment déjà les habitations, les jardins nous annonçaient Samarkand. Samarkand, la ville sainte par excellence, pour la conservation de laquelle l'émir de Boukhara aurait donné sa capitale; c'était le but tant désiré de notre voyage ; nous allions donc admirer ses anciennes splendeurs. La voiture, à mon gré, n'allait pas assez vite. Dans une rapide descente nous faillîmes écraser un musulman ; son flegme l'eût perdu, Mahomet le sauva. Chez les Romains, rencontrer ou écraser une souris, un rat, était un mauvais présage; mais on ne me dit pas, et pour cause, ce qu'il serait advenu de l'écrasement d'un musulman.
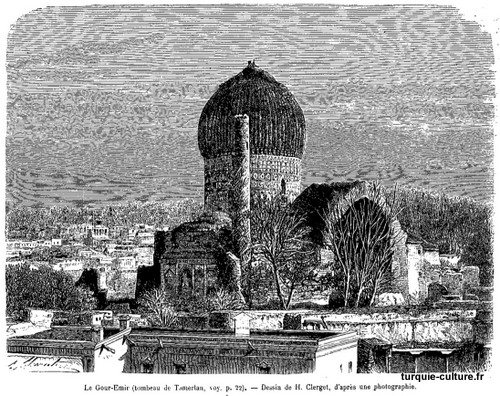
VI Entrée à Samarkand - La forteresse - Installation - La mosquée du Gour-Emir, tombeau de Tamerlan.
Nous n'étions pas encore revenus de cette alerte, que notre équipage faisait son entrée à Samarkand; la première place de la ville fut traversée avec une rapidité telle, que je ne pus qu'entrevoir les ruines d'une magnifique mosquée.
Nous arrivons au grand galop à la porte de la citadelle. Cette forteresse est devenue célèbre par la courageuse défense de quelques Russes qui, à bout de forces, furent dégagés grâce à un renfort envoyé par le général Kaufmann. Elle avait été en partie détruite, mais on l'a reconstruite de fond en comble sur l'ancien modèle.
Tout cela fut entrevu à la course car notre yemchik, fier sans doute de montrer son talent de cocher, nous enlevait au triple galop. Il nous conduisit ainsi à un appartement que le général Ivanoff, le nouveau gouverneur de Samarkand, avait eu l'amabilité de nous faire préparer. Ce pied-à-terre était meublé simplement, mais constituait une sorte de palais pour de pauvres voyageurs habitués depuis si longtemps à se contenter du strict nécessaire.
Mon mari se rendit de suite chez le gouverneur, malheureusement absent, puis chez le baron A. qui le reçut de la façon la plus aimable et nous convia pour le soir même.
La baronne A. est une toute jeune femme, mariée à peine depuis deux ans; elle nourrissait un bel enfant. Née en Suède, elle est, comme les Suédoises en général, grande et blonde. Elle et son mari nous offrirent une hospitalité presque paternelle; ils exigèrent, à notre corps défendant, que nous vinssions dîner et déjeuner tous les jours chez eux. Nous acceptâmes, et je dois ajouter qu'il nous aurait été difficile de faire autrement car aux hôtels, il n'y faut pas penser; il n'y en a pas même un, si mauvais soit-il. Le caravansérail suffit aux indigènes.
Ce caravansérail est une grande cour où l'on dépose toutes les marchandises destinées à la vente la cour est entourée de galeries couvertes sous lesquelles les voyageurs trouvent un abri de corps de garde; avec une couverture les indigènes s'y trouvent bien, mais on conviendra que pour un mois de séjour nous nous y serions habitués difficilement.
Le lendemain, le gouverneur Ivanoff nous invita à dîner. La maison qu'il habitait à Samarkand était vraiment confortable; les chambres en étaient grandes et belles, et, quoique cette résidence ne puisse rivaliser par son luxe avec celle du gouverneur général à Tachkend, l'extérieur en impose beaucoup plus. Le surlendemain de notre arrivée à Samarkand, et après que mon mari eut rendu visite à toutes les autorités russes, nous nous mimes en campagne pour visiter les célèbres mosquées de cette capitale religieuse de l'Asie centrale. Nous prîmes une voiture. Les routes ombragées que les Russes ont construites dans l'ancienne ville sont très-belles et parfaitement entretenues.
Nous visitons d'abord le tombeau de Tamerlan, dans la mosquée de Gour-Emir, située tout près de la ville russe. Pour y arriver, il nous faut traverser une étroite ruelle où des maisons en terre, assez laides, contrastent singulièrement avec les beautés que nous allons admirer. En dehors des mosquées et des palais des Khans, il faut renoncer à trouver en Asie de beaux types d'architecture. Il est vrai que l'argile ou les briques en terre mélangée de paille et séchées au soleil, dont on se sert pour élever les maisons, offrent si peu de consistance, qu'elles ne se prêtent pas aux constructions solides et durables.
Après avoir passé sous une belle voûte flanquée d'un minaret, nous arrivons à la mosquée dont la coupole est particulièrement remarquable. Dans la salle centrale repose le grand conquérant mongol, en compagnie de ses fils et de son saint patron. Au milieu, une belle pierre noire, en jade, couverte d'inscriptions, ferme la crypte où se trouvent les cendres de Timour. Les cinq tombes sont entourées d'une galerie de marbre. Les murs sont recouverts de plaques en jaspe ornées d'arabesques et d'inscriptions ; quatre niches pompeusement décorées composent la coupole. Le sol est pavé en pierres. Du côté qui regarde la Mecque, se dresse une petite colonne. L'aspect sévère de l'intérieur, qui contraste avec les couleurs variées des murs de l'extérieur de la mosquée, tout à fait en rapport avec l'impression générale qu'un sanctuaire doit faire éprouver. Un escalier sombre conduit à la crypte sous les pierres tumulaires où se trouvent les véritables tombeaux. Dans cette crypte, des sarcophages en terre blanchie à la chaux correspondent aux étages supérieurs. A droite de l'entrée principale se trouve une salle où sont enterrées les femmes et les filles de Tamerlan; en tout huit tombes de grandeurs différentes. De chaque côté s'élèvent deux colonnes creuses, couvertes de faïences émaillées, et renfermant un escalier en spirale complètement en ruine. Les ornements de ces colonnes sont du même genre que ceux de l'édifice. Non loin de là se trouve une porte semblable à celle du mausolée et sur laquelle on lit cette inscription « Construite par l'humble esclave Mohamed, fils de Mahmoud d'Ispahan. »
VII Les medressés - Les minarets - Fabrication du papier - Queue de paon - Exclamations à propos de Samarkand - Marchands de glaces - Heinn et yok - Aspect général des villes de l'Asie centrale - Deux lévriers - Le tilla - Un Afghan - Les mendiantes lépreuses - Les Sartes - Khodja Akhrar - Le frère de M. Mirski - Poullad-Khan - Tombeau des femmes de Tamerlan - La forteresse. Le trône
Nous remontons en voiture. Une grande et large rue plantée d'arbres, animée de boutiques de toute espèce, nous conduit à la grande place de Samarkand appelée Righistân, la plus belle de l'Asie centrale. Les Russes l'ont pavée avec soin et ornée de candélabres à plusieurs branches. Non loin de là on trouve une station de voitures. C'est la seule place régulière que nous ayons vue dans une ville centrale asiatique. Là se dressent fièrement les trois grandes médressés de Tilla-Kari, Chir-Dar et Ouloug-Beg, ces deux derse faisant vis-à-vis et la première à gauche au milieu. Ce sont de superbes ruines, la troisième surtout, quoique les murs en soient délabrés et tout chancelants. Ces trois médressés sont couvertes de briques émaillées chacune d'elles a des cours spacieuses plantées de beaux arbres et entourées de cel1ules servant d'école et de demeure pour les mollahs. Le nom de Tilla-Kari signifie travail d'or, et, en effet, l'or se détache sur les briques émaillées où la couleur de la turquoise prédomine. L'effet de cette ornementation a dit être merveilleux sous les rayons brillants du soleil qui resplendit sous un ciel bleu. La turquoise est la pierre de prédilection des indigènes, on peut même dire que tout est turquoise dans ce pays, les pierres, le ciel et jusqu'aux monuments.
Dans cette médressé, un mollah encore assez jeune nous montre l'écriture de ses élèves. Leur papier ne ressemble guère au nôtre. Il y en a de trois espèces : verni, huilé et collé. On écrit sur le premier au moyen. On sait que les médressés sont des écoles où les enfants reçoivent une instruction complète. Telle que l'entendent les musulmans, à savoir l'étude du Coran, les institutions religieuses, etc.
d'un petit bâton de bois taillé en plume effilée; le second remplace les vitres; le troisième fait l'office d'enveloppes. Ils se fabriquent généralement avec les haillons de vieux kaftans de coton achetés au bazar à très-bas prix. On ne trie pas les chiffons; cependant les tissus de couleur sont employés de préférence à la confection du papier bleu qui sert à envelopper. Les outils employés pour cette fabrication sont un pilon mis en mouvement par des moulins à eau, un cylindre où sont enchâssées deux dents devant lesquelles sont placés deux leviers appuyés sur des traverses, des lavoirs où l'on procède à trois lavages, le moussoir, le cadre et le réseau; ces trois derniers outils sont affectés à l'apprêt. Le filet est tissé avec les fils de la lasiagrostis splendens, en langue indigène Tchia. Pour sécher le papier, on l'étale sur des murs tournés au midi et dont le revêtement en plâtre est très-uni. On applique les feuilles contre le mur; la chaleur étant intense, ces feuilles sèchent très-vite.
Tilla-Kari a été construite en 1020 (1618); elle a cinquante-six chambres, dans lesquelles habitent cent douze mollahs. Dans l'aile gauche est une mosquée à coupole élevée avec un escalier de marbre pour l'iman.
Ces médressés possèdent des propriétés inaliénables qu'on appelle vakoufs, données par Yalangtach et situées au sud-ouest de la ville de Katteh-Koürgane. Les deux médressés de Tilla-Kari et de Chir-Dar possèdent vingt-cinq lots de terre (onze mille tanap) [Note : Le tanap correspond à huit mille cent archines carrées et l'archine a soixante et onze centimètres], huit boutiques et un revenu de trente-huit mille tenga (30 400 francs) par an. La médressé de Chir-Dar a le sommet de ses portes décoré de deux lions ou plutôt deux tigres en briques émaillées et qui donnent leur nom à la médressé. Chir-Dar signifie « Deux Lions », mais, ainsi que je l'ai dit, il est plus exact d'écrire deux tigres, car le lion est inconnu en Asie centrale et la langue ne possède qu'un seul mot pour désigner ces deux espèces d'animaux. La façade est richement décorée d'une mosaïque en carreaux de faïence verts, bleus, blancs et rouges; elle a été bâtie en 1010 (1601) par Yalangtach-Bahadour.
En entrant dans la cour intérieure, on aperçoit au milieu de trois corps de hàtiments des portiques assez élevés, entre lesquels les cellules des mollahs apparaissent sur deux étages. La médressé possède soixante-quatre chambres, habitées chacune par deux mollahs.
La troisième médressé, Ouloug-Beg, possède aussi, comme Chir-Dar, deux minarets penchés à dessein, d'une élégance et d'une hauteur remarquables; leur inclinaison est telle, qu'on ne passe pas près d'eux sans un sentiment de crainte. Les deux tours sont revêtues d'un émail bien supérieur à celui de nos plus beaux émaux craquelés. Ouloug-Beg est beaucoup plus petit que les deux autres et n'a que deux étages; il possède seulement vingt-quatre chambres et quarante-huit mollahs. Sur le derrière est une mosquée qui a été détruite et rebâtie. Le plafond est en bois avec des colonnes également en bois et finement sculptées.
En visitant Ouloug-Beg, nous entrons dans des chambres où un vieux mollah à barbe blanche nous offre des amandes, des pistaches et du pain sarte. Ces chambres ressemblent un peu à des caves, sans autre issue que la porte, dont elles reçoivent le jour; une planche large et à distance du sol, recouverte d'un kachma (feutre) sert de lit à l'habitant de la cellule. Dans les murs sont pratiquées des niches où 1'on voit disposés pêle-mêle les livres sacrés et des fruits secs. Mon mari y achète une petite tabatière très originale, faite d'un fruit qui ressemble à la courge. Les revenus de cette médressé sont beaucoup moins élevés que ceux des deux précédentes; ce sont : un lot de terre (quatre cents tanap), deux bazars, deux cents onze boutiques, soixante et onze fournitures; total trois mille neuf cent cinquante tenga (3160 francs) par an. Les deux médressés ont été construites anciennement, mais les superbes émaux que nous admirons sur leurs ruines sont d'une époque bien postérieure.
Ouloug-Beg était petit-fils de Tamerlan et jouissait de la réputation d'un célèbre astronome. Quelle devait être belle cette Samarkand lorsque des hauteurs de ces minarets sveltes et élancés, le savant prince plongeait ses regards sur cette ville toute ruisselante d'émaux !
C'est à la vue des briques émaillée et des nombreuses photographies rapportéees de Samarkand par M. de Ujfalvy, qu'un éminent sculpteur, M. Emile Soldi, a reconstruit avec son imagination les splendeurs du Samarkand de Timour.
« Ne voyez-vous pas, comme dans un mirage, cette ville immense, dont les constructions, à terrasses basses et massives font ressortir au milieu d'elle, tout un ensemble d'édifices gigantesques dont les murs étincellent comme des diamants, s'élançant dans l'atmosphère ensoleillée avec la hardiesse de nos nefs gothiques, unie à l'aspect fier et massif d'immense donjon ? Leurs masses paraissent d'autant plus imposantes, qu'elles sont surmontées d'une série de petits dômes gracieux et environnées de minarets légers et brillants.
« C'est Samarkand la belle, la sainte, la belle, la capitale de Tamerlan. »
Pour nous qui ne voyons qu'un pâle reflet de ces antiques splendeurs, nous ressentons ce que Marco Polo éprouva à la vue de cette incomparable cité.
Que de souvenirs ces ruines n'évoquent-elles pas à notre esprit. C'est ici que le grand Macédonien souilla sa gloire en tuant de sa main un de ses meilleurs amis dans une heure de criminelle débauche. C'est encore ici que Dgingis-Khan rassembla ses formidables armées pour soumettre l'Orient et l'Occident à son puissant génie militaire; c'est par cette ville que passa Marco Polo, un des plus célèbres explorateur du moyen âge, pour se rendre à la cour de l'intelligent Koubilaï; c'est enfin Samarkand que choisit pour résidence l'illustre boiteux que l'histoire appelle Timour, et c'est dans cette capitale qu'i1 faisait ériger des hécatombes de têtes humaines en savourant avec délices les fruits parfumés de la vallée du Zérafchân.
Législateur horrible et pire conquérant,
N'ayant autour de lui que des troupeaux infâmes,
De la foule, de l'homme en poussière, des âmes,
D'où les langues sortai8nt pour lui lécher les pieds,
Loué pour ses forfaits toujours impies,
Flatté par ses vaincus et baisé par ses proies,
Il vivait dans l'encens, dans l'orgueil, dans les joies
Avec l'immense ennui du méchant adoré.
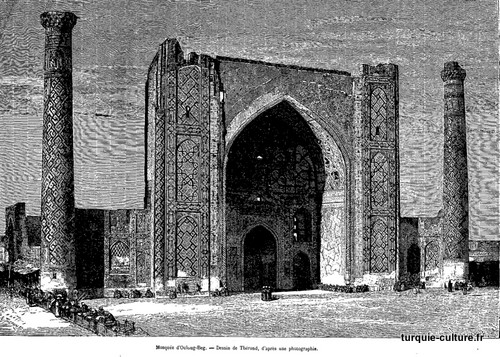
Que de transformations depuis la fondation de la depuis l'empire universel du conquérant mongol jusqu'à nos jours de lassitude et de décadence ! Tous ces magnifiques monuments tombent petit à petit en poussière, et le musulman sceptique et indolent ne remue pas un doigt pour arrêter le temps dans sa marche dévastatrice qu'il appelle la fatalité; comme autrefois, il passe des journées entières accroupi devant sa misérable demeure, fumant et se chauffant au soleil, contemplant en silence le changement qui s'opère à chaque minute. Ces mêmes hommes que vous voyez causer et troquer avec les soldats russes sont tout prêts à leur couper la gorge à la première car nous sommes tous pour eux des étrangers, des infidèles bons à jeter aux chiens; malgré leur servilité apparente, ils nous méprisent et nous regardent de la hauteur de leur superbe indifférence. Lorsque nous sortîmes de la cour de la médressé d'Oulou-beg, nous vîmes, au milieu de la place, des centaines de musulmans assis en rond autour d'un personnage à l'air très-animé qui leur racontait des légendes. Ils écoutaient avec attention et approuvaient par des signes de tête. Des marchands en plein vent des glaces avec de la neige et du miel ; pour trois quarts de kopeck on peut se procurer ce rafraîchissement (à Samarkand,comme à Tachkend, la glace n'est ni rare, ni chère; pour dix kopecks, ou trente-cinq centimes, on a un peu plus d'un kilogramme de glace; les montagnes voisines en fournissent abondamment). D'autres, adossés à un mur, se font raser la tête,; c'est une grande affaire pour un croyant; la religion lui en fait une loi, et jamais il n'oserait laisser pousser ses cheveux; les Tatres qui se permettent cette licence sont déjà à moitié russifiés; c'est probablement à cause de cet usage que les mahométans portent toujours une petite calotte qu'on appelle tibetéïka. M. de Ujfalvy prend à un marchand quelques petites pièces de trois quarts de kopeck et lui donne en échange quinze kopecks; celui-ci, malgré son indifférence habitude, ne laisse pas que d'être étonné. Mon mari demande à tous les passants s'ils sont Uzbegs, Tadjiks ou Kirghises, et selon qu'il a trouvé ou non leur nationalité, ils se contentent de répondre hein (oui) ou yok (non). Après avoir bien examiné cette place, ces médressés, cette foule bigarrée dont les khalats de toutes couleurs, les turbans et les tibetéïkas ondoyaient au soleil, étrange et pittoresque scène à jamais gravée dans notre mémoire nous reprîmes le chemin de notre habitation, songeant à ce que devait être Samarkand lorsque tous ces monuments étaient dans leur splendeur certes elle pouvait se parer du titre de reine de l'Asie.
Il ne faudrait point toutefois la comparer à nos villes d'Europe, auxquelles elle ne ressemble en rien. En général, les villes d'Orient ont l'aspect de grands villages groupés autour de la cité où est construite la forteresse et qui est entourée d'une vaste enceinte de jardins; toutes sont semblables par la forme, différentes seulement par la grandeur. Le centre de la ville-est la forteresse, qui se trouve d'ordinaire sur une élévation artificielle et entourée d'un fossé et d'un mur crénelé en terre glaise assez élevé. L'intérieur de la forteresse (Kouhoundouz) est occupé par des constructions et des abris où vivaient autrefois le beg, les soldats et un grand nombre d'habitants. Autour de la forteresse et de trois côtés s'étendent les faubourgs, percés de plusieurs portes; les rues sont étroites, sinueuses, et consistent en deux files parallèles de murailles, les maisons s'ouvrant toutes sur la cour. Il n'y a presque point de jardins, et rarement on y voit des arbres. C'est seulement dans les grandes villes qu'il y a des rues formées par des maisons autour du bazar. Dans cet endroit, le prix du terrain étant très élevé ne permet pas de construire de grandes cours. La mosquée moderne consiste, en général, en une galerie découverte avec de hautes colonnes en bois dont le plafond est couvert de peintures aux vives couleurs. A côté de cette galerie, il y a une autre mosquée pour les grandes fêtes et pour les offices d'hiver. Les rues du bazar sont les seules animées; là seulement se manifestent la vie et le mouvement de la ville, que partout ailleurs on pourrait croire abandonnée, les habitants restant toute la journée chez eux. Les médressés s'élèvent toujours auprès du bazar; elles sont toutes de forme carrée et possèdent une cour intérieure. Les résidences particulières sont entourées d'un mur en terre, elles comprennent un petit nombre de cours et de maisonnettes. Dans les plus importantes, il y a un grand bassin quadrangulaire ombragé de quelques arbres. La ceinture de jardins qui entoure la ville proprement dite est dix fois plus grande que la ville elle-même. Entre les jardins les rues sont plus larges; on n'y voit pas de maisons, mais seulement des murs de terre qui entourent les jardins.
L'aspect si triste de ces villes asiatiques devait faire ressortir encore bien les belles et élégantes mosquées de Samarkand.
Ce jour-là mon mari choisit parmi une douzaine de chiens turcomans, qu'on lui amena, deux des plus jolies bêtes que j'aie jamais vues de ma vie. Cette espèce est assez rare, même à Samarkand. Ce sont des lévriers (tazi) de taille moyenne et à poil ras. Leurs oreilles sont grandes, la queue et les pattes garnies de très-longs poils. Le chien était d'une couleur grisâtre très-rare, et la chienne café au lait. Ils étaient tous les deux très-jeunes; on les offrit à mon mari pour soixante-dix tillas d'or, quelque chose comme deux cent quatre-vingts et on les lui laissa pour le quart Cet écart entre la demande et l'offre montre combien il est nécessaire de marchander. On sait, déjà que le marchand musulman est avide et cupide à ces défauts et en dehors de son commerce, il joint la poltronnerie, la cruauté et l'hypocrisie, communes à tous les habitants des villes, d'ailleurs les gens les plus obséquieux du monde.
Le tilla est une monnaie d'or sarte, qui vaut quatre roubles; elle est belle et assez bien frappée: Le marché fut conclu avec le concours d'un Afghan qui était attaché à la personne du général Ahramoff. Cet homme avait un type superbe, qui plaidait en faveur de sa race; de grands yeux bruns, des traits forts et énergiques; sa barbe noire et fournie lui donnait un aspect sévère et peu encourageant.
Ajoutez-y une ceinture garnie de formidables couteaux. Comme il n'acceptait pas d'argent, mon mari lui donna pour silao (présent, pourboire) un porte-monnaie en cuir de Russie, fait en Angleterre; il en parut enchanté. Le mot silao est toujours bien accueilli ; il résonne à chaque pas, et pour le moindre service on réclame un présent.
Dans l'avenue qui conduit à la forteresse, les Russes ont une très-belle école. Comme je voyais pour la seconde fois des femmes qui demandaient l'aumône avec des enfants sur les bras, je demandai à mon cicérone, charmant officier russe, le prince de ... si elles n'avaient pas d'autre profession. « Non, répondit-il, ce sont des malades. Malades ? fis-je, mais elles n'en ont pas l'air. Elles le sont pourtant, car vous avez affaire à des lépreux qui ne peuvent entrer avec les autres habitants de la ville et ne vivent que de charité. » Ces femmes portent une coiffure spéciale qui les fait reconnaître; c'est une coiffe blanche formant voile en arrière et qui leur couvre le front. Elles habitent dans un petit village éloigné de la ville, se marient, ont des enfants et forment ainsi une colonie de lépreux. Peut-être y aurait-il acte d'humanité à interdire ces monstrueuses unions, qui perpétuent une maladie contre laquelle la médecine se reconnait impuissante. L'aspect de ces malheureuses me donnait froid dans le dos; je ne connaissais d'autres lépreux que ceux de l'Évangile et du touchant ouvrage de Xavier de Maistre. Je me crus transportée en plein Moyen-âge. Les yeux grands ouverts et fixés sur ces rebuts de l'espèce humaine, je me demandais si le mal contagieux qui les dévore ne pouvait être transmis à la population de Samarkand par l'intermédiaire de ces canaux d'irrigation où tous les musulmans vont faire leurs ablutions et qui alimentent les jardins de toutes les maisons et les bassins publics. Et penser qu'on peut boire de l'eau dans laquelle s'est lavé un lépreux!
Justement j'aperçois, dans un de ces canaux qui bordent de chaque côté une belle avenue donnant sur une des portes de la ville, des enfants qui se baiânent avec leur insouciance ordinaire. Près de cette porte est un large et grand fossé; au loin dans le fond apparaissent des maisons sartes.
En général, les Sartes pauvres se font assez souvent domestiques chez les Russes, mais ils sont malpropres et paresseux; malgré ces défauts, on les préfère, ainsi que les Tartares, même aux Russes, en ce sens qu'ils ne boivent jamais; leur salaire d'ailleurs n'est pas élevé, on leur donne toujours trop pour le peu qu'ils font. Les Sartes se nourrissent le plus souvent eux-mêmes, car ils répugnent à manger de la nourriture des chrétiens. Notre Sarte, par exemple, n'acceptait de moi que le café noir et refusait tout autre aliment. Un des jours suivants, nous nous rendîmes, en compagnie du prince M. à Khodja-Akluar, médressé située à sept kilomètres de la ville. Nous quittons Samarkand en passant près du tombeau de Timour et traversons un quartier de la ville compris dans un haut mur de circonvallation crénelé et bâti en terre. Une très-belle route, le long de superbes avenues, conduit à Khodja-Akhrar. Devant l'entrée principale de la médressé se trouve une place assez spacieuse. A gauche, on entre dans un parc charmant, où s'élèvent des tchinars (platanes) centenaires ombrageant une belle pièce d'eau; au fond, à gauche, le tombeau du saint Akhrar, entouré et masqué par un champ de seigle qu'on s'étonne de voir au milieu de cette médressé.
Des pierres tombales recouvrent les cendres du saint et de sa famille; celle du saint est la plus grande. Devant le tombeau, les mollahs se flattent d' entretenir un feu éternel qui, dans le moment où nous passons, est cependant éteint. Derrière ce tombeau monumental se trouve un vaste cimetière, où se font enterrer tous ceux qui considèrent le saint Akhrar comme leur patron. Nous revenons sur nos pas et nous longeons un vaste bâtiment à galeries couvertes, où les fidèles prient; les mollahs se promènent; des enfants nous suivent, espérant quelques kopecks. Dans une salle basse, qu'on peut aisément comparer à un trou, une vingtaine d'enfants apprennent à lire. Ils sont assis à terre, le long du mur, et répètent les passages qu'un enfant plus âgé leur lit dans le Coran. Ce bâtiment a été couvert de fort belles briques émaillées; j'en remarque une, entre autres, d'une couleur vert foncé, dont la teinte est superbe. Par une petite porte basse, nous entrons dans la cour de l'antique médressé; cette cour ressemble à celle des médressés Tilla-Kari et Chir-Dar. Ce n'est qu'à Samarkand que les ornements en briques émaillées, appliquées le long du mur, présentent de si belles dispositions. Il y a surtout des mosaïques de fleurs qui sont remarquables; nulle part je n'en ai vu de plus brillantes. Le bleu, l'orange et le vert le plus vif s'allient agréablement à un rose tendre qui colore les pétales de fleurs larges et épanouies; c'est un dessin que je n'ai trouvé nulle part avec une si grande variété de formes et une si grande richesse de coloris. Un garçon tadjik nous détacha, à l'aide d'une hachette, un assez bel échantillon, dont mon mari enrichit, tout joyeux, sa belle collection de céramique.
Pendant que nous revenons sur nos pas, notre cicérone, M. Mirzki, nous raconte l'histoire de son malheureux frère, qui a été fait prisonnier et mis à mort par les Kokhandais, lors de la dernière expédition des Russes. Deux officiers et douze cosaques avaient été surpris en plaine par un détachement de cinq ou six cents Kokhandais; ils purent construire un fortin et s'y défendre pendant quatre jours. Les Kokhandais, sous les ordres du fameux usurpateur Poullad-Khan, firent venir un canon et mitraillèrent cette vaillante poignée d'hommes. Dix furent tués sur place; les survivants, au nombre desquels figuraient l'officier Mirzki et deux autres soldats, tombèrent entre les mains de ces forcenés. Ils furent massacrés de la manière la plus horrible et pour ainsi dire déchirés vivants. C'est ainsi que les hommes lâches et sanguinaires de cette contrée reconnaissent le courage de leurs ennemis; la lâcheté et la cruauté s'al1ient toujours et caractérisent la dégénération d'un peuple. Abdourakhmân-Afto-batchi, le chef des Kara-Kirghises, avait fait autant de mal que possible aux troupes russes aussi longtemps qu'il les combattait, mais néanmoins il faisait distribuer du thé et du pain à ses malheureux prisonniers. Cet acte de magnanimité lui valut d'être chassé et persécuté par le féroce chef des Kokhandais. Les Kirghises, comme les montagnards de Schakrisebbs, se sont toujours conduits en combattants courageux, mais loyaux, et non pas en bêtes fauves. Le général Skobeleff tira vengeance de tant de crimes, lorsqu'il se fut emparé de Poullad-Khan. Ce misérable, condamné à la potence, prétendit qu'on n'oserait pas lui infliger un tel supplice, « car, disait-il, je suis un khan. Entre un khan tel que toi et un simple gredin, répondit Skobeleff, il n'y a aucune distinction à faire, » et l'arrogance de mon khan n'eut d'autre résultat que de le faire pendre sur l'heure, en place publique de Marghellèm, au milieu d'une foule considérable, curieuse de voir comment un khan tirait la langue. Nous avons visité le tombeau des femmes de Tamerlan, situé sur la place de Bibi-Khanym, à quelques pas de cette mosquée; il ressemble beaucoup, comme disposition, à celui de Napoléon Ier aux Invalides, mais par suite d'un effet du hasard, car la coupole s'est écroulée et a défoncé la voûte du tombeau. Les Russes ont pris soin de déblayer les décombres. Les mosaïques des murs, vertes, bleues, blanches, sont fort belles. De là nous nous rendons à la forteresse pour visiter le palais de l'Émir, aujourd'hui transformé en hôpital militaire. Ici l'on voit au milieu d'une grande cour le Kok-Tach, un trône en marbre couvert d'ornements; l'émir y prenait place quand il venait à Samarkand pour tenir son lit de justice, et quel lit de justice!
Ceux qui avaient encouru la colère du maître subissaient les peines les plus cruelles et les plus extraordinaires. Le prince avait fait creuser dans la terre de grands trous en forme de poire; on y enfermait les coupables; ils étaient souvent condamnés à y demeurer plusieurs mois, on avait soin de remplir la fosse afin de paralyser les mouvements de ces malheureux, on leur jetait quelque nourriture, tout juste assez pour qu'ils ne mourussent pas de faim. De ces antres où s'accumulaient les immondices et se multipliait la vermine, s'exhalaient des miasmes putrides, foyers d'épidémie dont l'indolence musulmane ne prenait aucun souci. Nous avons vu à Tachkend un brillant colonel russe, prince médiatisé de Chakrisebbs, qui avait passé deux mois dans une de ces prisons asiatiques.
Auprès de ce trône de pierre, qui n'est pas bleue, comme l'a dit le célèbre voyageur Vambéry, mais grise, nous remarquons un trou où les solliciteurs plaçaient des offrandes d'argent.
Les galeries de la cour sont couvertes; les salles et les chambres qui sont nombreuses présentent souvent une assez belle architecture. Ce sont toujours des plafonds à voûte dont les angles sont ornés de niches en encorbellement et se rapprochent beaucoup de l'architecture ogivale.
En sortant de la forteresse, nous apercevons à main gauche le tombeau des Russes tués à la fameuse défense de Samarkand, contre des forces plus de vingt fois supérieures.
VIII Kara-Kalpaks. Le bazar. Chiffons, calottes, pantoufles, aiguières et plats; tabacs, racines, et fruits. Le jardin public. La ville russe, Les Tadjiks.
Chemin faisant, en allant au bazar, nous rencontrons deux Kara-Kalpaks, montés sur un âne. Les Kara-Kalpaks, appelés ainsi à cause du bonnet noir qu'ils portent généralement, sont une race turque proche parente des Uzbegs. C'est une peuplade paisible, qui s'adonne à l'agriculture et à l'élevage des bestiaux. Le bazar est situé dans la vieille ville, dont toutes les maisons sont composées d'un seul rez-de-chaussée ; le corridor d'entrée forme un coude qui dissimule la porte. Quelques enfants attirés par notre apparition sortent leur tète; les petites filles se retirent sous les regards, puis reviennent on ne sait lequel des deux l'emportera, de la curiosité ou du décorum. Les rues sont assez bien entretenues, ce que nous n'avions pas constaté à Tachkend. Nous passons par la place de Reghistàn; au bout de la rue qui donne sur cette place s'élève une rotonde avec six passages c'est l'entrée dit bazar. Ce marché oriental est beaucoup plus propre que celui de Tachkend; les chaussées sont assez bonnes, on peut y circuler convenablement à pied et en voiture. Les marchandises sont rangées pêle-mêle dans des cases ou sur des étagères; un comptoir occupe le centre. Les magasins sont généralement en pente; les soies en écheveau pendent sur le devant des boutiques, dans lesquelles il est rare de voir le marchand.
C'est en avant du magasin et même sur le trottoir que s'asseyent et vendeurs et acheteurs. En général, le marchand surfait de plus du double, l'acheteur offre la moitié de la valeur. Yok (non), dit le marchand ; l'acheteur propose un chiffre plus élevé, mais les yok se succèdent jusqu'à ce que les offres paraissent raisonnables. Le marchand tend alors la main à l'acheteur. Vous croyez peut-être le marché conclu ? Pas le moins du monde c'est à l'acheteur maintenant de battre en retraite en se couvrant d'un feu bien nourri de yok. Au bout d'une demi-heure, les combattants épuisés finissent par se trouver d'accord, après avoir tranché par moitié la différence des prix. Alors les deux mains se serrent réciproquement et le marché est conclu.
Le bazar était des plus animés; c'était jour de marché, le vendredi étant jour de repos. Parmi les étoffes qu'on nous offrit, une en velours de soie, d'un dessin original rappelant nos moquettes, mais avec des teintes beaucoup plus vives et beaucoup plus chaudes, attira particulièrement mon attention. Elle était d'autant plus belle que le kanaous, qui est une soie légère unie ou rayée, ne peut lutter avec nos soieries, ni comme tissu, ni comme couleurs. Ce kanaous équivaut à une bonne petite étoffe de doublure, dont les femmes russes cependant font de charmantes robes d'été. Faute de grives, on mange des merles. La soie de Hissar est bien meilleure; généralement unie, à rayures jaunes, rouges, violettes ou bleues, elle ressemble à notre gros grain; elle est très-forte et très-épaisse; il y en a de couleur unie, avec bordure servant pour ceintures. A mon avis, les autres étoffes si étranges ne devraient servir qu'à garnir des meubles de tout bois; ici elles garnissent des têtes tadjiques de tout calibre. J'achetai un petit châle en soie blanche de Bokhara, dont le tissu est presque semblable à celui des beaux foulards de l'Inde.
Je regardai aussi des bottes dont le talon peut rivaliser d'étroitesse avec nos talons Louis XIV; plus il est haut, plus il est en honneur; je me demandais vraiment comment on pouvait marcher avec de pareilles échasses, car l'extrémité n'est pas plus large qu'une pièce d'un franc. C'étaient ensuite des pantoufles vertes, que le musulman porte par-dessus ses bottes et qu'il a soin d'enlever avant d'entrer dans les chambres ou dans les mosquées.
J'admirai aussi ces gracieuses aiguières, ces plats en cuivre de Karchi, qui sont si bien ciselés et décorés parfois d'incrustations d'argent; ces kounganes dans lesquels ils font le thé ; le sel en gros morceaux veinés de rose, la laine, le savon qui se vend en bâtons de deux livres, blancs et solides et venant de Katty-Kourgân : on l'y prépare généralement dans des maisons particulières, car il n'y a pas de savonnerie spéciale.
Le tabac se vend tout haché et en petite quantité les mahométans le fument, à très-petites doses d'ailleurs, dans une pipe appelée « tchilim », faite d'une courge qu'ils enrichissent de turquoises; le haut du grand récipient est garanti par un petit récipient en métal ou en bois. Cette pipe se passe de main en main et chacun en tire une bouffée ceci n'est que fraternel; mais comme ils chiquent beaucoup, la chose devient malpropre.
Puis ce sont des matières pour teindre, telles que le bouzgandi. (rouge), le roïan (jaune), racine importée de Bokhara, le naïpous, autre jaune qu'on recueille sur place, et le tamac qui vient d'Ouratubé. Le nil (indigo), le daké, étoffe blanche, le kamkhal, étoffe de soie avec des ornements d'or, sont importés de Kaboul.
La graine de la plante de bede, trèfle chinois, sert à ensemencer les prairies artificielles; avec un demi-poud (vingt livres) on peut ensemencer un tanap (1), champ, qui se fauche trois fois par an pendant quatre années.
Il n'y avait en ce moment dans le bazar que des fruits secs la saison n'était pas assez avancée et les célèbres melons de Samarkand qui avaient fait les délices de Tamerlan n'avaient pas encore fait leur apparition nous ne devions les goûter qu'à Tachkend. Le blé, la farine, l'orge qu'on emploie dans le Turkestan pour la nourriture des chevaux en guise d'avoine et le riz étaient en grande quantité. La viande, je dois le dire, ne nous parut pas appétissante, et nous ne nous arrêtâmes pas à la regarder. Les assiettes et les plats sont vernis; les petits bols dans lesquels on boit le thé ressemblent à la faïence. Il y a des cruches non vernies, depuis la plus petite taille jusqu'à la plus grande qui atteint jusqu'à un mètre six centimètres; deux ouvriers potiers peuvent faire par jour jusqu'à soixante-dix grandes cruches; ils gagnent vingt kokands par mois (quatre roubles)(2) et sont obligés de se nourrir.
1. Un tanap correspond à cinq mille sept cent cinquante-cinq mètres carrés.
2. A peu près quatorze francs.
J'eus le temps d'examiner tous ces produits plus attentivement qu'à Tachkend, le bazar de Samarkand étant beaucoup mieux entretenu, plus commode et mieux situé. A-t-on besoin de quelque chose, vite on court au bazar, quoique le magasin russe de Zakho, qui se trouve dans la nouvelle ville, soit très-bien assorti mais tout y est beaucoup plus cher. Nous nous arrêtâmes à la boutique d'un musulman, agent commercial des Russes. En cet endroit, les boutiques sont surélevées par deux marches assez hautes; deux tabourets étaient placés devant le comptoir; nous y prîmes place. Le marchand nous fit voir toutes ses richesses, rangées avec assez d'ordre; pendant que nous regardions, ses collègues venaient aussi nous offrir leurs produits; l'affaire fut bientôt terminée. Je m'arrêtai pour considérer un marchand bokhare qui était établi à Samarkand. Son riche khalat m'avait frappé, et c'est en demandant quel en était le propriétaire que j'appris son origine.
Au sortir du bazar, nous vîmes une assez belle maison servant de demeure à un riche Tadjik. C'est encore une exception à Samarkand, car autrefois riches comme pauvres vivaient autant que possible avec la même apparence de dénûment, dans la crainte que l'émir de Bokhara, surprenant un indice extérieur d'aisance, ne demandât aux gens qui laissaient percer l'oreille à leur fortune une somme d'argent qu'on ne pouvait refuser sans courir le risque de perdre sa tète. Ce n'est que depuis l'occupation des Russes que les riches osent vivre d'une manière plus confortable. Après cette visite au bazar, nous repassons par la place de Reghistàn, dont les tours me paraissent tellement penchées que j'en frémis encore; si Samarkand était sujette aux tremblements de terre comme Tachkend, elles s'écrouleraient infailliblement. Nous fîmes dans la voiture de la baronne A. quelques tours sur le boulevard de Samarkand, et nous descendîmes au jardin public.
Ce jardin, arrosé par une quantité d'ariques (canaux artificiels), seul mode d'arrosage dans ce pays où il ne pleut jamais l'été, est très-bien dessiné. Un pont de bois le relie à une charmante petite île, devant laquelle des allées conduisent à une véranda qui se trouve sur une hauteur. Cette véranda, construite avec de l'argile à laquelle on a donné la couleur et l'aspect du bois, est bâtie dans le style suisse. Du haut de son balcon nous jouissons d'une vue admirable la musique jouait un morceau de la Vie pour le Tsar, opéra russe que j'avais entendu à Saint-Pétersbourg. La ville russe de Samarkand n'est pas, comme celle de Tachkend, aussi, éloignée de la vieille ville; elles se confondent un peu; les jolies maisons et les beaux boulevards que la, jeune cité doit au général Abramoff répandent sur son, aînée un air de confortable auquel on n'est pas habitué en Asie. Les chaussées de Samarkand font honte à, celles.de Tachkend. Les environs sont aussi plus jolis; les monts Thian-Chan forment une belle ceinture à la ville; le magnifique feuillage de ces grands arbres qui bordent lés.avenues atténue pour les piétons les ardeurs du soleil., Samarkand a aussi le cachet beaucoup plus asiatique et il est presque fâcheux que la nouvelle domination ne l'ait pas prise pour capitale.
Samarkand est habitée principalement par des Tadjiks ; ils sont d'origine iranienne, en partie autochthones, en partie descendants de colons persans.
1. Samarkand compte actuellement quatre mille six cent trente-trois maisons avec trente-cinq mille trois cent vingt-six habitants. Il y a cinquante-deux caravansérails, dix-sept médressés (écoles) et quatre-vingt-cinq mosquées
Quoique gardant d'une manière sévère la forme actuelle que leur a donnée l'islam, ils ont subi l'influence des Uzbegs, et beaucoup de Tadjiks parlent des dialectes uzbegs. Seuls les Galtchas ou Tadjiks des montagnes ont conservé leur langue, à moins que leurs affaires ne les appellent dans les vallées. La langue tadjique est un dialecte du persan, c'est la langue diplomatique du pays employée par les cabinets de Bokhara et de Khiva. Les livres sont écrits et s'écrivent en persan ou en turc oriental. Sous le rapport de la religion, des usages, des coutumes et des moeurs, les Uzbegs et les Tadjiks ont une grande ressemblance, mais ils diffèrent excessivement entre eux au point de vue physique et moral.
Le Tadjik est grand, d'un embonpoint moyen; la peau est blanche quand elle n'est pas bronzée par le soleil. Les cheveux sont généralement noirs, ainsi que la barbe, qui est très-abondante. Les yeux ne sont jamais relevés des coins et sont presque toujours bruns; le nez est très-beau, les lèvres sont fines, les dents sont petites. Le front est haut, large, et l'ensemble de la face est ovale; les oreilles sont petites et aplaties. Le corps est vigoureux, mais les mains et les pieds sont plus grands que chez les Uzbegs. Le Tadjik parle beaucoup et bruyamment et se remue de même; il coupe souvent la parole à son interlocuteur. Jamais le Tadjik n'a eu d'influence sur les destinées de son pays ; son rôle s'est borné et se borne encore au commerce. C'est un trafiquant alerte, retors et sans principes. Il est très-fanatique, quoiqu'il ne soit pas mahométan depuis une époque très-reculée, et ce fanatisme le rend rebelle à l'influence européenne. Il y a beaucoup de saints d'origine tadjique. Le Tadjik a été assujetti à l'Arabe, puis à l'Uzbeg, et s'est en partie, à la suite de mélanges, transformé en Sarte. Ainsi les Tadjiks de la rive droite du Syr-Daria sont des Sartes et parlent le sarte, qui est un dialecte du turc oriental. Les Tadjiks citadins prennent le nom des villes qu'ils habitent; ceux des montagnes ou Galtchas (habitants du Kohistan, haute vallée du Zérafchân) se désignent par le nom des différentes rivières sur le bord desquelles ils demeurent. Ces derniers se distinguent des Tadjiks citadins par leur honnèteté et par la simplicité de leurs costumes; ils sont généralement si pauvres, que la mendicité fait partie de leurs moeurs. Par exemple, lorsqu'un Galtcha désire se marier, il va d'abord mendier dans les plaines ou vallées; s'il s'en abstient, c'est quelquefois un obstacle vis-à-vis des parents de celle qu'il voudrait obtenir. Les parents lui font savoir qu'ils préfèrent un mendiant à un travailleur; il faut alors qu'il prenne la besace et s'en aille mendier dans les centres oit la vie est moins rude et plus civilisée. C'est à ce moment qu'ils puisent les tendances extravagantes de la religion mahométane, car chez eux ils sont, très-laborieux, travailleurs et adroits chasseurs. Ils exportent des marchandises telles que du charbon, des fruits secs, des légumes, principalement des radis, etc. en échange ils reçoivent, au lieu d'argent, des tissus de coton. Parmi les Galtchas, les individus blonds aux yeux bleus ne sont pas rares. Les Tadjiks en général se marient entre eux, surtout ceux des montagnes; mais ceux de la plaine achètent quelquefois des femmes uzbegues et kirghises. Les cérémonies et les coutumes de la vie des populations qui habitent le Turkestan sont fort pcu différentes, tant la religion mahométane a la propriété de mettre à l'unisson les caractères de tous les peuples qui la professent. Les quelques différences qui s'y glissent sont dues en partie à l'ignorance dans laquelle ils sont parfois du Koran et peut-ètre aussi aux régions qu'ils habitent.
IX La place et la mosquée de Bibi-Khanym.- La mosquée du Schah-Sindèh - La danse des derviches - Aphrosiab.
Nous avons admiré plus d'une fois la médressé de Bibi-Khanym, ainsi que le tombeau des femmes de l'empereur mongol.
Cette médressé, bâtie en 791 de l'hégire (1388 de notre ère), est ainsi appelée en mémoire de l'une des femmes de Tamerlan; elle est entourée d'une grande place, moins belle toutefois et surtout moins régulière que celle de Reghistân.
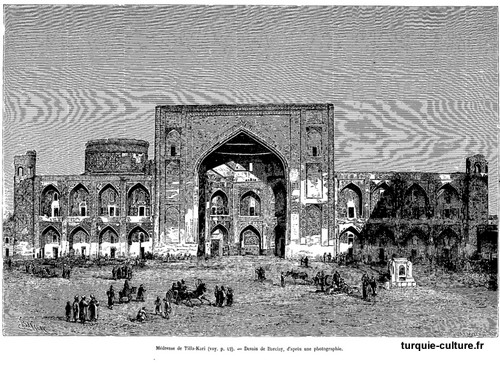
Aucun édifice de l'Asie centrale ne présente des lignes et des contours plus fins et plus audacieux que la médressé de Bibi-Khanym.
Devant le bazar qui ferme la place de Bibi-Khanym se tient le marché des chevaux, marché d'une grande importance pour les Orientaux, car le cheval est beaucoup, pour ne pas dire tout pour eux; ils les soignent et les traitent avec une douceur qu'on n'attendrait pas d'eux; les chevaux et leur harnachement sont presque leur plus grand luxe. Il est vrai que cette monture leur rend de véritables services; c'est avec elle qu'ils franchissent dans les steppes ces immenses distances qui séparent souvent les oasis les unes des autres.
Nous poursuivons notre chemin sur la gauche et nous arrivons, après avoir longé l'ancien cimetière, qui est vraiment immense, à la plus belle mosquée de l'Asie centrale, l'incomparable Schah-Sindèh ou de Kassim-ben-Abbas, qui renferme le tombeau de ce saint. Sa construction remonte à l'année 795 (1392); les indigènes paraissent convaincus que Kassim-ben-Abbas est toujours là, vivant sous la terre.
Nous descendons de voiture et montons plusieurs marches qui conduisent à la principale entrée; à gauche, on trouve la mosquée actuelle. Un corridor long et large conduit au pied d'un escalier à grandes et hautes marches qui débouche dans l'ancienne mosquée, au milieu de nombreuses cours, salles et chambres. Nous sommes tout à fait éblouis. La décoration est d'une magnificence qui confond l'esprit; ce sont des murs couverts de superbes briques émaillées, avec de larges surfaces décorées de riches mosaïques, des encadrements ronds ou rectangulaires, avec des dessins en relief d'une disposition remarquable.
Nous admirons surtout des colonnes, des frontons et des coins de voûte en forme de niches en encorbellement, d'une beauté surprenante. Les colonnes sveltes et fines s'élèvent gracieusement, et les coins de voûte sont d'une élégance, d'une audace et en même temps d'une pureté de lignes incomparables. Moyennant une somme relativement assez faible (on nous avait offert, à Saint-Pétersbourg, un petit fragment de cette mosquée, au prix de trois cents roubles!) nous obtenons quelques beaux échantillons de cette architecture. Nous ne sommes pas venus en Vandales pour détruire ce qui reste de ces incomparables monuments; mais on se rend facilement au désir de mon mari, quand il demande des fragments détachés pour en gratifier les musées de Paris.
Le lendemain, nous retournâmes au Schah-Sindèh pour assister à la danse des derviches, qui devait commencer à midi. A une heure, les danseurs n'étaient pas arrivés, mais en revanche nous eûmes l'occasion d'admirer la police indigène, qu'on avait groupée en notre honneur sur les marches de la principale porte d'entrée de la mosquée. C'étaient de fort beaux hommes, armés de lances et de sabres et vêtus d'un khalat couleur sombre. Les chefs seuls portaient des cafetans en soie éclatante. Il y avait aussi quelques mollahs, qu'on reconnaissait aisément à leur longue barbe blanche. Nous gravîmes ensuite les grandes marches qui conduisaient dans l'intérieur de cette belle mosquée; malheureusement nous nous attardâmes, car lorsque nous redescendîmes, j'entendis des sons rauques assez semblables au râle de porcs qu'on égorge.
Dans une salle à notre gauche, une quantité de musulmans accroupis contemplaient une trentaine de vieillards dansant en rond et poussant des, hurlements affreux; ils continuèrent cet exercice jusqu'à ce qu'un des leurs tombât; alors ils s'assirent et un autre raconta le martyre d'un de leurs saints. Aux passages pathétiques, quand l'orateur dépeignait une des tortures endurées par le saint, oreilles coupées, nez troué, etc., les auditeurs fondaient en larmes et les danseurs réitéraient leurs hurlements, se décomposant la figure pour imiter les souffrances du saint; après quelques instants, ils recommencèrent à crier sans presque se donner le temps de reprendre haleine et à se balancer le haut du corps sans pour cela se lever. Je ne puis qualifier l'épouvante et le dégoût que m'inspiraient ces cris et ces contorsions; cela devait durer ainsi jusqu'au coucher du soleil, à moins que les derviches ne fussent tous les uns après les autres tombés d'épuisement. Le chef de ce choeur étrange prenait de temps en temps une tasse de thé qu'un mollah lui préparait. J'aurais voulu rester plus longtemps, mais le spectacle m'écœurait; je battis en retraite, vivement impressionnée de cette scène. Le 23 avril, nous nous rendîmes à Aphrosiab, l'ancien emplacement de Samarkand, à une demi-heure de la ville; il faisait un temps splendide, tout était en fleurs, le printemps était en avance d'un mois sur notre printemps français, la chaleur commençait même à se faire sentir.
Des fouilles récentes ont fait découvrir à Aphrosiab des briques émaillées, des fragments de poteries et de verres et un grand nombre de monnaies gréco-bactriennes et autres.
On raconte qu'Aphrosiab était un géant terrible qui, faisant le siège de l'ancienne ville, s'était impatienté de sa résistance, et l'avait couverte du sable sous lequel elle est enterrée; Il était si grand, dit la légende, qu'assis au sommet de la montagne, il baignait ses pieds dans une rivière au fond de la vallée; on voit encore aujourd'hui une flaque d'eau dans laquelle avaient trempé ses orteils; les indigènes viennent s'y baigner. Nous avons gravi ces hauteurs et visité différents terrains que les fouilles ont mis à nu; nous y avons trouvé des briques émaillées avec des incrustations de pierres d'un dessin assez original,des fragments de poteries, des morceaux de verre et des bombes à feu grégeois. En poursuivant notre chemin, à trois verstes et demie de la ville, nous arrivâmes au tombeau de saint Daniar-Palvun (Daniel), situé sur une rive escarpée du Siah. Ce tombeau, qui a vingt-cinq pas de longueur, contient, d'après là légende, les restes d'un seul homme. A droite et à gauche se trouvent des plaques de marbre avec des inscriptions; au bord, regardant la rivière, des tètes de béliers et des étendards (queue de cheval) surmontés du croissant. Plusieurs bâtiments servent à abriter les pèlerins pendant les grandes chaleurs ou les mauvais temps. Une pente très-rapide nous conduit à un torrent au bord duquel d'immenses arbres étendent leur ombrage rafraîchissant. C'est en cet endroit que les Russes de Samarkand viennent sans doute faire leurs promenades champêtres, car, en ce moment, une famille y faisait les apprêts d'un déjeuner sur l'herbe; la dame, accompagnée de ses enfants et de plusieurs indigènes, s'occupait des préparatifs; trois ou quatre messieurs se tenaient au bord de l'eau et pêchaient à la ligne. On se serait cru à Asnières; n'en concluez pas à l'innocence de l'âge d'or.
X Excursion dans la haute vallée du Zérafchân. Villages tadjiks. Fendjekend. Mon mari mesure des crânes et me renvoie prendre des leçons d'équitation à Samarkand.
Il avait été décidé que nous resterions quelque temps à Samarkand et que, pendant ce séjour, nous irions dans les montagnes du Zérafchun, qui font partie du Thian-Chan. Donc, le jeudi 26 avril, nous partimes à trois heures de l'après-midi en compagnie de M. Mirzki, pour aller avec la tarantasse jusqu'à Pendjekend. Nous traversâmes toute la ville et nous entrâmes dans la campagne.
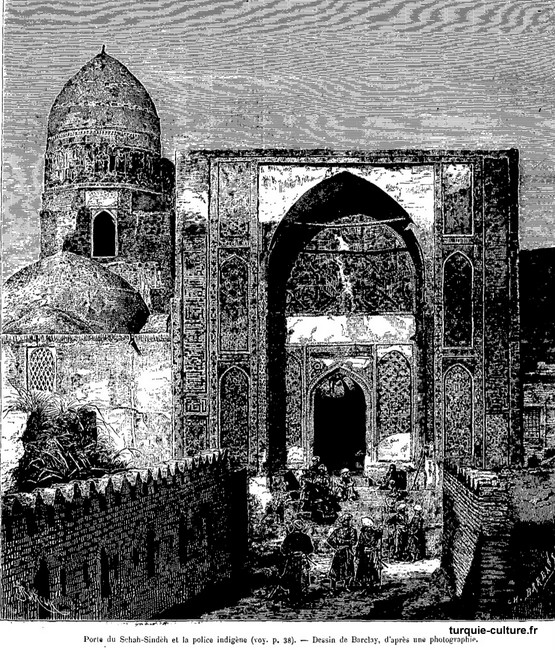
Ici on pourrait se croire en Europe, car les terrains sont admirablement cultivés; l'eau distribuée par les ariques forme mille petites rivières; les beaux arbres sont groupés avec art, mais le Thian-Chan, qu'un temps un peu couvert ne nous laisse apercevoir qu'imparfaitement, nous rappelle à la réalité.
Nous traversons des villages tout à fait tadjiks; toujours la même physionomie assez triste ; aucun visage de femme ne vient égayer un peu ce défilé mélancolique de figures orientales; à peine les enfants osent-ils se mettre derrière la porte pour regarder les étrangers. Où sont ces cris joyeux qui retentissent dans nos campagnes, ces petites figures gaies et curieuses qui viennent se mettre sous votre nez ?
Après la première station, d'assez pauvre apparence, nous trouvâmes quelques steppes, entrecoupées cependant de terres labourables. Les routes étaient bonnes; du reste, toutes les routes nous semblaient soignées en comparaison de celles que nous avions suivies auparavant. Avant d'entrer dans les montagnes on passa deux rivières qui se jettent dans le Zérafchân. Ces belles et hautes cimes que j'avais depuis si longtemps admirées de loin, je pouvais maintenant les contempler à mon aise; j'avais à droite la chaîne du Zérafchân que nous devions visiter le lendemain, à gauche celle du Turkestan.
Cependant je tremblais à l'idée des dangereux hasards de la route je savais que les précipices se creusaient sous nos pieds et qu'il fallait les côtoyer à cheval sur un sentier à peine large de soixante centimètres. Trois essais d'équitation ne font pas une écuyère, et vous comprendrez mon épouvante en apprenant que je suis sujette au vertige. Il ne fallait rien moins que le magnifique tableau qui se présentait à nos yeux et le panorama encore plus grandiose du lendemain pour calmer mes craintes. En ce moment nous étions arrivés sur le plateau d'une des nombreuses chaînes qui forment les premières assises des montagnes; au loin coulait la rivière; à nos pieds, un village avec ses prairies, ses arbres, ses bestiaux:; autour de nous, des corbeaux au dos bleu-turquoise et aux ailes jaunâtres voltigeaient de branche en branche; au-dessus de nos tètes planaient les aigles, qui avaient été nos compagnons de route. Notre voiture à travers montées et descentes, nous conduisit à la tombée de la nuit à Pendjekend.
M. Arrendarinko, le natchalnique (1) de l'endroit, était prévenu de notre arrivée; un bon dîner nous attendait. Nous fûmes étonnés de trouver dans ces lieux écartés une maison aussi jolie et dotée d'un confort européen.
1. Chef de district, espèce de préfet militaire.
Notre hôte nous invita à passer chez lui la journée du vendredi et à ne partir que le samedi; je profiterais de cette halte pour essayer mon cheval et me familiariser avec lui.
Toute la matinée du lendemain fut consacrée à mensurer des crânes galtchas; j'aidais mon mari, écrivant sous sa dictée afin d'aller plus vite en besogne. Rien n'était plus curieux que la surprise de ces gens, surtout quand M. de Ujfalvy glissait aux pauvres quelques kopecks dans la main; ils n'en croyaient pas leurs yeux; leur flegme musulman en était déconcerté. Habitués à tout faire par ordre, ils ne pouvaient comprendre qu'on récompensât leur obéissance.
Deux crétins furent amenés pauvres êtres, à peine vêtus, on les traînait comme des animaux; l'un d'eux se laissa mensurer en grognant et sourit cependant à la vue de l'argent, action tout instinctive, car, semblable à l'animal dont l'intelligence s'éveille à la vue de la pâtée, il reconnaissait sans doute le métal qui satisfait ses premiers besoins. L'autre, plus grand, à l'air moins hébété, ne put cependant rester tranquille; il fut impossible de le faire asseoir et l'on dut renoncer à le mensurer; il ne sourit même pas à la vue de l'argent.
Cette opération terminée, nous sortîmes pour visiter la localité.
Pendjekend est une petite forteresse située à soixante-deux kilomètres de Samarkand, sur la rive gauche du Zérafchân. La ville est arrosée par une rivière qui descend des monts Altab et se trouve entourée de hautes montagnes. Il y régnait autrefois un beg presque indépendant de l'émir de Bokhara; le parc de son ancienne résidence est fort beau. Les habitants sont d'excellents tireurs; le pays est du reste très-giboyeux. Ils se l'allièrent aux Russes non sans résistance la Russie y est représentée par trois fonctionnaires et une petite garnison.
Pendant que je contemplais avec épouvante les flancs arides et nus de la montagne voisine, on nous amena nos chevaux; vérification faite de mes talents d'écuyère, je me vis formellement exclue de l'expédition. La pluie menaçait pour le lendemain, le chemin était périlleux, ces messieurs eux-mêmes n'auraient pas trop de tout leur sang-froid pour le parcourir. Ce fut M. de Ujfalvy qui, usant ou abusant dc son autorité, formula la sentence et décida que je retournerais à Samarkand le soir même en compagnie de M. X. Il me fallut obéir à contre-coeur. Combien je regrettai de ne pas m'être exercée à Tachkend! Je me promis de réparer ma faute.
XI Une fête sarte à Samarkand. Les danseurs Batchas.
Le général Ivanoff m'invita à une fête indigène donnée en adieu aa général Abramoff. Je résolus de m'y rendre en compagnie de la baronne A... Le soir donc, la voiture s'engagea dans une allée
splendide toute couverte d'arbres; le karagatche (1) entre autres, au feuillage si épais et si fourni que le soleil ne peut le traverser, dessinait dans l'ombre sa forme ronde et gracieuse. Des lampions garnissaient toute l'avenue, et les femmes indigènes, afin de voir sans être vues, s'étaient hissées sur le toit de leurs maisons et nous regardaient passer.
Au bout de l'allée apparut à nos yeux une ancienne mosquée, privée, il est vrai, de ses belles faïences, mais éclairée en ce moment par une illumination qui lui faisait une ceinture éblouissante dont le reflet était tamisé par les grands arbres qui l'entouraient; ces arbres étaient à leur tour mis en relief par des torches que lis indigènes tenaient en main. L'effet était étrange.
Une galerie, éclairée de bougies et de lanternes, nous conduisit à, une vaste rotonde dont les murs étaient garnis de feuillage et tout illuminés. Au centre était dressée une table garnie de fruits et de confitures du pays, autour de laquelle étaient assises les dames russes.
La rotonde où nous étions constituait la mosquée principale; des deux côtés, trois autres rotondes de moins en moins élevées formaient comme deux longues galeries au fond desquelles et dans la pénombre se détachaient une foule d'hommes au visage bronzé, à la barbe noire, que la blancheur de leur turban faisait encore ressortir; leurs khalats de toutes couleurs paraissaient encore plus beaux la lumière et par la diversité de leurs nuances sur lesquelles se détachait crûment le costume blanc à boutons d'or des officiers russes.
Tout le monde causait, se promenait pèle-mêle. Un habitant de Fân (vallée supérieure du Zérafchân), qui savait que mon mari était allé dans les montagnes, demanda à m'être présenté.
On me conduisit voir la danse des indigènes. Autour d'un immense tapis (luxe du pays), dix indigènes, assis à la turque, tenaient entre leurs mains des instruments de musique, six tambourins, deux sortes de flûtes, deux autres espèces de tambourins. Au signal donné, ils partirent tous ensemble et, pendant une demi-heure, exécutèrent à peu près la même note; impossible de démêler une mélodie quelconque. Pendant ce bruit musical, deux hommes se placèrent sur le tapis en face l'un de l'autre et commencèrent à faire. quelques pas modulés avec des castagnettes; un troisième se mêla bientôt à eux.
1. Espèce d'orme, Ulmus pumila, campestris?
Au bout de cinq minutes, six beaux jeunes gens, des batchas, exercés au métier de danseur, se levèrent et se mirent à danser; les plus petits faisaient des cabrioles sans rompre la mesure, les autres tournaient et retournaient en se prenant de temps en temps une de leurs tresses de cheveux qui pendaient très-long derrière. Enfin, deux hommes avec des assiettes en métal au bout d'un bâton jonglèrent avec l'adresse merveilleuse des acrobates de nos foires et de nos cirques. Cette danse, je dois le dire, n'a rien de particulier, ni surtout de gracieux, mais les indigènes paraissent s'en délecter. Les musiciens s'échauffaient tellement que les joues des flûtistes semblaient prêtes à éclater et que les autres exécutants animaient les danseurs autant de leurs gestes que de leur musique. En levant la tête, je vis le toit de la mosquée garni de curieux.
J'aperçus aussi quelques femmes turcomanes (me dit-on) qui, visage découvert, assistaient à ce spectacle. Je me promenai ensuite dans les jardins, dont les allées étaient couvertes de tapis et éclairées par des lanternes vénitiennes. Quelques indigènes indolents étaient couchés ou assis sous les ombrages; pour eux, la terre est un sommier moelleux qui leur sert à la fois de siège et de lit; un tapis dessus, et tout est dit. On servit une collation. On offrait comme rafraîchissement aux indigènes des glaces faites avec de la neige et du miel; la même cuiller leur servait à puiser dans les soucoupes.
Quelques instants après on apporta le souper, qui se résumait dans un pilao (riz et mouton), plat sacramentel des Orientaux. Avec cette insouciance et ce laisser-aller des moeurs primitives, quoique assis sur des chaises et autour d'une table européenne, ils mangèrent tous dans le même plat avec leurs doigts pour tout ustensile.
Après avoir regardé les convives sans velléité de partager leur repas et admiré deux anciens begs, je me retirai sur les deux heures du matin.
XII Retour d'excursion. Pont bâti par une femme sur le Zérafchân. Ouroumitane. Le kâzi. Wachân. Le pied d'un saint. Montagnards.
A trois heures, mon mari rentrait, après avoir passé dix jours dans les montagnes, ravi du spectacle qui s'était déroulé à ses yeux. Ces messieurs étaient partis à cheval, comme il avait été convenu le samedi, avec M. Mirzki, quatre cosaques, cinq ou six indigènes, un interprète et des guides. Jusqu'à Ichist, le chemin est assez praticable pour des cavaliers. Ils avaient franchi le Zérafchân au moyen d'un pont double, le premier en bois, le second en pierre. Ce dernier a été construit par une femme, et on a placé dessus, dans un roc taillé à cet effet, une plaque commémorative avec cette inscription
« Ce pont a été bâti en 1233 de l'hégire par la femme Charifa Avoushaïef. Il s'est trouvé une femme qui était meilleure que les hommes et fit construire ce pont pour faciliter les communications. Les hommes n'y auraient pas pensé, etc., etc. »
Ces messieurs passèrent la nuit à Ichist; ils y trouvèrent les maisons construites en pierres selon le type usité en plaine. Le lendemain, ils partirent pour Ouroumitane, le pays des Falgars.
La route est très-difficile; ces messieurs furent obligés de faire l'ascension d'une montagne, entre autres si raide, que les indigènes disent qu'on doit avoir la conscience nette pour s'y engager. Il fallait encore passer sur des chemins qu'on appelle corniches, ayant à peine une archine de large (71 centimètres) et qui sont bordés par d'effroyables précipices. Il y a aussi des passages appelés balcons; ce sont des chemins que les indigènes ont construits à l'aide de terre et de branchages pour élargir le sentier de la montagne dans des passages si étroits qu'il devenait impossible d'y mettre le pied.
Au fond, le Zérafchàn roule ses eaux avec un bruit affreux qui ajoute encore à l'horreur du spectacle. Cependant l'œil est en extase le versant scptentrional de ces immenses montagnes est planté de genévriers qui atteignent parfois la grosseur d'un chêne; le versant sud, au contraire, est d'une aridité et d'une nudité à faire frémir. Si le cheval fait un faux pas, rien ne peut le retenir; l'oeil mesure à une profondeur indéfinie ce fleuve qui pourrait être un tombeau. Les ponts sur lesquels on passe, longs d'à peu près six à dix mètres et larges de quatre-vingts centimètres, sans garde-fous, sont faits pour vous donner le vertige; ajoutez qu'ils balancent sous les pas du cavalier , et que les poutres sont assez distantes pour que le pied d'un cheval y puisse trouver le vide. Ces nobles bêtes ont tellement le sentiment de leur danger qu'on est stupéfait de la précaution avec laquelle elles marchent sur ces routes, pourtant assez bien entretenues, dit-on! Ce n'était pas le cas de s'écrier comme Philinte a La chute en est jolie, amoureuse, adorable! » Toute la journée ils marchèrent ainsi et arrivèrent le soir à Ouroumitane, petit village dont la situation est très-pittoresque, ce dont je ne doute nullement avec un pareil cadre. Ouroumitane est situé à quatre mille trois cents pieds au-dessus du niveau de la mer. On y voit les restes d'anciennes fortifications devenues aujourd'hui l'habitation du kâzi (juge indigène) du district. Le kâzi décide les procès des particuliers, il juge des délits et des crimes d'après la loi islamique. Cette loi est écrite en arabe, et le juge en est à la fois le traducteur et l'interprète. Les kâzis sont ordinairement élus par le suffrage. Le lendemain, ces messieurs se rendirent, par un chemin encore plus difficile, à Wachân, village au pied de la montagne du même nom, dont les cimes neigeuses s'élèvent jusqu'à une hauteur de onze mille pieds anglais. Mon mari fut le premier Européen qui visita ce village. Ces messieurs passèrent devant une mosquée cachée par un bouquet de verdure et érigée en l'honneur du saint Khodja-Moullah ; M. de Ujfalvy put emporter une pierre très-curieuse où, selon la légende, s'est appuyé le pied du saint; cette pierre porte, en effet, l'empreinte d'un pied.
Les habitants de ces montagnes sont généralement honnêtes et bons cultivateurs; la moindre petite partie de terre labourable est ensemencée par eux, et cela à de telles hauteurs qu'on se demande comment l'homme peut y atteindre. Ce sont d'ordinaire de grands et beaux hommes, aux traits fins et réguliers, à la barbe abondante; ils. parlent un dialecte persan qu'ils comprennent tous, à l'exception des montagnards de la vallée du Iagnaube; ils se marient entre eux, car leurs vallées inaccessibles ne sont pas faites pour y conduire les autres femmes; par cela même leur race s'est conservée beaucoup plus pure que celle des Tadjiks de la plaine. Ils n'ont généralement qu'une femme ils peuvent pourtant en avoir plusieurs, selon la loi de Mahomet. Leurs villages sont entourés de vergers dont ils sèchent les fruits; ils en mangent énormément et en font aussi le commerce; ils boivent du lait caillé mélangé d'eau et qu'ils appellent aïran [ayran]. Leur industrie est très-restreinte; ils fabriquent de la toile et une espèce de drap où ils taillent des chemises et des khalats d'hiver. Leur khalat d'été est fait d'une toile rayée. Ils possèdent à Soudjana, près de Pend je ken d, quelques filatures qui occupent beaucoup d'ouvriers. Comme arme ils ont un fusil qui ressemble à celui des Kirghises que nous avons vus dans les steppes. Lorsque mon mari voulut les mensurer, on fut obligé de les pourchasser, car ils croyaient à un recrutement forcé. Le kâzi parvint à faire entendre raison aux vieillards; mais, pour les jeunes, il dut les poursuivre à quatre pattes et les amener de force; cette sorte de chasse à l'homme ne manquait pas d'originalité.
XIII Visite à un Tadjik. Intérieur. Par où l'on-voit sa fiancée. La fourchette du père Adam. La femme, l'ami, le mari et le petit voisin.
Dans la semaine qui suivit le retour de mon mari, nous allâmes, la baronne et moi, visiter la maison du Tadjik Maximka, homme fort intelligent, d'ancienne noblesse, prétend-il, et devenu commissionnaire fournisseur des Russes. Nous l'avions prévenu, aussi ses compatriotes étaient-ils en émoi et nous considéraient avec curiosité, sachant que nous allions chez un des leurs. La voiture s'arrêta devant une petite maison située dans une rue très-étroite et voisine du bazar; Maximka nous attendait sur le seuil; il nous fi t franchir tire petite cour carrée, puis une porte-basse donnant dans une pièce dont le sol était tapissé et où, devant un divan, nous trouvâmes une table chargée d'une collation. Cette pièce était garnie de tringles en bois supportant un grand nombre de vêtements. Pour une salle à manger, le décor est original; cette friperie, en Asie centrale, est le luxe des riches et le lustre des pauvres. Il nous invita à nous asseoir sur le divan et, nous offrit du thé et la vue de ses deux femmes. L'une était âgée de quarante ans; il l'avait épousée étant veuve et ayant déjà un fils; elle avait dû être très belle. L'autre était toute jeune seize ans; il venait de l'acheter quatre mois auparavant; il en attendait des enfants, que l'autre n'avait pu lui donner. Il désirait vivement que la jeune femme devînt mère, car il ne voulait pas être obligé d'en prendre une troisième. « Elles se disputent déjà, dit-il, assez toutes les deux; je ne puis faire un cadeau à l'une sans le faire à-l'autre, ce qui me revient assez cher. » Il nous dit aussi que, pour la première femme, il avait été trompé, qu'il la croyait plus jeune et sans enfant. Bon pays pour les parents qui ont des filles laides à marier! La baronne lui demanda s'il avait au moins pu voir la seconde avant le mariage. « Oui, répondit-il, ma mère me l'a fait voir par un petit trou, lorsqu'elle était à coudre, et elle m'a plu. Nous trouvions son goût extraordinaire, car, à l'exception de ces yeux noirs qu'elles entourent toutes d'une épaisse couche de peinture ou kohl, elle n'était rien moins que jolie; à peine avait-elle ce que nous appelons, en France, la beauté du diable; petite, brunette, figure assez commune, ne reflétant aucune intelligence; elle soutenait difficilement la comparaison avec l'autre femme, qui paraissait se sentir une âme, sentiment assez rare, je crois, chez ces pauvres créatures, dont la timidité et la crainte sont ce qui nous frappe le plus.
La jeune mariée paraissait adorer son maître, qu'elle ne quittait pas des yeux. Elles étaient toutes deux assez bien mises et dans le même genre que celles que j'avais vues; la jeune seulement avait la tête couverte d'un bonnet, semblable au bonnet grec, auquel pendaient, des deux côtés de la figure, de grands bijoux argent et pierreries. Les bijoux en or sont portés plus rarement. Elles avaient toutes deur les pieds nus; la plus âgée nous servait et mettait ses babouches chaque fois qu'elle allait dehors, mais elle avait bien soin de les retirer aussitôt qu'elle rentrait dans la chambre. C'est, du reste, l'usage chez les Orientaux.
Après la collation nous fûmes forcés de manger un pilao, qu'ici on appelle ach (nourriture) c'est le seul mets qu'on serve aux étrangers. Naturellement il n'y avait pas d'assiettes; la baronne et moi, nous mangeâmes dans le plat, mais on nous donna des cuillers ces dames avaient les fourchettes de leur mère Ève. Mme A. pria Maximka dc laisser manger ses femmes; la plus âgée apporta ,alors du pilao dans un plat un peu plus petit, et, s'asseyant à côté de sa compagne; elles mangèrent, chacune avec leurs trois doigts. Le mari même, plus ait fait des usages russes, aurait volontiers mangé comme nous, n'étaient ses épouses, qui lui eussent, paraît-il, immédiatement demandé, d'un air de pudeur effarouchée « Eh bien! et tes doigts?. à quoi te servent-ils?.. » C'est une grande marque de faveur que vous fait l'amphitryon, lorsqu'il vous introduit les morceaux dans la bouche. Le comble de la faveur serait sans doute d'y fourrer la main tout entière. Heureusement Maximka, ait fait de nos répugnances, n'eut pas cette idée; il se contenta de nous servir. Nous causâmes avec lui plus d'une heure; il nous fit voir sa belle-fille, jolie enfant, à peine âgée de quinze printemps, qui en nourrissait un autre de onze mois.
Les bébés sont placés dans un berceau si étroit, que les pauvres petits êtres ne peuvent faire un mouvement. Lorsque c'est un garçon qui naît, toute la maison est en réjouissance, et les amis sont invités à prendre part à la fête ; si c'est une fille, on ne se donne pas la peine de célébrer son arrivée dans cette vallée de larmes. Maximka nous dit aussi qu'il voudrait bien que sa première femme s'adonnât au commerce, a car elle était assez instruite pour tromper les clients ». L'instruction est ici, chez les femmes, une chose bien rare; à peine, généralement, savent-elles lire. Mais elle ne voulait pas y consentir.
La baronne pria notre hôte de laisser venir sa première femme chez elle; mais, malgré les plus vives instances, il ne voulut pas y consentir. Il nous apprit que la femme ne sort jamais avec son mari; quand elle se rend c!wz ses amie, un de ses parents ou un ami du mari vient la chercher; il la prend en croupe à défaut d'un un petit enfant les accompagne pour les surveiller.
Comme on se trompe! J'avais toujours cru, lorsque j'avais vu ces trois personnes sur un même cheval, que c'étaient l'enfant, le père et la mère. Eh bien! pas du tout. C'était la femme un ami et un petit voisin, qui ne sentait peut-être pas toute la portée, toute la signification de son rôle.
Jusqu'à l'âge de treize ans les garçons sont confiés aux femmes plus tard on les retire de leurs mains. Pendant nous étions à causer, une jolie et curieuse voisine s'enhardit à venir nous examiner jusque devant la porte; sans y penser, la baronne demanda à Maximka. « Quelle est donc cette jolie femme ? » Mais lui, au lieu de la regarder, détourna la tète. La jeune curieuse, se voyant découverte, s'enfuit aussitôt. C'est, parait-il, un péché de regarder une femme qui ne vous appartient pas. Nous restâmes encore quelques instants à causer et nous répartîmes après avoir serré la main à notre hôte ainsi qu'à ses femmes. Maximka nous reconduisit jusqu'à notre voiture en nous saluant jusqu'à terre et les bras croisés dévotement. Ces manières de saluer sont trop serviles pour être sincères; on sait d'ailleurs que ceux qui s'inclinent le plus bas seraient les premiers à nous tuer s'il arrivait une révolte.
XIV Les courses. Le jury des récompenses s'attire des désagréments. Cadeaux. Comment les chevaux s'arrêtent en route. L'émir pensionné. Départ de Samarkand,
Pendant les dix jours que le général : Ibramoff resta à Samarkand, ce fut une continuité de fêtes, déjeuner-dîners, soupers.
Le samedi, il y eut une course de chevaux à quatre heures. Nous nous y rendîmes par une jolie route, mais la poussière et la chaleur commençaient à se faire sentir. Le champ de course est admirablement situé dans une vaste plaine bordée à droite par les montagnes, à gauche par un village tadjik très-pittoresquement bâti et d'un charmant effet, malgré ses maisons en terre éclairées par le soleil.
Au milieu du champ de course s'élevait une tente ornée de toutes sortes de drapeaux et au centre de laquelle était dressée une table garnie de victuailles; à gauche, sur une autre petite table, s'étalaient les prix. Dans le lointain, de beaux arbres reposaient la vue par leur verdure, dont la fraîcheur était encore rehaussée par la teinte sombre et argentée des hautes montagnes dressant fièrement leurs cimes élevées.
On eût dit, tant la foule était grande, que tous les Orientaux s'étaient donné rendez-vous sur le champ de course, les uns encore à cheval, les autres à terre, près de leur monture; d'autres, nonchalamment couchés, attendaient le signal pour secouer cette torpeur, justifiée par l'excès des rayons solaires. Enfin, les deux généraux étant arrivés, le signal fut donné.
La première course était celle des officiers cosaques, la deuxième des sous-officiers, la troisième des simples soldats. Quoique les chevaux ne fussent pas spécialement entraînés pour cette fête, leur galop fut vraiment rapide; la piste était si bien disposée, qu'on pouvait la suivre sans interruption il n'arriva aucun accident. A la fin de chaque course, le général Abramoff remit au vainqueur la récompense, qui consistait en une coupe, une montre en or, etc. La quatrième course, fut celle des amateurs; le cheval d'Abdour-Akhmàn, ex-émir de l'Afghanistan, arriva le premier. Une cinquième course fut affectée aux indigènes, que l'on fut obligé de répartir en trois ordres. Le nombre des concurrents causa néanmoins quelque confusion. Il,y eut aussi des malentendus, car ces trois courses n'en faisaient qu'une- au point de vue des ré- compenses; on décerna les prix au groupe qui avait accompli le trajet dans le temps le plus court. Ceux qui arrivèrent les premiers dans les deux autres groupes ne purent jamais comprendre comment ils ne recevaient rien. En dépit des explications qu'on put leur donner, ils partirent avec un mécontentement que la vue des beaux khalats donnés à leurs concurrents n'était pas faite pour apaiser.
En revenant à la maison, la poussière était si épaisse que nous étions tout blancs.
Le général Abramoff fit offrir à mon mari, par l'entremise de M. S... une belle housse en velours rouge brodé d'or, ainsi qu'un harnais en cuir tout incrusté de turquoises, travail particulier aux Sartes. Les creux, au lieu d'être en émail, sont en turquoises assujetties à l'aide d'un mastic.
Une députation de l'émir de Bokhara, envoyée au colonel étant arrivée pendant notre séjour, j'eus occasion de voir les chevaux parés de ces ornements précieux que fait resplendir le chaud soleil d'Orient. Les députés apportaient de la part dé l'émir des cafetans et des chevaux; le colonel leur donna en échange les cafetans qu'il avait reçus de la députation précédente, et ils partirent enchanté. Quant au cheval, déde ses ornements, il fut vendu à peine quinze roubles.
Lorsque je racontai cette histoire au général Kaufmann, il m'assura que l'émir envoyait de très-beaux chevaux, mais que les envoyés les revendaient en route et en achetaient d'autres à la place; de cette façon le bénéfice est tout net l'homme a l'argent et le cheval n'a pas la route à faire. « Je n'ai pas voulu dévoiler cette supercherie à l'émir, ajouta Son Excellence, car il aurait fait couper la tète à ses envoyés. »
Avant de quitter Samarkand, mon mari apprit que les deux lévriers (tazi) du'il avait achetés lui avaient été procurés par Abdour-Akhmân, l'ex-émir d' Afghanistan, que nous avions vu aux courses. Cet ancien émir vit à Samarkand d'un revenu annuel de vingt-cinq mille roubles sur la caisse du tzar. Après sa défaite, il avait demandé deux cent mille roubles une fois pour toutes, mais la demande avait été trouvée exagérée; peut-être aussi avait-on peur qu'il ne cherchât encore à soulever ses anciens sujets. Dans ce cas, l'économie eût été faite mal à propos sans doute il aurait soulevé ses sujets, mais probablement contre les Anglais, et les Russes auraient bientôt regagné l'intérêt de leur argent. Voilà déjà dix ans qu'on lui paye cette pension, et il faudra la lui payer longtemps encore. C'est un assez bel homme, fort et trapu, qui me faisait l'effet d'un hercule forain; sa suite comptait des cavaliers d'une beauté remarquable. Cet ancien émir vit d'une manière assez piteuse, économisant le plus possible, en vue d'une occasion de reconquérir son trône et faisant du trafic à tout propos. Il fit offrir à mon mari deux sabres d'une valeur très-médiocre à des prix exorbitants.
Enfin, nous dûmes quitter nos hôtes et partîmes après de touchants adieux; j'embrassai avec effusion la baronne, en lui faisant promettre sa visite à Paris.
ERRATA. Page 20, deuxième colonne, quatrième ligne d'en bas, lisez le Sogd au lieu de le Scod.
XV Un directeur de théâtre et la Bourse. En pleine chaleur. Une garniture de salon volante. Rétlexions dans une antichambre à propos de bêtes. Fraises, melons, navets et carottes. La bibliothèque. Bombes à feu grégeois. Soirée. Nous campons.
A la première station après Samarkand, nous fîmes la rencontre d'un ex-directeur de théâtre en voyage les directeurs s'en vont comme les rois, dit la chanson. Celui-là venait de Sibérie; il avait brûlé ses décors (par inadvertance, j'aime à le croire) et se transportait à Tachkend pour y populariser le grand art. Il apportait plusieurs plans réorganisateurs, de la bonne volonté et quelques quinquets. Ajoutez qu'il était compatriote de l'auteur des Walkyries. Nous apprimes que Tachkend l'avait accueilli à bras ouverts. On y avait voulu bâtir une bourse, sous les portiques de laquelle se fussent réunis les marchands, à défaut de banquiers. Mais l'édifice avait compté sans ses hôtes et personne ne s'y était réuni. C'est alors que notre Allemand fit son entrée il sauvait la situation. Des salles de théâtre Monsieur, des théâtres, s'écria-t-on,
mais nous en avons!! » Et on le mena à la Bourse. L'histoire est véridique. Comment le pauvre diable se tira-t-il d'affaire ? Je l'ignore; au moins put-il un instant se persuader qu'il a été réellement directeur d'un vrai théâtre à Tachkend.
Nous reprîmes donc la route que nous avions déjà parcourue; mais quelle différence! il faisait une chaleur étouffante. Lorsque nous arrivâmes au Zerafchân, le fleuve n'avait pas atteint sa hauteur normale; il était cependant plus large et plus profond du double que la première fois.
J'eus un immense plaisir à revoir la porte de Tamerlan elle me sembla encore plus belle et plus grandiose; cette fois je l'aperçus d'une hauteur qui dominait un panorama immense, où seules les deux pointes de rochers relevaient fièrement leurs têtes. Le ruisseau que M. de Ujfalvy avait franchi à cheval s'était, comme les autres, considérablement grossi; il coulait ses ondes limpides avec un bruit qui rendait le spectacle plus imposant; les aigles, calmes et fiers, volaient encore au-dessus de nous.
Bientôt nous entrâmes dans les plaines que nous avions quittées si verdoyantes. Hélas! quel changement Au lieu de cette verdure et de ces couleurs si fraîches et si variées, séduisante parure du printemps, une terre sèche et brûlée, où de petites tiges:rabougries semblaient demander grâce Pour comble de désagrément, notre voiture soulevait autour de nous un nuage de poussière qui nous desséchait la gorge. Des myriades de mouches nous donnaient la chasse. Vous comprendrez la souffrance de pauvres voyageurs demi-couchés dans une voiture où l'entassement des matelas et des oreillers augmente encore la chaleur. Le voyage devenait un véritable supplice, et un supplice dont nous ne prévoyions pas la fin. Ces nuées de mouches nous empêchaient de dormir. Pour nous rafraîchir, on nous proposait du c~was, boisson russe, comme le cidre est la boisson normande et bretonne. Le qwa's se fait avec du seigle et quelques plantes odorantes, telles que la menthe. Jusqu'alors cette boisson m'agréait peu; en ce moment elle nous parut un nectar. Elle a le mérite d'être rafraîchissante. Il faisait encore bien chaud quand nous nous décidâmes à continuer notre voyage; mais après deux heures de supplice, le soleil s'était couché, et quand nous arrivâmes à Maleskaïa, petit fortin, la température était très-supportable. Les chevaux changés, nous repartîmes tout de suite. Il nous fallait passer le Syr-Daria par la nuit noire.
Une heure plus tard, nous étions à Tchinas. Nous voulions continuer notre route, mais, nous étions fatigués, et comme nous avions grand'faim, n'ayant rien mangé depuis cinq heures du matin, et que le chef de poste nous offrit des mufs et du lait, nous profitâmes de cette rare bonne fortune, non sans regretter qu'on ne nous servît pas aussi la poule qui pondait si bien. A quatre heures du matin, nous repartions, laissant enfin les steppes derrière nous. A la station appelée Vieux-Tachkend (Stari-Tachkend), je fis remarquer à mon mari une jeune femme kirghise vraiment fort jolie, brune et bien faite, au visage agréable, quoiqu'il fût carré; elle se laissa très-complaisamment contempler par mon mari, qui s'était approché d'elle pour la mieux voir. Elle était à la porte d'un jardin, à quelques pas de sa kibitka; à l'entrée de laquelle elle alla s'asseoir en travaillant. A dix heures du matin, nous étions de retour à Tachkend.
Nous reprîmes nos anciennes habitudes; mais beaucoup de nos connaissances étaient en villégiature, car, dans les environs de la ville, les Russes se sont bâti des datcha ou villas d'été.
Je vis là une étrange garniture de salon de jolies hirondelles avaient fait leurs nids dans les corniches aux quatre coins de la pièce de réception de Mme de K. les gracieuses petites bêtes ne s'effrayaient en aucune façon de notre présence, et voltigeaient comme chez elles du salon au jardin, et réciproquement. Cette scène était vraiment originale; jamais je n'aurais rêvé pareille ornementation pour les angles d'un salon. Par ce petit détàil, on peut voir combien les bêtes sont ici familières. Il est vrai que l'exubérance de vie animale est surprenante; on trouve une diversité d'animaux et surtout un fourmillement d'insectes vraiment incroyables. Heureusement, à part quelques espèces nuisibles, scorpions, phalangides et tarentules, les bêtes me paraissent beaucoup plus douces que chez nous. Les chevaux eux-mêmes ne sont pas rétifs; je n'en ai jamais vu s'emballer; ce sont pourtant tous de beaux étalons, mais leur docilité est surprenante.
Les musulmans se croiraient déshonorés s'ils montaient des juments qu'ils destinent à la reproduction cette considération, qu'ils témoignent à la maternité chevaline, s'étendra peut-être à leurs femmes. Il est vrai que les chiens sont méprisés, comme toutes les bêtes qui se chargent de la voirie dans les pays orientaux. Une seule espèce fait exception, c'est celle des chiens turcomans ou tazi (lévriers), qu'on emploie pour la chasse. Pourtant je n'ai jamais vu un indigène caresser cet animal et lui donner à manger avec la main.
Les Russes ont importé quelques porcs; ils sont encore relativement peu nombreux et n'osent pas se montrer dans l'intérieur de la ville. Nous les rencontrons, en montant à cheval, le soir, dans les faubourgs.
Le gouverneur général a fait importer des arbres de France, ainsi que des fraises, inconnues jusqu'alors en Asie centrale; elles deviennent tout aussi grosses et aussi bonnes que les nôtres; les petites fraises de bois promettent de s'acclimater très-bien, mais elles sont encore peu nombreuses. Les melons ont fait leur apparition à Tachkend; il me parut que leur réputation n'était pas surfaite; ils sont sucrés et très-fondants. Le général me fit goûter des cerises dont les arbres avaient été greffés; elles étaient d'une douceur peu commune ici, car celles que j'avais goûtées jusqu'à présent à Tachkend étaient non-seulement acides, mais encore amères. Les légumes de notre pays viendraient très-bien, du reste, dans cette terre; le potager du gouverneur en est une preuve irrécusable. Les indigènes, qui ont constaté le goût prononcé des Russes pour les concombres, cultivent ces cucurbitacées avec bonheur; on en trouve des champs énormes autour de Tachkend; leur couleur verte y alterne avec les couleurs jaune et rouge des navets et des carottes. Nous fîmes aussi la connaissance de M. A. conservateur du musée de Tachkend, et dont on ne s'avisait pas de contester la science au Turkestan. Il avait été favorisé à la loterie du mariage; sa femme, dont les goûts étaient en harmonie avec les siens, n'aimait pas le monde; l'un et l'autre sortaient très-peu. Nous allions quelquefois dîner chez eux, et mon mari trouvait dans la conversation de cet entomologiste dis- tingué une distraction utile et agréable. Mme A. et moi nous nous amusions souvent à les entendre discuter. M. A. me montra une superbe collection de. punaises! J'avoue humblement que je ne me serais jamais doutée qu'un pareil insecte comptàt une aussi grande variété d'espèces.
M. A. dirigeait en même temps la magnanerie et le musée ethnographique de Tachkend. Ce dernier renferme une foule d'objets curieux. Je remarquai, entre autres, à coté du bonnet fourré et richement orné du dernier usurpateur du Khokand que les Russes ont fait pendre en place publique à Marghellâne, des bombes à feu grégeois et une cloche en bronze massif trouvées dans des fouilles près de Tachkend. Les savants du Turkestan croyaient avoir affaire à des ornements de mur en terre cuite. M. de Saulcy, qui eut un des premiers l'occasion d'examiner les objets rapportés par mon mari, déclara tout de suite que c'étaient des bombes à feu grégeois.
La bibliothèque que Tachkend possède, grâce à l'initiative du gouverneur général, est vraiment très-bien montée; on y trouve des volumes imprimés dans toutes les langues,
A quelque temps de là, il y eut aussi une très-jolie soirée à l'occasion de la naissance du général; tout le jardin fut éclairé a giorno, et je pus voir réunies toutes les personnes distinguées de Tachkend. Un seul indigène, avec son cafetan, assistait à cette fête intime; les notabilités sartes ne sont invitées qu'aux soirées officielles.
La soirée fut très-belle et très-animée; on se promenait, aux sons de la musique militaire, dans les pittoresques allées de la terrasse, dont les massifs de fleurs étaient rehaussés par l'illumination. L'orchestre, en exécutant l'air des Pompiers de Nanterre, me causa une étrange surprise; cet air, auquel à Paris je n'avais prêté aucune attention, me parut ravissant, car il me transportait en pensée dans ma ville natale et me laissa croire un instant que je me promenais dans les Champs-Élysées par une belle nuit d'été; ô prestige de la musique, ô mon Paris! quelle fascination tu exerces à distance sur tes enfants! O ville unique, dont les perfections s'accusent à mesure qu'on s'en éloigne Ce Paris, cette ville qu'on dit infernale, où l'on n'a pas un moment à soi, où la vie se mène à la vapeur, où il faut aller, venir, sans une minute pour reprendre haleine, au milieu d'un tourbillon de pensées, d'affaires, d'agitations, d’événements, qui vous prennent sans qu'on ait le temps de, se reconnaître Et l'on dit qu'on voudrait en être à cent lieues. Me voici séparée de toi non pas de cent lieues, mais d'un millier de lieues et plus tu t'éloignes, plus je te regrette.
En attendant notre départ pour le Ferghanah, mon mari mit en ordre ses notes de son voyage à Samarkand moi, avec l'aide du Cosaque que le gouverneur avait bien voulu attacher à notre service, j'emballai sept grandes caisses, que nous expédiâmes au ministère, car d'emballeur, point! Ne sachant pas que l'on fonderait un musée spécial ethnographique, je mèlai aux spécimens d'ethnographie ces belles briques que nous avions pu nous procurer dans les mosquées de Samarkand.
La chaleur allait devenir terrible. Nous ne devions pas rester encore très-longtemps à Tachkend; mon mari avait terminé ses travaux. Nous nous décidâmes à nous abriter sous une kibitka; c'est un genre de domicile très-usité dans ces contrées où l'on habite le jour sa maison et la nuit une tente. La kibitka étant, paraît-il, l'idéal de la tente, nous en louâmes une qui fut installée dans le jardüi d'un de nos hôtes. Nous voilà donc installés
comme les indigènes, couchant sous un toit rond, dans nos petits lits de fer. Nos effets sont pendus au treillage en bois; le bureau de mon mari, le canapé, les armoires, les chaises, la table à manger sont dispersés dans les allées du jardin. Ce genre de vie ne présentait aucun inconvénient, et, Dieu merci, jusqu'à, notre départ pour le Ferghanah, nous n'eûmes ni fièvre, ni rhume, Iii aucune altération de santé. La veille de ce départ, nous allâmes diner chez le gouverneur et passer la soirée chez Mme de K. où toute la société nous souhaita un bon et heureux voyage.
XVI KHOKAND. Pskend. Yacoub-Beg et ses certificats. Où il est traité des melons et des femmes musulmanes. Kastakos. Makhram. Le Syr-Daria. Voyage désagréable. Khokand. Si nous trouvons la ville superbe, nous n'y trouvons pas à manger. La monnaie du pays nous n'en abusons pas. Le palais du khan et son pavillon rose. La forteresse. Précautions russes. Ce que les vainqueurs auraient dû exiger. Ce que les vaincus regrettent. On repart.
Le dimanche 1er juillet eut lieu le départ de Tachkend pour une expédition concertée entre le général Kaufmann et M. de Ujfalvy.
Nous étions accompagnés de deux professeurs au progymnase (collège de Tachkend), MM. Muller et W. Un pérévotchik, drogman d'origine tatare, avait été engagé par mon mari; il palilait le russe, ainsi que la langue des habitants avec lesquels nous allions nous trouver en contact; il portait le nom d'Abdoullah. Nous emmenions aussi notre fidèle Féodorof, le Cosaque que nous avait donné le général Kaufmann, soldat précieux à tous égards quoiqu'il ne parlât que sa langue maternelle nous nous entendions assez bien, car l'intelligence des soldats russes est telle, qu'ils comprennent à demi-mot. Nous nous mîmes en route le soir, comptant voyager de nuit; mais il fallut s'arrêter à la seconde station. Notre cave portative avait, plus que nous, souffert des cahots; elle épanchait son liquide le long de la route, qui ne lui savait aucun gré d'un arrosage aussi coûteux. Il fallut ouvrir la caisse et constater tristement le dommage. Je me repentis de n'avoir pas moi-même emballé les bouteilles, et, pour pénitence, mettant, comme on dit vulgairement en France, la main à la pâte, je fis ce que j'aurais dû faire d'abord, précaution d'autant plus importante que nous allions parcourir des routes encore plus mauvaises. Or, quand un starosta (chef de poste) déclare que la route est mauvaise, il faut prendre l'adjectif au superlatif car l'indigène est habitué à des routes qui n'ont rien de commun avec une table de billard. On ne put repartir avant trois heures du. matin, ce dont je fus vraiment contente, car ces quelques heures de repos forcé avaient été pour moi des heures de supplice, pendant lesquelles les insectes m'avaient tourmentée sans interruption.
A six heures, la chaleur était déjà gênante, et nous mourions de soif. La route était assez jolie, mais quelle différence avec lés chemins du district du Zerafchân Quelle peine aurait le gouverneur général pour mettre les voies de communication en bon état! Sur le Tchirtchik, les Russes ont bâti un pont qui, parait-il, a coûté fort cher; il est très-large et ressemble à une digue. Le pays que nous traversions s'appelle Kourama ; sa population se compose d'un mélange de Sartes et de Kirghises; il est fertile et bien cultivé. La station de Pskend est établie dans une espèce de petite ville où est né Yakoub-Beg, qui gouvernait en ce moment la Kachgarie, et que le général Kaufmann s'attendait à voir se réfugier d'un jour à l'autre à Tachkend, car les Chinois le battaient, et il était détesté de son peuple, qu'il ne contenait que par la crainte. Si ses sujets le craignaient, de son côté il craignait les Russes, auxquels il faisait bon accueil, tout en regrettant de ne pouvoir les exterminer. Au besoin, quand il renvoyait un voyageur, il lui faisait attester par écrit, en termes magnifiques, la maigre hospitalité qu'il lui avait donnée (1).
1. Ce fait est arrivé au colonel Prjevalsky, lors de son dernier voyage au Lob-Nor.
La ville de Pskend possède un bazar, dont nous aperçûmes au loin, sur la route, lès lumières ou, plus prosaïquement, les chandelles, qui éclairaient, dans leur petite maison de verre, les musulmans retardataires, étendus nonchalamment sur leur tapis et se racontant sans doute les évènements du jour qui étaient venus troubler leur vie monotone. Au delà de cette ville, l'aspect du pays changea brusquement, et nous parcourûmes une steppe entre deux montagnes à versants contrariés.
A la station de Murza-Abad, une simple tombe rappelle que là sont enterrés le starosta et les yemchiks, surpris et égorgés par les Khokandais en 1875. Le chemin devient de plus en plus pierreux, et nous traversons un défilé qui se trouve entre le Mogol-Taou et les contre-forts méridionaux des montagnes de Iiourama. Après avoir enfin rejoint le Syr-Daria, nous arrivâmes par un pont très-bien bâti, mais coupé au milieu par un passage volant, dans la ville de Khodjend. Il était deux heures du matin; nous fûmes cependant assez heureux pour y trouver deux chambres, à la station et y reposer nos membres endoloris. Au jour la ville de Khodjend nous apparut dans toute sa splendeur; elle est située sur le bord du Syr-Daria, dans les eaux duquel les montagnes hautes et escarpées du Mogol-Taou baignent leur pied. Ces montagnes semblent abaisser un regard dédaigneux sur la ville qu'elles protègent des vents de la steppe sibérienne, protection qui fait de Khodjend la ville la plus chaude et la plus étouffante du Turkestan. Il nous fut impossible d'obtenir des chevaux pour faire une visite dans ces montagnes. Nous nous rabattîmes sur les linéika (1), et, après une demi-heure d'attente, notre pérévotchik nous en ramena une ornée d'un tapis c'était la seule. Khodjend ne possédait que trois de ces équipages, comme Cadet-Roussel ne possédait que trois cheveux; le premier était en réparation, le second avait son cheval malade, le troisième heureusement était intact.
Pour l'essayer, nous allâmes d'abord visiter le bazar; mais, plaignez notre déconvenue, le bazar était désert, ce n'était pas le jour du marché. Quelques indigènes seulement achetaient des fruits; nous fîmes de même, et nous payâmes pour deux livres de pêche, quatre kopecks, à peu près douze centimes. Les pèches de la ville ne sont pas grosses et n'ont pas bonne mine, mais leur chair est délicieuse; ce sont les meilleures de l'Asie centrale. Le petit melon blanc nous parut également très-bon. Le raisin, toutefois, n'était pas encore assez mûr. On a ici trois espèces de raisins le noir, le blanc, et le tacheté.
Le bazar est petit et d'ailleurs peu remarquable; il était tout tendu d'étoffe blanche, et il y régnait une fraîcheur comparativement agréable.
Chemin faisant, nous rencontrons peu de femmes; la rareté de leur apparition n'est pas un mal, car le costume lugubre qu'elles portent et semblent enlaidir à plaisir n'a rien d'attrayant. Leur religion leur défend non-seulement de se découvrir le visage, mais encore d'attirer les regards; elles s'habillent toutes de même et le plus simplement possible, se collant, pour mieux se dissimuler, contre le mur, si elles s'aperçoivent qu'on les regarde.
1. Voiture de place usitée dans les villes russes du Turkestan.
Ce mouvement est assez mal imaginé, car il attire précisément l'attention des passants et surtout des infidèles, qui n'ont pas, comme les musulmans, l'habitude de détourner la tète à la vue d'une femme qui n'est pas la leur : un visage féminin fait ici l'effet de la tête de Méduse. On raconte que, à Tachkend, une femme que son mari avait renvoyée vint, voulant absolument voir son enfant, pendant huit jours, le visiter, sans que le père lui-même la reconnût. Et telle après cela, viendra se vanter d'avoir été épousée pour sa beauté !
A quatre heures et demie, nous nous remîmes en toute pour Kastakos, à dix-huit verstes de là; le pays a le même caractère qu'aux environs de Tachkend. Le starosta de Kastakos est un juif, ce qui est extraordinaire en Russie, où les juifs n'ont pas le droit de cité. A Saint-Pétersbourg même, pour en jouir, les juifs doivent être marchands de première gilde (espèce de corporation-maîtrise). Il n'y a, dans toute la Russie, que deux villes où ils puissent s'établir; par contre, ils sont libres d'habiter tel quartier qu'il leur plaira et de payer leur loyer aussi cher que possible. Entre Kastakos et Karatchoum, se trouve la frontière du Ferghanah. Quels chemins, grand Dieu! surtout après la traversée d'une steppe où pousse le yang-tang (1), herbe fort goûtée par les chameaux, et où nous avons roulé comme sur une table de billard. Nous pensâmes verser je ne sais combien de fois. Le ciel était étoilé, mais la terre ne reflétait guère la beauté du firmament; il chaque instant, se dressait la tête de gros rochers noirs, sorte de monstres immobiles qui semblaient attendre, pour nous déchirer, que notre véhicule vint à culbuter dans ce sol sablonneux. La lune ne se levai t qu'à minuit; mon mari résolut d'attendre cet astre paresseux, le starosta nous ayant annoncé un chemin encore plus exécrable. Nous nous couchâmes donc à la station, dans notre tarentasse. Le coup d'oeil de notre campement était vraiment étrange; un grand mur l'entourait et formait comme une cour. Dans un des angles, un officier russe avec sa femme et ses enfants dormaient sur des tapis; ils étaient à peine abrités par une moitié de tente. Pour nous, étendus sur des matelas, dans notre tarentasse, nous pouvions nous considérer comme des sybarites. Nos Françaises ne pourraient s'imaginer pareille manière de passer la nuit : le starosta et sa femme dormaient sur des lits devant leur porte dans la cour, les yemchiks, se vautrant dans leur kachma; les autres voyageurs, dans leur tarentasse; tout cela au milieu de chevaux, de chameaux, de moutons, de chiens, de coqs, de poules qui, si elles pondaient, ne pondaient pas pour nous. J'étais si fatiguée, que je dormis très bien et même plus tard que nous nc l'aurions voulu. Ce ne fut qu'à deux heures que nous nous remîmes en route; le jour commençait à poindre. Le chemin ne fut pourtant pas aussi mauvais qu'on nous l'avait annoncé.
1. Alhagi Camelorum
Nous passâmes Makhram, petite forteresse célèbre par la bataille que les Russes y gagnèrent en 1875, et nous assistâmes au repos de ces bons musulmans qui faisaient semblant de dormir du sommeil des justes sous les galeries de leur bazar; quelques-uns, réveillés sans doüte par le bruit de notre tarantasse, soulevaient à demi leurs paupières, qu'ils laissaient retomber aussitôt, en reconnaissant des chiens de chrétiens.

Makhram n'est pas éloignée du Syr-Daria, et nous revîmes notre bon ami, ce fidèle compagnon de route, qui semblait nous inviter à le suivre et nous dire que la vallée n'était pas dangereuse, puisqu'il y passait bien, et que les montagnes étaient pittoresques, puisqu'il se plaisait à leur voisinage. Ah! mon joli, joli Syr-Daria! on le revoit, on le quitte, mais pour le revoir encore.
Les steppes, toujours les steppes On m'avait dit que le Ferghanah était si beau; jusqu'à présent il n'y paraît guère.
Dès l'aurore nous gagnons Patar, où nous trouvons du lait. Le starosta couchait dans une tente qui valait bien mieux que sa laide maison. Patar est assez gentil, surtout en comparaison de la steppe qui devient de plus en plus laide, mais sans transition et comme les femmes musulmanes qui vieillissent. Les habitants ont tiré tout le parti qu'ils ont pu de cette terre; sur la lisière de la steppe, les arbres et la culture font voir jusqu'à quel point la puissance de l'homme peut lutter contre celle de la nature.
Au bout d'une heure et demie le désert prit fin et nous arrivâmes à Biche-Arik par une route comparativement ravissante. Mais il faisait si chaud que nous convînmes de rester là jusqu'au soir. Cette fois on nous servit du lait, mais si mauvais, si aigre, qu'il raclait le gosier. Nous pûmes y ajouter quelques oeufs, mais les mouches ne nous laissèrent pas dormir.
A quatre heures nous partîmes pour Khokand. Jusqu'à Tchoutchaï le Ferghanah nous semble un pays par lequel la guerre aurait passé; les maisons menaçaient ruine et les ariques étaient desséchées; quelques provisions de fourrages et quelques têtes nous regardant curieusement prouvaient seules que cette contrée n'était pas abandonnée. Les chemins défoncés étaient les plus mauvais que nous eussions encore traversés. Pourtant le khan s'était donné bien de la peine pour les ouvrir; l'exemple des Russes avait piqué son orgueil, il avait commandé des routes, on lui avait obéi; malheureusement ses ingénieurs n'avaient oublié qu'une chose, c'était de pourvoir à l'écoulement des eaux de la chaussée que la pluie avait transformée en marécage.
L'eau n'est pas très-abondante jusqu'à Khokand et chaque localité y participe à son tour; de là cette aridité qui nous avait frappés d'abord. Dans peu de temps, les choses allaient changer ce ne serait plus en avant, mais à partir de Tchoutchaï que le chemin serait désagréable. Ainsi va la vie aujourd'hui riante, demain triste et désolée; mais moins heureux que dans le Ferghanah, on n'est pas toujours sûr de voir revenir la prospérité. Pour le moment le village était charmant et la verdure plus charmante encore.
A sept heures nous faisons notre entrée dans Khokand, ex-capitale de l'ancien khanat de Khokand, désigné aujourd'hui sous le nom de province de Ferghanah, et dont les Russes ont transporté la capitale à Marghellân.
Nous sommes dans une ville essentiellement asiatique, que nous traversons dans toute sa largeur pour arriver à la station postale.
Les rues sont pleines d'indigènes se reposant, sinon du travail passé, du moins de la chaleur présente, sous des boutiques en forme de galeries, et, comme toujours, nonchalamment couchés sur leur kachma, mangeant des melons, des pêches et du pain sarte. Quelques-uns buvaient le thé vert qu'ils font bouillir dans des amphores de cuivre appelées koungânes, où chauffait le samovar, seul ustensile qu'ils aient emprunté des Russes. Nous vîmes bon nombre de goitreux. Une quantité de cavaliers et d'arbas parcouraient les rues pèle-mêle, et tout cela avec une grande dextérité; notre tarentasse allait si vite qu'elle faillit accrocher une arba, et je vis le moment où notre panier de provisions, attaché à côté du siège, allait rouler par terre; il sortit de ce choc entamé mais sauvé.
Nous passâmes devant la place, sur laquelle se dresse au loin le palais de l'ancien khan Khoudaïar. Sur cette place, une des plus belles de l'Asie centrale, des soldats russes faisaient l'exercice. Une rue, sur le côté droit de laquelle coulait une rivière, nous conduisit à la station. Là nous entrâmes dans une vaste cour; à gauche des écuries, à droite la demeure du starosta, surmontée d'une galerie dans laquelle on aperçoit des chambres; un escalier en bois permet d'y accéder par l'une des extrémités. Sauter de voiture fut pour nous l'affaire d'un instant; mais, ô déception nos demandes sont accueillies par cette terrible réponse qui résonne encore à mes oreilles « niètou », il n'y a rien. Le peuple ajoute « ou » à « niète » pour rendre sans doute la négation plus forte.
Nous étions au désespoir; avoir faim, tomber de fatigue, se croire arrivé au bout de ses peines, entendre niètou au lieu de voir un bon poulet rôti! Cependant, nous étions tellement familiarisés avec ces déceptions que le niètou ne nous fit pas jeter la tête contre les murailles. Prenant notre parti en braves, nous montâmes l'escalier pour aspirer l'air frais du soir, compensation relativement agréable lorsqu'on a enduré une chaleur de trente-trois à trente-cinq degrés à l'ombre.
Là surgit une idée lumineuse : nous appelons notre Tatar et l'envoyons acheter du riz et du mouton pour la confection d'un pilao à la manière sarte. Au bout d'une heure et demie, il nous apporte un plat fumant qui nous fit un plaisir extrême. Il y avait tantôt deux jours que nous n'avions vu de viande; ce fut un régal, et je dois ajouter qu'il était très-bien préparé.
Nous couchâmes sous la galerie. Les chambres sont si chaudes et si basses qu'il est impossible d'y séjourner, ce que j'essayai par entêtement; mais, comme je faillis étouffer, il me fallut an milieu de la nuit rouler mon lit dehors.
Tout le monde ici couche d'ailleurs à la belle étoile : les uns sur des lits qui ont quatre pieds en bois auxquels est adapté un filet tendu, ce sont les lits sartes; les autres sur des kachmas qu'ils mettent ou ils peuvent. Quant aux femmes et aux enfants, ils restent hermétiquement clos, au risque d'être asphyxiés.
Le lendemain, le commandant russe nous ayant donné un soldat parlant très-bien le sarte, nous allâmes ait bazar, le plus grand et le plus animé de tous cellx que j'avais déjà vus. Il a été brûlé pendant un hiver et rebâti par le khan sur des terrains achetés à des particuliers.
C'était jour de marché que de gens, de bêtes, d'arbas se pressaient en tous sens au milieu d'un brouhaha asiatique par excellence M. de Ujfalvy avait des emplettes à faire pour son voyage dans l'Alaï : il fallait acheter une tente, des malles en cuir d'égale grandeur juste la charge d'un chameau ou d'un cheval, puis des bijoux et des koungânes, qui, dit-on, sont meilleur marché à Khokand que partout ailleurs. De fait, nous trouvâmes une grande différence de prix. Notre soldat marchandait pour nous, s'exprimant dans la langue du pays avec cette facilité extraordinaire des soldats russes, qui s'identifient très-vite avec leurs vaincus. Notre présence faisait sensation et tous les indigènes nous regardaient curieusement.
Le marchand dressa la tente que nous voulions acheter dans une des cours du caravansérail. En ce moment nous vîmes sortir une femme russe tenant un enfant dans ses bras nous étions surpris de voir les Russes vivre au milieu des Sartes; dans toutes les autres villes, Russes et Sartes sont plus ou moins séparés.
Chaque galerie du bazar est affectée à telle ou telle marchandise; les magasins sont en bois ou en terre glaise; la toiture est assez élevée pour que l'air puisse y pénétrer, ce qui n'empêche pas que les jours de marché l'air ne soit rapidement vicié par la quantité d'hommes et d'animaux et de détritus de toute nature qu'on y laisse séjourner après les avoir réunis en monceaux. Au moment où nous marchandions les malles, un conducteur d'arba fut battu; nous ne pûmes savoir au juste pourquoi. Nous payâmes nos achats en roumonnaie russe que les Khokandais avaient déjà acceptée, et en pièces du Khokand. Le khokand est une petite monnaie en argent de la grandeur de nos pièces de vingt centimes, mais plus épaisse; il vaut vingt kopecks, quatre-vingts centimes: il en faut cinq pour un rouble qui représente cent kopecks. Le tillah (monnaie d'or) est la monnaie courante de l'Asie centrale; celui du pays vaut trois roubles soixante kopecks. Les pièces de Khokand qui sont frappées ici portent d'un côté les mots « frappé dans le beau Khokand », et de l'autre côté le nom du khan. Vient ensuite la monnaie de billon, petite monnaie de cuivre appelée tchéka, dont la valeur équivaut à un demi-kopeck, tandis qu'à Bokhara elle n'équivaut qu'au tiers de kopeck; leur poids est considérable.
Le bazar s'étend sur deux ponts, les plus beaux de la ville. Le premier, appelé Kich-Koupriouk, est en pierre et se compose d'une seule grande arche; il a été bâti par Madali-Khan. Le second, appelé Derezlik, est bordé de boutiques. On y voit encore un troisième pont.
Tous ces ponts rappellent l'architecture du moyen âge.
Pour la première fois je vis des boutiques de changeurs en allant à la galerie des bijoux. Il y avait tant de monde que le soldat était obligé de nous précéder à cheval, frayant la voie. A chacune de nos haltes la foule nous entourait; les marchands faisaient leurs offres, auxquelles nous répondions par les nôtres;
puis nous reprenions notre route sans avoir conclu; mais les marchands ne tardaient pas à nous rejoindre, livrant leurs marchandises aux prix que nous en avions offerts. Nous restâmes trois heures à regarder, marchander, aller, venir; enfin, nos emplettes terminées, nous revînmes à la première boutique et nous fîmes emporter la tente. Puis, comme nous avions grand'faim, notre Tatar nous acheta du melon et des pèches, que nous mangeâmes avec du pain sarte, assis sur le devant de la boutique. Le même équipage nous reconduisit à la station, pour nous emmener ensuite visiter le palais du khan.
Ce palais, le plus beau de l'Asie centrale, est bâti sur un mamelon, entouré de murs, fortifié et garni de nombreux canons russes et sartes. Il a été construit en 1287 de par Saïd-Mohamed-Khoudaïar-Khan ainsi l'indique l'inscription qui est sur le fronton.
C'est la reproduction des monuments de Samarkand, dans le style moderne, bien entendu, car la ville n'a pas plus de cent soixante. ans d'existence; elle fut construite, dit-on; par Saour-Khan; elle était autrefois entourée de joncs et de marécages dans lesquels se vautraient des porcs (khok : porc; kand : ville).
La ville est traversée par deux bras du Sokh : l'Alkoum-saï et le Kilchik-saï. Les briques émaillées de la façade du palais sont remarquables. On arrive à la porte principale par une montée en bois et une cour où se dressent des escaliers de bois sans marches, conduisant aux galeries. Toutes les chambres ont été détériorées par les indigènes; ce fut la vengeance qu'ils tirèrent du khan, leur maître détesté, lorsqu'il s'enfuit en 1875.
Le gouverneur de la forteresse habite le harem ou ancien bâtiment réservé aux femmes (il y en avait mille, m'a-t-on dit). Ces chambres s'ouvrent sur les galeries, d'où on a la vue d'un magnifique jardin où des vignes séculaires sont disposées en tonnelles. La salle de réception du khan a été transformée en église russe;. ses plafonds éclatants, peints avec beaucoup d'art, sont d'un effet original. Autrefois, ceux qui étaient admis devant le khan devaient, en passant devant l'appartement, saluer en prononçant quelques paroles de remerciement. Puis, lorsqu'on était entré dans le vestibule attenant au salon, le maître des cérémonies prenait le visiteur sous les bras et le poussait dans le salon, où se tenait le khan, assis à la turque sur des tapis. Pour terminer l'audience, le souverain prononçait le mot « iakchi » (bien) et saluait; puis, en signe de satisfaction, il offrait un cafetan, soit en brocart d'or, soit en perse, suivant l'importance présumée des personnes admises en sa présence; son cabinet de travail, construit dans le même genre, est non moins bien conservé; il en est de même du Labyrinthe, dédale dr, chambres dont les parquets sont en bois de karagatch, découpés en panneaux dont la largeur est au moins d'un mètre carré.
Un pavillon rose, ainsi appelé de la couleur de ses murs, était destiné à donner l'hospitalité aux étrangers. Quant aux écuries du khan, elles servent aujourd'hui d'abri aux attelages de l'artillerie russe. Tout cela formait un ensemble agréable à l'oeil et devait produire, avant la dégradation, un effet merveilleux sur les indigènes, dont les maisons sont si laides.
Le commandant nous avait donné comme cicerone un officier charmant, M. S. qui parlait très bien le français, et qui nous pria à dîner, nous promettant de nous montrer ensuite, et en détail, la forteresse et les jardins. Pour le moment, il n'y fallait pas penser, car la chaleur du jour était trop forte. Nous dînâmes donc en compagnie de notre cicerone et de deux autres officiers; le repas fut gai et assez bien servi pour un repas de garçon et pour une cuisine militaire il y avait là un témoignage précieux de cette intelligence du soldat russe dont j'ai déjà parlé.
On nous offrit du vin français, que je m'empressai de boire en le coupant d'une eau qui me parut très bonne, quoiqu'on lui attribue la triste propriété de faire naître le goître. Le capitaine nous raconta qu'il faisait partie d'une ambassade qui avait été envoyée à Khoudaïar, lorsque le pays était encore indépendant. L'armée indigène était alors rangée sous les armes dans la cour de la forteresse entourant le château; l'effet en était, paraît-il, si extraordinaire sous ce chaud et brillant soleil de l'Orient, que la reproduction en avait été décidée.
Malheureusement les effets de couleurs disparaissent sous la sombre uniformité de la photographie, mais l'exemplaire qu'il m'offrit gracieusement donnera à mes lecteurs une idée exacte des troupes du khan et de leur étrange équipement.
Après le diner et une bonne causerie, l'officier nous conduisit au jardin; il nous fit voir l'endroit où était le mur qui le fermait autrefois, mur énorme en longueur et en largeur, que le général Skobelef, l'ancien gouverneur du Ferghanah, fit sauter avec de la dynamite, à la grande terreur des habitants, qui n'en pouvaient croire leurs yeux. Cette destruction les impressionna vivement et leur donna une haute idée de la force des Russes. L'effet de cette destruction a substitué un retranchement moral à l'obstacle matériel, car l'officier nous fit remarquer que de ce côté les fortifications étaient sans défense. Pour visiter la forteresse, nous l'attaquâmes par son point le moins vulnérable il fallut passer sous une voûte assez longue, où deux canons pourraient arrêter toute une armée. Notre guide nous fit remarquer l'endroit où le khan faisait pendre ses victimes, dont il surveillait l'exécution d'une de ses fenêtres, sans se déranger. Le dernier des khans qui habitaient ce palais était Khoudaïar, qui est interné à Orenbourg (1). Son règne fut très-agité. Proclamé khan en 1843, par Mousoulmân-Koul, chef des Kiptchaks des montagnes, à l'àge de seize ans, il était le plus jeune des fils de Chir-Ali, sous lequel Mousoulmân-Koul avait régné de fait. Mousoulmân conscrva son autorité pendant huit ans de tutelle, pour perdre la vie sur les ordres de son pupille, comme je l'ai aussi raconté plus haut. Terrifiés par ces dernières exécutions, les Kiptchaks (Kara-Kirghises nomades) se tinrent tranquilles pendant quelque temps; mais bientôt, mécontents de ce que Khoudaïar protégeait les Sartes, ils reprirent le dessus et proclamèrent Mourad-Khan, fils de Sam-Soug-Beg, fils aîné de Chir-Ali. Khoudaïar, profitant des dissensions des rebelles, s'empara de Khokand, la capitale, et redevint khan.
Il lutta énergiquement contre les Kiptchaks et contre leur chef Alim-Koul, mais il fut cependant forcé de chercher un refuge chez l'émir de Bokhara. Sultan Saïd-Khan, fils de Mallah-Khan, fut alors reconnu khan par Alim-Koul; mais ce dernier fut tué par les Russes, au siège de Tachkend, en 1865, et son protégé obligé de s'enfuir à Bokhara. Khoudaïar reprit alors possession de son trône sans aucune résistance de la part de ses sujets épuisés par ces luttes intestines, et il régna par la terreur jusqu'en 1875, époque à laquelle les Russes, après avoir battu Abdour-Akhmân Aftobatchi, chef des Kiptchaks, et son allié, Issa-Oulié (chef de l'artillerie), s'emparèrent du khanat de Khokand (Nazr-ed-Din, fils de Khoudaïar, ne régna que quelques semaines). Cette intervention mit fin aux brigandages et aux révoltes de ces peuples.
1. Voyez le commencement de cette relation.
Malgré leur tranquillité apparente, les fidèles croyants, tout en reconnaissant la douceur du gouvernement russe, aspirent toujours à la liberté. Deux canons sont braqués, pour la forme, de la forteresse sur la ville à la vérité, ce sont de vieux canons sartes; mais, s'il survenait une révolte, il suffirait d'un quart d'heure pour que les canons russes tout neufs fussent en place et pussent bombarder la ville. En outre, près du palais, deux mortiers pointés sur le grand bazar, et deux autres sur la demeure du juge de paix, placée au centre des habitations, pourraient incendier Khokand en quelques instants.
Le capitaine S. nous assura qu'il n'y avait rien à craindre en ce moment; il ajouta que le général Kaufmann, en prenant la ville, aurait dû poser deux conditions la première, que les femmes auraient le visage découvert; la seconde, qu'on ouvrirait des fenêtres sur les rues, de manière à permettre, sans doute, aux Russes de procéder à l'assimilation de la population.
Les moeurs russes auraient peut-être plus d'action sur ce peuple, disait le capitaine, quoique nous le traitions avec douceur et égalité. Les castes religieuses et guerrières regrettent encore leur khan; il n'y a que les marchands qui soient contents; ils peuvent faire leur commerce en liberté, sans craindre de vexations. La vie des habitants, aujourd'hui respectée, ne l'était pas autrefois; le moindre délit et quelquefois la moindre rancune vous faisait prendre et condamner. Les supplices étaient inhumains on promenait le condamné par la ville, en le forçant de crier à la foule « Ne me touche pas si tu ne veux pas subir mon sort. » La promenade terminée, le bourreau saisissait le patient par les cheveux, lisait une prière, et lui ouvrait la gorge. Le cadavre restait exposé pendant deux jours. Les exécutions se faisaient toujours pendant la tenue du grand marché. On aurait peine à comprendre les regrets de ces gens, si on ne savait qu'en Asie centrale la vie de l'homme ne compte pour rien, et qu'ils n'ont pas encore pris l'habitude de la respecter.
Les médressés de Khokand n'ont rien de remarquable la plus belle a été par Khoudaïar-Khan et son frère Sultan Mourad-Beg, en souvenir de leur mère. Les autres médressés, telles que celles de Madali, Khak-Kouli, ming-bachi de Ming-kaïm et d'Ali, datent du siècle actuel et ressemblent à celles de Tachkend. Elles sont loin de valoir celles de Samarkand, la comparaison ne peut pas même être établie, mais elles ont de larges marquises soutenues par des colonnes. La plus ancienne est celle de Djouma. Celle de Kaliandar-Khan, bâtie par Khoudaïar, est toute neuve et s'élève non loin de la forteresse. Du temps de Khoudaïar la ville de Khokand possédait une usine de papier qui fit faillite; aussi maintenant ne fonctionne-t-elle plus; elle était située en dehors de la porte de Moïmonvorak, près du tombeau d'un saint qui a donné son nom à la porte seul service qu'il ait d'ailleurs jamais rendu à l'humanité. Le tombeau de ce saint n'a, du reste, rien de remarquable; il est en terre glaise et la construction masque la pierre sépulcrale.
Le capitaine S. vint prendre le thé avec nous, sous la galerie de la station, ainsi qu'un autre capitaine, dont la femme avait été mordue trois fois par le même scorpion. Ces maudites bêtes sont assez fréquentes dans cette ville, et assez difficiles à découvrir, en raison de leur couleur un peu jaunâtre.
Cette histoire me fit tellement peur, que je résolus de coucher encore dans notre tarantasse. Comme les chemins étaient mauvais mon mari manifesta l'intention de se rendre à Marghellâne à cheval; cette manière de voyager serait moins fatigante pour moi et me préparerait au voyage de l'Alaï; le capitaine S. nous promit son entremise. Pour la première fois, je passai une nuit entière dans la tarantasse. Le vent s'éleva, mais sans refroidir la température; l'air n'était que rafraîchi.
Le surlendemain, à huit heures du matin, les chevaux que le capitaine nous avait promis arrivèrent; nous convînmes du prix de trois roubles par cheval; les deux propriétaires des animaux nous accompagnèrent, Féodorof suivait dans un arba avec nos malles et nos provisions.
Notre petite caravane ainsi constituée, on jeta un dernier regard rétrospectif sur Khokand, ses splendeurs et ses misères.
XVII Koch-Tegerman. Les sables du désert Alti-arik-koum, Cendrillon sur l'escabeau. Pauvres femmes !... M. Bektchourine et ses petits verres, L'école de natation, les domestiques modestes. Les Tiourouks et leurs moeurs, La sériciculture du pays. Un khan qui fait pitié. Départ pour Wadil.
Au début d'une promenade, tout est bien; on est reposé. Le chemin fut, du reste, très-agréable; nous marchions par des routes bordées d'arbres et parsemées çà et là de petits kichlaks (villages). En général on trouvait à la première ou à la deuxième maison des musulmans sous la galerie et près d'eux une cruche pleine d'eau et une tasse à la disposition des voyageurs. J'avais tellement soif, que moi, si dégoûtée, je bus sans seulement y regarder, ét je trouvai cette eau excellente. Jusqu'à midi nous chevauchâmes ainsi gaiement et admirant.
A cette heure nous fîmes notre première halte près d'un kichlak appelé Koch-Tegermân, habité par des Uzbegs et situé au bord d'une rivière. Nous bûmes de l'eau et mangeâmes des melons et des pèches avec du pain sarte que les indigènes nous cédèrent pour quelques kopecks. Après une heure de repos, nous remontâmes à cheval; nous espérions atteindre aisément le soir Marghellân. Mais il nous fallut traverser des steppes affreuses au milieu des rafales d'une tempête de sable. Je ne sais comment j'aurais pu résister jusqu'au bout, si un indigène que nous rencontrâmes n'eût consenti à retourner sur ses pas et, moyennant salaire, à me conduire dans son arba jusqu'à la station. Toutefois nous eûmes encore longtemps à souffrir avant d'arriver à cette station, que je commençais à désespérer de voir jamais et qui apparut brusquement à nos yeux, pauvre station que l'administration russe avait dû abandonner, sous peine de s'y voir enfouie. Quelques familles uzbegues, qui n'avaient pas voulu quitter leur demeure, s'étaient réfugiées dans les huttes que le sable avait épargnées. Ce kichlak délaissé s'appelait Divaneh-kichlak (divanèh signifie idiot), et le désert que nous venions de franchir Altiarik-koum. Un Uzbeg nous offrit sa hutte en terre et nous apporta de l'eau, des fruits et quelques pains sartes. Il déploya ensuite un kachma sur la terre et jeta de l'herbe parfumée sur le foyer en signe d'affectueuse réception. Cet usage me parut touchant.. M. de Ujfalvy et M. Muller s'y étendirent;quant à moi, j'éprouvais un tel dégoût, que je ne voulus pas dormir et restai sur un escabeau, comme Cendrillon, méditant sur les plaisirs de mes belles soeurs de Paris, qui peut-être ce soir-là même s'en allaient au ba1 à l'heure où je me morfondais.
Cependant l'arba qui contenait nos bagages et qui était resté en arrière arriva. Les propriétaires, nous voyant bien installés, battirent en retraite chez leur voisin, et nous nous sentîmes quasi chez nous. Mais dormir était chose impossible, car les quatre vents, trouvant les portes ouvertes, nous y jetaient littéralement de la poudre aux yeux. A trois heures du matin, nous nous levions; ma toilette fut d'autant moins longue que je m'étais couchée tout habillée. Je sortis pour voir si la journée s'annonçait belle. Le ciel était balayé, l'air pur. Je vis paître de belles vaches que j'avais déjà aperçues la veille au soir. Que pouvaient brouter ces malheureuses bêtes ? Pas un vestige d'herbe. La moitié du kichlak était enfouie dans le sable; aussi loin que la vite pouvait s'étendre, l'oeil ne découvrait que dit sable.
Devant notre butte, un rempart de sable prouvait que les habitants luttaient contre cet ensablement; nous partîmes, non sans donner à nos braves Uzbegs une bonne récompense à laquelle ils s'attendaient bien un peu.
Chose étrange de minute en minute le désert se transformait; une heure après, des herbes d'abord, puis des arbres faisaient disparaître cette h6rribLe steppe; Divanèh-kichlak se trouve placé presque à la lisière du désert, qui est à peu près de dix lieues de longueur.
Après une autre heure, nous arrivions devant un beau village. Un cndos, une large mare et des arbres nous invitèrent à nous reposer, tandis qu'on irait prévenir l'aksakal (espèce de maire). Notre pérévotetchik (drogman) vint nous dire que ce fonctionnaire nous attendait.
Dans un charmant petit jardin, une table était dressée et le maître nous y conduisit, après avoir salué à la manière orientale, en s'inclinant, les mains sur le ventre, marque du plus grand respect. Du thé, du lait, des fruits, des amandes et de petits bonbons figuraient sur la table. Nous fûmes très-sensibles à cette gracieuseté. Sur ma demande, le maître me conduisit près de ses femmes, pour lesquelles je fus plutôt un objet de curiosité qu'elles ne le furent pour moi, car, à part quelques détails, je me trouvais toujours en face du même. Pour ces pauvres créatures, ni joie, ni distraction. Quelquefois la visite d'une de leurs voisines ou amies et c'est tout. Elles habitent généralement une arrière-cour; c'est là qu'elles accomplissent leurs travaux insipides et monotones. Elles sont seules toute la journée avec leurs enfants, poursuivant tranquillement et avec lenteur leur tâche quotidienne. Le proverbe hâte-toi lentement peut leur être approprié. Ce même air d'ennui que j'avais déjà remarqué était répandu sur les trois femmes de l'aksakal, et sans les heures de sommeil imposées par les chaleurs je ne sais vraiment comment elles pourraient
supporter leur existence. Celles-ci cependant avaient au moins leurs domestiques qui, en leur rapportant les nouvelles du dehors, pouvaient leur procurer quelques distractions; mais celles qui n'en ont point? Remplie de tristesse pour ces sœurs déshéritées, je revins près de ces messieurs, comparant ma vie à la leur et, comme le publicain, rendant grâces à Dieu de n'être pas mahométane. Pour comble de satisfaction, je goûtai d'un bon pilao qu'on venait de servir pour terminer le repas. La route jusqu'à Marghellân fut très-jolie, toute semée de kichlaks. A dix heures, nous aperçûmes la porte de la nouvelle capitale du Ferghanah. Aux premières maisons notre djiguite (guide) s'informa de la demeure du natchalnique (préfet), fils dë M. Bektchourine (que nous avions connu à Orenbourg et pour lequel son père nous avait donné une lettre. Nous traversâmes presque toute la ville, qui est assez grande. Après bleu des détours, une porte sous laquelle étaient réunis des musulmans s'offrit à nous; c'était là. Dans le jardin, le secrétaire de M. Bektchourine vint à notre rencontre et nous conduisit à l'habitation du natchalnique. Nous entrâmes dans une grande pièce peinte dans le genre oriental; des ouvertures en bois découpées donnaient sur le perron, s'abaissant et se relevant à volonté; l'une de ces fenètres servait au maître pour entendre et recevoir toutes les réclamations de ses administrés c'était comme un confessionnal perfectionné.
Après lui avoir présenté la lettre de son père, mon mari le pria de vouloir bien me garder pendant qu'il irait avec M. Muller rendre ses devoirs au général Ahramoff, gouverneur du Ferghanah.
Au bout d'une heure, M. de Ujfahy revint et m'annonça que le gouverneur avait donné ordre qu'on nous dressât une tente et une kibitka dans le jardin de M. Bektchourine.
Au déjeuner, notre hôte emplit un petit verre d'eau-de-vie, le vida d'un seul trait, puis il en offrit un à mon mari, en lui disant pour s'excuser que tel était l' usage musulman, se servir le premier et présenter ensuite à son hôte, afin de lui montrer qu'il pouvait accepter sans crainte, que c'était bon et pur L'habitation de M. Bektchourine avait été construite par un parent de Khoudaïar-Khan. Ce dernier, quelques mois après l'achèvement de la construction, avait trouvé plaisant de lui couper la tête. Il acquit alors la maison et fut débarrassé du parent: tout profit : le petit pavillon, avec sa belle salle et deux chambres peintes également dans le genre oriental, s'élevait sur un perron assez large au milieu d'un vaste et beau jardin. Un grand bassin entouré d'une palissade de jonc, système de clôture tout asiatique, servait d'école de natation. lente était dressée entre de beaux abricotiers dont les fruits jonchaient la terre et une vaste tonnelle à laquelle pendaient d'énormes grappes de raisin. Notre tente nous servait de salon et la kibitka de chambre à coucher; c'était un appartement complet.
1. M. Bektchourine, d'origine tatare, est musulman.
Le bassin palissadé de jonc me tentait; j'eus envie d'y prendre un bain au milieu de ce jardin en fleurs, tout comme une princesse des Mille et une nuits. Les joncs étaient sans doute assez espacés, mais qui ferait attention ?
1. Voyez la note de la page 10 ci-dessus, et, la même page, la description de cette mosquée dont la gravure est arrivée tardivement.
D'ailleurs les serviteurs sont très-discrets ils voient, mais ne regardent pas. Je pus prendre mon bain sans être dérangée et grelotter à mon aise; l'eau était froide, il. était trop tôt, le soleil ne l'avait pas suffisamment chauffée. J'étais fière pourtant de être baignée dans l'eau du Schakhimardân.
Nous primes ensuite notre thé sous les arbres. Il pleuvait des abricots. A neuf heures, je vis arriver une foule de musulmans qui venaient exposer leurs plaintes au natchalnique. Avec quel respect! avec quel maintien humble et servile qui faisait peine à voir! Ils attendaient quelquefois des heures entières sous les arbres du jardin sans qu'un seul mouvement d'impatience leur échappât; ils se contentaient d'intervertir le croisement de leurs et de lever les yeux au ciel. Le lendemain, le général Ahramoff vint nous rendre visite. Quel homme simple et aimable! aussi avait-il été adoré de ses subordonnés dans la province du Zerafchân. Il permit à M. de Ujfalvy de fouiller tel endroit qui lui plairait, sauf les meghils (cimetières), car sous ce rapport les musulmans sont intraitables. Mon mari commença ses mensurations, et M. Bektchourine lui fit amener tous les types désirables. Les types qui me frappèrent le plus, et que je n'avais pas encore vus, furent les Tiourouks ou Tourks, qui sont, dit-on, le résultat d'un mélange d'Uzbegs et de Kara-Kirghises. Ils sont peu nombreux et habitent quelques villages entre Och et Marghellàn et entre Och et Andidjân. Ils sont passablement laids, mais, en revanche, fervents musulmans; leurs moeurs et leurs croyances sont les mêmes que celles des Sartes. En hiver, ils habitent les villages, et en été, ils émigrent dans les montagnes, pour y faire paître leurs troupeaux. Ils élèvent des moutons et sèment du blé et du djougaffa. Ils achètent aussi leurs femmes, comme la plupart des musulmans. Les batchas (danseurs publics) dansent aux noces. A la naissance d'un enfant, les parents donnent de l'argent aux jeunes mariés. Lorsque quelqu'un d'eux est malade, ils consultent ou le médecin ou le mollah. Si la maladie occasionne la mort, après l'enterrement on donne un festin, et après un an la femme a le droit de se remarier.
Ils font trois repas par jour et boivent de l'opium, au lieu d'en fumer, comme chez les Chinois. A Marghellân on confectionne la soie sur une grande échelle; il y a quantité de tisserands qui travaillent d'une manière très-primitive. On les voit bien souvent sur le chemin, le long des maisons allant et venant au gré des fils. La largeur de l'étoffe ne dépasse jamais Cinquante centimètres; la couleur blanc-crème est la plus jolie; le violet et le bleu ne sont pas très-réussis; cependant, à Samarkand, j'ai vu du violet d'une teinte assez franche, et l'étoffe était plus large. On fabrique dés rayures semblables à nos petites étoffes de fantaisie; la soie est en général très-légère, et serait très bonne pour doublure.
1. Sorghun cernuum.
Celle de Hissar est beaucoup plus nourrie et peut être comparée, comme grain, à nos belles soies. Je pense que la soie de couleur unie et celle à petites rayures, de deux couleurs, ont été confectionnées pour le goût des Russes, car leurs costumes, de couleurs bigarrées, s'harmonisent avec le beau soleil du pays.
Nous achetâmes des bijoux et des étoffes de Kachgar. On trouve à Marghellân une très-jolie et très solide étoffe, faite avec la laine du chameau, des ceintures en soie tressées, d'autres avec des applications d'argent. La plus grande partie des bijoux sont en argent, dont le pâle éclat ressort beaucoup plus que l'or sur la peau bronzée des hommes et des femmes. Les bourses et les tibetéïka, petites calottes inséparables d'une tète musulmane, sont bien meilleur marché qu'à Tachkend et à Khokand; cependant le bazar y est moins important. Quoique Marghellân soit à présent la capitale du pays, elle n'a pas encore eu le temps de s'habituer à sa primauté.
Le Ferghanah est partagé en sept circonscriptions, comme les sert jours de la semaine. Le premier district est Marghellân, le second Khokand le troisième Wadil, le quatrième Och, le cinquième Andidjàn, le sixième Namangân, le septièmc Tchouste ou Tousse. Tous ces districts sont sous les ordres de natchalniques militaires; chacun possède une petite garnison.
Dans l'après-midi, nous apprîmes que M. Bektchourine interrogeait un des nouveaux khans, prisonnier des Russes. Il avait été livré le matin par une femme et était âgé de douze ans. Je me glissai sur le perron et je pus voir sa physionomie. Il parlait librement assis par terre, sur un kachma, dans la salle où nous prenions nos repas. Près de la porte d'entrée, sous le perron, figuraient les emblèmes saisis de cette grandeur, à savoir une grande trompette en cuivre pouvant avoir deux mètres et servant aux soldats indigènes pour intimider leurs ennemis; une autre, un peu plus petite, sur laquelle était placée la ceinture du khan, garnie d'une fourrure à longs poils. Le soir, le général Ahramoff nous montra sa collection de monnaies, qui est remarquable, et nous offrit, pour tout le temps de notre séjour à Wadil, sa maison de campagne.
En route maintenant pour le nouveau Marghellân russe; le chemin est assez joli, nos chevaux sont bons, le mien surtout a l'allure très-douce; la soirée est ravissante. Nous traversons de petits kichlaks; le bazar est peu étendu; mais sur une hauteur s'élève le magnifique tombeau d'un saint quelconque, précédé de celui de ses femmes. Il en avait plusieurs, et même dé très-jolies. Tous les indigènes se levaient sur notre passage, s'inclinaient en appuyant leurs mains sur leur ventre; ceux qui étaient à cheval ou en arba arrêtaient leur équipage et mettaient pied à terre, ce qui est la marque du plus grand respect.
De la ville sarte à la ville russe en herbe, car il n'y a encore que le tracé qui constitue cette dernière, il y a près de quinze verstes, et nous y arrivons à la tombée de la nuit. De larges et belles rues sont en construction; mais il me paraît faire ici encore plus chaud qu'au vieux Marghellân. Nous traversons une rue entièrement occupée par des ouvriers indigènes; le spectacle est curieux. Ils ont fini leur journée; les uns allument de grands feux pour préparer le dîner, les autres vont chercher de l'eau ceux-ci mangent du melon et des fruits, ceux-là sont déjà étendus par terre et se préparent à dormir. La forteresse sera au bout de la ville, et toutes les rues y aboutiront; on n'aura qu'à aller tout droit devant soi pour s'y faire enfermer.
XVIII Le koumisse. Types du pays. Wadil. Le pied du saint. Les Auvergnats de l'Asie. L'Ak-Sou. Variété de paysages. Le lac Fédchenko. L'Uzbeg. Le tombeau d'Ali. Pèlerinage où beaucoup de pèlerins n'entrent pas. Haute voltige dans la montagne.
Le lendemain, nous suivons d'abord le Schakhimardân la route est ombragée et longe de ravissants kichlaks. Peu à peu reparaît la steppe, mais elle va bientôt finir ait loin nous apercevons des champs cultivés. Plus loin encore, Wadil et sa verdure, qui se découpe sur cette aridité.
En entrant à la ville, au moment où nous passons le pont, un djiguite, tenant son cheval par la bride, nous salue, remonte en selle et nous fait signe de le suivre. Nous traversâmes presque tonte la ville avant d'atteindre le home du natchalnique.
On nous avait préparé deux kibitkas dans un beau jardin, car la petite maison du gouverneur était occupée tout entière par le préfet et son pamochnik (sous-préfet), qui était marié et père de trois enfants. Au thé, on nous offrit du koumisse, cette boisson que j'avais tant entendu vanter dans les livres et à Tachkend. Elle ne me plut pas; elle est aigre et a un goût de fromage; d'ailleurs c'est tout simplement du lait de jument ou de chamelle qu'on laisse fermenter et qu'on met en bouteille. Cette boisson est, parait-il, un remède souverain pour les phthisiques et les poitrinaires..
Les Russes viennent à Orenbourg pour y faire une cure. Cependant le meilleur koumisse se fait à Tchimkend, et de Tachkend on envoie les malades dans cette petite ville pour y éprouver les bienfaits de ce breuvage.
Le soir, j'eus de nouveau le plaisir de dîner dans le jardin. La température est ici moins élevée, elle ne dépasse jamais trente-deux degrés à l'ombre. Les fruits ne sont pas aussi avancés qu'à Marghellân; de beaux grenadiers, dont les fruits étaient prêts à mÙrir, avaient léurs branches couchées sur les allées. Le maître de la maison nous expliqua qu'on leur donnait cette forme pour pouvoir les couvrir de paille l'hiver; la vigne est protégée de la même façon dans tout le Turkestan. L'hiver n'est pas long, mais assez rude le thermomètre y descend parfois jusqu'à vingt-trois degrés Réaumur au-dessous de zéro.
Le lendemain lundi, M. de Ujfalvy, en attendant le photographe qui devait aller avec lui prendre des vues de la ville, mensura des Uzbegs et desTadjiks. Jamais je n'ai vu d'hommes de plus belles figures que ces derniers. Ils étaient de Kaptarkhanah, petit village situé à cinq kilomètres de Wadil. Il en vint aussi dix autres, fort curieux, des marchands des environs de Hissar et du Darwâz (1).
Ils pratiquent tous la religion de Mahomet et achètent leurs femmes. C'est au péril de leur vie qu'ils font leur commerce, car le chemin qu'ils suivent dans les montagnes est très-dangereux.
1. Petite principauté indépendante au nord de l'Afghanistan.
Wadil est un endroit pittoresque, admirablement situé au bas de la montagne. La vue s'étend au nord jusqu'à Namaugân; au loin, on aperçoit l'autre chai ne de montagnesqui horde le Ferghanah; à l'ouest, cette chaîne se rapproche de Wadil, et le soleil se couche derrière les sombres hauteurs; à l'est, la vue est bornée à peine par de petites montagnes; au midi, tout près de nous, apparaît la magnifique vallée du Schakhimardân, dont l'ouverture étroite laisse voir beaucoup de pics à cime neigeuse, avec leurs arêtes qui semblent vouloir percer le ciel.
Le mercredi 18 juillet, de grand matin, nous partons pour Schakhimardân, qu'on nous dit être à trente-cinq verstes de Wadil. Ce kichlak est un lieu de pèlerinage renommé en Asie centrale. On y trouve le tombeau d'Ali, un des personnages les plus sacrés de l'islamisme. Mais il n'est malheureusement pas le seul qui se dise renfermer les véritables restes d'Ali on compte près de cinq tombeaux de ce saint dont l'un, près de Bokhara, a aussi une grande réputation; aucune ville d'ailleurs n'est entourée de plus d'endroits sacrés que cette dernière.
Le chef du district nous donna un officier avec cinq cosaques pour nous montrer le chemin. Avec notre interprète (pérévotchik) et nos domestiques, nous formons une assez respectable caravane. Nous achevons de traverser la ville par un chemin bordé de murs; bientôt après, à notre gauche, se dressent les premières montagnes; à droite, sont des arbres, des prairies, des maisons. Un peu plus loin, les plantes disparaissent.
Sur le point d'entrer dans le défilé, nous heurtons une tombe située sur un rocher qui surplombe la rivière on nous invite à descendre de cheval pour nous montrer un grand trou qui a la forme d'un pied. La place du talon est remplie d'eau. On prétend que c'est l'empreinte du pied d'un saint, qui s'est reposé là. Nous remontons à cheval pour pénétrer dans une gorge assez étroite, au fond de laquelle le Schakhimardân roule ses eaux bruyantes. Des débris énormes de rochers jonchent le chemin. A peu près au milieu de la route et à droite, s'ouvre une autre vallée. L'effet est magique, les pics semblent se presser les uns contre les autres, les plus hauts couverts de neige; on ne voit que des pointes blanches et noires à l'infini. Les pierres de la rivière sont énormes, les eaux basses s'y brisent en écumant avec fracas, on les dirait furieuses des obstacles que rencontre leur course rapide. Une grotte, que ces messieurs vont examiner de près, n'offre rien de remarquable pour l'archéologie. La forme des rochers qui la surplombent inspire une épouvante que les fragments à demi détachés de la masse ne sont pas faits pour dissiper.
Nous rencontrâmes des troupes nombreuses de charbonniers qui descendaient des montagnes; ils s'en vont chercher bien loin du bois qu'ils vendent fort cher, sous forme de charbon. Leur vue me fait plaisir; ce sont les Auvergnats de l'Asie.
Voici la rivière, l'Ak-Sou (eau blanche), qui, sortie des montagnes, se jette dans le Schakhimakân. Tout à coup apparaît un homme tenant son cheval par la bride; il nous salue et s'approche. C'est l'aksakal nous dit l'officier qui est venu à notre rencontre. Après les salutations d'usage, l'aksakal se met en selle et nous précède. Nous traversons le kichlak; partout des têtes de femmes et d'enfants dévorent des yeux, sinon notre personne, du moins notre costume. Pour la première fois depuis Mme Féclchenko, je crois que ces gens-là voient une femme monter à cheval à l'européenne, les leurs montant à califourchon. Dans la maison de l'aksakal, une galerie sur laquelle s'ouvraient des chambres nous fut assignée pour demeure.
En attendant le diner, M. de Ujfalvy proposa au photographe, ainsi qu'à M. Muller, d'aller visiter le lac Kouthân-Koul, que Fédchenko, célèbre voyageur russe, a visité le premier. On ne voulut pas m'emmener, sous prétexte que j'étais trop fatiguée. Je dus donc me contenter de passer l'inspection de la localité. Schakhimardân, dont le nom veut dire Roi des hommes, est un kichlak peu étendu, encaissé entre de hautes montagnes aux pics blancs et dorés par le soleil. Deux vallées étroites s'ouvrent, l'une à droite, c'est celle de Schakhimardân, arrosée par le Kara-Sou (eau noire), l'autre à gauche, celle de l'Ak-Sou, baignée par la rivière même. Sur une hauteur qui domine la première vallée et tout le kichlak, s'élèvent la mosquée et le tombeau d' Ali, célèbre lieu de pèlerinage. Les maisons et les jardins verdissent sur le flanc des montagnes. Je restai longtemps à contempler ce tableau. Ce petit kichlak si vert, et dont les arbres cachaient les maisons, était comme un nid dans un roc. A son retour du Koutbân-Koul, mon mari me décrivit ce lac, dont la couleur est d'un bleu magnifique, la forme oblongue, et le bord tout couvert de blocs de rochers. Pour y arriver, il avait été obligé de gravir un de ces blocs, dont l'éboulement avait fermé la vallée et avait sans doute causé la formation du lac, dont les eaux ; barrées s'étaient arrêtées devant cette digue naturelle. L'ascension avait été difficile, et la descente encore plus. A la descente, il vit la source de l' Ak-Sou presque aussi large qu'à l'embouchure encore une étrangeté. Cette petite rivière sort d'un trou dans le rocher et une pieuse légende s'attache à la couleur de ses eaux. Quand Ali vint à Schakhimaivân, il montait un chameau blanc; ayant fait halte dans la vallée, on avait laissé paître les bêtes. Le chameau d'Ali s'échappa et remonta la vallée les hommes envoyés à sa poursuite le virent entrer dans une ouverture pratiquée dans le rocher. Quand ils s'approchèrent, le chameau avait disparu, mais une eau blanche et limpide s'échappa du trou où il était entré. C'est à cause de cela qu'on appelle la rivière Ak-Sou (eau blanche).
M. de Ujfalvy appela ce petit lac lac Fédchenko. Le lendemain, nous étions levés de bonne heure; M. de Ujfalvy devait mensurer des Uzbegs, qui constituent la majeure partie de la population de Schakhimardân.
L'Uzbeg est l'héritier de l'ancienne race, maîtresse de l'Asie centrale; il est le produit d'un métissage, et cependant le type est tellement caractérisé qu'on le reconnaît à première vue. Il est d'une taille moyenne, généralement maigre; la peau est très-basanée, les cheveux noirs, la barbe rare; les yeux sont toujours un peu relevés au coin et noirs. Le nez est large, court et droit, les lèvres toujours épaisses et renversées en dehors; les dents sont, comme chez les Kirghises, d'une blancheur éclatante. Le front est moyen etbombé, l'ensemble de la face est anguleux. Les oreilles sont grandes et saillantes, les mains et les pieds sont petits. Le corps est peu vigoureux et les jambes sont recourbées par l'habitude du cheval. Ils achètent des femmes tadjiques, persanes et kirghises, avec lesquelles ils se marient. Ils s'accommodent moins de la domination russe que les Tadjiks, leur humeur étant beaucoup plus belliqueuse car les Uzbegs combattent bien plutôt pour leur liberté personnelle que pour leur religion. Ils ont aussi des qualités moins mercantiles que les Tadjiks, ils sont plus nobles et n'ont jamais été assujettis à d'autres peuples avant les Russes. C'est de leur ra.ce que sont sortis Gengis-khan et Tamerlan, et quoiqu'ils aient adopté les costumes, les usages et beaucoup des coutumes des Tadjiks, ils ont cependant conservé leur intégrité. Les Uzbegs parlent peu et ils ont la voix un peu couverte. Je crois qu'ils pourront s'assimiler plus vite aux moeurs russes que les Tadjiks, car, tout en étant pourtant très-fanatiques, ils le sont moins que ces derniers. La population uzbegue est en partie sédentaire, semi-nomade ou tout à fait nomade. Les Uzbegs sédentaires habitent les villes et se mêlent volontiers aux Tadjiks. Les semi-nomades forment des groupes isolés, et les nomades parcourent le pays entier. Un Uzbeg apprend vite le tadjik, et réciproquement; mais quant aux femmes, leur situation est parfois très-embarrassante et entre femmes uzbegues, tadjiks et sartes, elles ne peuvent se comprendre et doivent forcément garder le silence. Aucune dispute n'est possible dans ce cas c'est alors qu'on peut dire le silence est d'or.
Après deux heures et demie de mensuration, nous pûmes monter à cheval pour aller visiter le tombeau d'Ali, situé sur la montagne. On parvient au sommet de cette montagne par une succession de zigzags assez raides, qui nous forcèrent d'abandonner nos montures. Lorsque nous fùmes arrivés au faîte, des mollahs, entourés d'une quantité de curieux, nous firent accueil ils nous conduisirent dans un grand jardin, sur la droite duquel était la mosquée. Le jardin possédait des saules et des platanes d'un développement vraiment extraordinaire. A gauche, on entrait dans une cour située derrière le tombeau d'Ali, où les fidèles venus en pèlerinage se livraient aux préparations réglementaires, qui consistaient à mettre du linge blanc et à se débarbouiller pour entrer dans le tombeau d'Ali. En sortant de cette cour, nous arrivons devant la façade du tombeau, qui n'a rien d'extraordinaire; deux petites colonnades assez gentiment sculptées en constituent la plus grande beauté. Nous entrons dans le monument par une porte en bois finement ouvrée, puis dans un vestibule rempli d'inscriptions et de dessins représentant la Mecque. Les pèlerins qui viennent visiter ce lieu saint ont l'habitude d'inscrire leurs noms. Nous remarquons beaucoup de pierres très-lourdes et d'un aspect curieux que les pèlerins ont apportées. Ici finit le pèlerinage, car les pauvres gens n'ont pas le droit d'entrer dans le sanctuaire. Leur regard seul peut plonger dans l'intérieur par la porte restée ouverte.
On y voit de vieux drapeaux appendus aux murs qui lui donnent le caractère vieillot d'une chiffonnerie; à gauche, un lampadaire en bronze, travail de Bokhara, des lampes en forme d'étoiles où quelques restes de mèches brûlent dans une graisse noire, le tout agrémenté d'oeufs d'autruche. A droite, et séparée par une flasque tenture en soie usée et multicolore, se trouve la pierre tombale recouverte d'une vieille toile. En repassant dans la cour, on nous fit voir la pièce où sont établis de grands chaudrons pour le repas des pèlerins. De là nous visitâmes l'école dans une salle sans fenêtre, éclairée par la porte seulement, deux jeunes gens écrivaient; l'un pouvait avoir seize ou dix-huit ans, l'autre dix: ou douze. Dans une autre pièce, des enfants criaient à tue-tète; ils apprenaient à lire et répétaient des préceptes du Coran. En revenant à Wadil, nous vîmes un indigène qui descendait une montagne à pic aussi commodément que s'il était en plaine.
On m'a raconté que, dans le Sémirétché (province des sept rivières), les Kirghises montagnards descendent au grand galop des pentes si raides que l'équilibre semble impossible ce ne sont pas des chevaux qu'ils montent, ce sont des chèvres.
XIX Retour à Wadil. Les tombeaux. Séparation, Le palais d'Assaké. En traversant un bazar, Andidjân. Och. Les Sartes. Le Tachti-Soleïmân. Une légende. Trous de pierres où l'on se guérit.
Le temps pressait, si l'on voulait aller dans l'Alaï; l'hiver arrive vite dans ces parages, et le mois d'août amène déjà la neige. M. de Ujfalvy devait repartir pour Marghellân. il fallait donc se' mettre en route, ce que nous fîmes tout d'une traite.
Nous retrouvâmes Wadil en aussi bon état que nous l'avions quitté.
De bonne heure, le lendemain, et pour ne pas s'exposer à la grande chaleur, mon mari partit, accompagné de Féodorof, pour Marghellân, me laissant sous la garde de M. Muller.
Le soir du second jour; nous sortîmes à cheval, M. Muller et moi, pour visiter un tombeau de saint, bâti depuis une très-haute antiquité. Les tombeaux sont ici les seuls restes de monuments; tout est fait de terre et de paille, constructions éphémères qu'un souffle renverse. Le mat-isolée est assez élevé et décoré d'un portail qui a dû être beau. Le gardien consentit à nous ouvrir le sanctuaire une porte basse que nous franchîmes tête baissée était assez bien sculptée; de vieilles draperies ornaient seules le tombeau. A un ou deux kilomètres de Wadil, les indigènes ont détourné le cours du Schakhimardân pour le forcer à passer par leurs champs. On voit la digue construite avec des pierres et de la terre, travail qui doit remonter assez haut, car des arbres et des herbes ont poussé sur cette digue et forment un pittoresque promontoire.
Je reçus le lendemain une lettre de mon mari; il m'invitait à le rejoindre le samedi à Marghellân. Je quittai Wadil sur les quatre heures un quart du matin avec mes djiguites.
Marghellân, que nous connaissions déjà, est une ville de soixante mille âmes; elle a douze portes, tout autant que Khokand, mais elle ne possède aucun monument, même de faible importance. C'est pourtant une des cités les plus antiques du Ferghanah. Nous restâmes encore trois jours dans cette ville, afin de terminer les collections de photographies de types anthropologiques que mon mari devait y faire et nous préparer au voyage de l'Alaï. Comme je n'étais pas du tout bien portante, mon mari décida à mon grand regret que j'irais l'attendre à Och. Je fus excessivement peinée de cette décision; j'avais entrepris ce voyage pour ne pas quitter M. de Ujfalvy; jusqu'à présent ma santé m'avait permis de l'accompagner. Il fallait maintenant rester seule pendant un grand mois, sans nouvelles. Mais je dus me faire une raison M. de Ujfalvy voyageant pour le gouvernement français, je n'aurais pas voulu que, par ma faute, l'expédition eût été entravée, arrètée ou retardée.
Le vendredi, on envoya un courrier à Och pour prévenir le natchalnique de mon arrivée.
J'arrivai à la première station après Marghellân, à onze heures du soir. Mourant de faim, n'ayant rien pris depuis dix heures dit matin, je résolus de m'y arrêter. Le starosta parlait allemand, heureusement pour moi; quoique mes connaissances dans cette langue tic soient pas très-étendues, je pus pourtant me faire comprendre. Après m'être fait une tasse de chocolat et lui avoir commandé les chevaux pour deux heures du matin, je m'étendis sur le canapé et m'endormis. Il y avait peut-ètre une heure que mon sommeil durait, lorsque la porte brusquement ouverte par le chef de la station me réveilla. Ce brave homme venait me faire part de l'arrivée d'un courrier et de l'obligation où il était de donner mes chevaux. Ce fâcheux contre-temps m'obligeait à attendre jusqu'au milieu de la journée et de voyager en pleine chaleur. Voyant ma contrariété, le starosta me proposa de me transformer en courrier et de porter moi-même la dépêche. J'acceptai avec empressement. Les chevaux attelés, je me disposais à partir, lorsque le starosta me dit « C'est heureux que vous n'ayez pas passé ici la semaine dernière, car les Kiptchaks étaient descendus des montagnes; cette semaine ils n'ont pas encore paru. » Or les Kiptchaks (Kara-Kirghises) sont les plus mauvaises gens du Ferghanah et ils avaient attaqué à différentes reprises de paisibles voyageurs. Cette histoire n'était pas faite pour me rassurer. Mais ne voulant pas montrer mes craintes, je lui fis voir en souriant le petit revolver que je portais toujours à ma ceinture. Ce que voyant, il fit le geste d'un homme complètement rassuré et m'aida à monter en voiture. Nous partimes au galop des trois chevaux les plus fringants qu'on ait pu trouver. Ne portais-je pas une dépêche? Si c'était la mienne? pensai-je; et je souris malgré moi, car je n'étais pas complètement rassurée. Je ne tire pas mal à la cible, il est vrai; mais, le cas échéant, comment me serais-je servie de mon arme?. On ne tire pas sur un homme, fût-il un Kiptchak, comme sur un morceau de bois. Néanmoins je fis un voyage plus agréable que je ne me l'étais imaginé d'abord. J'arrivai à Assaké le matin à trois heures; obligée d'attendre, je dormis dans ma tarantasse au milieu de la cour peuplée d'une gent volatile au réveil de laquelle j'assistai. Puis, comme Assaké possédait autrefois une charmante résidence d'été (lui khan, j'allai la visiter; mais la guerre avait en partie anéanti ce joli palais arrosé par l'Akboura; cependant sa situation a dû être très-pittoresque.
Force me fut de revenir à moitié satisfaite et de repartir au galop de mes chevaux fraîchement attelés. Nous traversâmes le bazar, qui ne présentait rien d'extraordinaire, sinon le réveil de ses habitants; leur toilette est bientôt faite, puisqu'ils ne se déshabillent jamais entièrement. Les uns priaient sur de petits tapis, d'autres faisaient leurs ablutions ou prenaient leur premier repas. Quant à la ville par elle-même, elle ressemble à toutes les villes musulmanes, sombres et tristes à cause de ses maisons toujours en terre grise et privées d'ouvertures. Cependant sa situation est assez jolie et la rivière qui l'arrose contribue à son agrément. La vue est surtout splendide et s'étend à une très-grande distance. Entre Assaké et Andidjàn, il n'y a rien de remarquable, sinon une plaine de sable mouvant. Celui-ci atteint un tel degré de finesse, que le vent le fait changer de place à chaque instant; il forme alors des ondulations d'une régularité merveilleuse.
Nous allons bien; la pluie semble donner une nouvelle vigueur aux chevaux et les stations se succèdent les unes aux autres. Andidjàn, que je devais revoir ait retour, n'eut aucun attrait pour moi. J'avais hâte d'arriver. Je saluai les petits contre-forts des montagnes qui m'annonçaient Och, dans laquelle je lis mon entrée vers midi.
Quand j'arrivai à Och, ma tarantasse, accompagnée de Féodorof, fut dirigée sur la villa du préfet militaire, pendant que le sous-préfet m'emmenait lui-même dans sa voiture. J'arrivai au moment où l'on me dressait deux kibitkas côte il côte, l'une servant d'antichambre ou de salon, l'autre de chambre à coucher. Mon campement avait fort bon air; il était établi dans un parc planté de beaux arbres et au bas duquel coulait la rivière de l'Akboura. La vue s'étendait au loin sur les champs, sur la ville, et sur le quartier russe, habité par les employés, les militaires et leur famille. Le soir, retirée sous ma kibitka, la prière des soldats arrivait jusqu'à moi.
Je restai fort triste pendant quatre journées. Le soir du quatrième jour de mon arrivée, commee nous. étions réunis avec le natchalnique, sa femme et ses enfants, et occupés à prendre le thé, mon mari revint, accompagné seulement de M. Muller. Je fus à la fois heureuse et contrariée, car il avait fallu sans doute de graves motifs pour que M. de Ujfalvy renonçât à son expédition. On n'avait pu s'entendre avec le photographe qui s'était refusé à tous les arrangements. On se résigna à séjourner quelques jours à Och, pour compléter les études ethnologiques. On devait faire ensuite à cheval tout le tour du Ferghanah septentrional.
Le lendemain nous visitâmes la ville: Och est située à l'est de Marghellân, au fond de la vallée de l'Akboura. C'est une grande cité, étagée en amphithéâtre autour de la montagne du Tachti-Soleïmân. On la dit très-ancienne et bâtie du temps d'Alexandre, le Grand. Le bazar est vaste, très-fréquenté et égayé par le voisinage de la rivière; les tchaï-khannée [çayhane] (cafés) sont assez propres; la ville est plus animée que celle de Marghellân. On y voit une mosquée de construction moderne d'un assez joli aspect, bâtie par le fils d'Ahdour-Akhtnane Aftohatchi.
Och est habitée surtout par des Sartes, peuple mélangé et sur l'origine duquel nous avons déjà donné des renseignements.
Chez les Sartes du Ferghanah l'élément tadjik est beaucoup plus prépondérant que chez les Sartes de Tachkend et du Turkestan. Aussi le type sarte du Ferghanah s'en ressent.
Les Sartes sont grands, d'un embonpoint moyen; les parties du corps qui restent couvertes sont blanches, la figure est brunie par le soleil. Les cheveux sont généralement noirs, ainsi que la harhe qu'ils ont très-abondante. Les yeux ne sont jamais relevés des. coins, la prunelle est brune; quelquefois bleue. Le nez est en général très-beau, long, arqué, effilé les lèvres sont fines et droites, les dents petites; ils ont le front large et l'ensemble de la face ovale. Le corps est vigoureux, les attaches sont fines et la taille est élancée. Quant aux femmes, il est assez difficile de les distinguer, car on voit souvent dans les harems, à côté d'une femme tadjique, une Uzbegue et une Sarte. Si l'on excepte les femmes kirghises, elles sont trop mélangées ; cependant, parmi celles que j'ai vues, j'ai pu remarquer qu'elles avaient en général les cheveux et les yeux très-noirs, ces derniers quelquefois relevés des coins; leurs dents sont très-blanches, quand elles ne les noircissent pas; les pieds et les mains sont moyens, la peau est toujours très-brune; elles sont plutôt petites que grandes et généralement assez fortes. Lorsqu'elles vieillissent, elles deviennent grasses ce qu'elles doivent probablement à leur genre de vie. Une femme à trente ans est déjà passablement fanée. La femme kirghise se découvre toujours le visage, la femme uzbegue quelquefois, les femmes sartes et tadjiques jamais.
Nous passâmes toute la journée du lendemain à mensurer des Kachgariens; je dis nous, parce que j'écrivais sous la dictée de M. de Ujfalvy et que, voyant trembler ces pauvres gens, j'employais toute mon éloquence à les rassurer; mais les paroles ont peu d'action sur ces peuples méfiants et habitués à être trompés ; ils ne se tranquillisèrent que lorsqu'on les eut rendus à la liberté. C'étaient généralement de beaux hommes, à la peau un peu olivâtre; aux yeux noirs et peu relevés des coins, à la bouche grande et aux dents blanches; le front était bas et large, la face anguleuse
Le Turkestan oriental, ou la Kachgarie au sud-est du Ferghanah, est habité par une population fort mélangée. Les Kachgariens ont presque plus de ressemblance avec les Sartes qu'avec les Uzbegs. On s'aperçoit promptement que des éléments iraniens ont dû présider à la formation de ce peuple. Les Kachgariens. sont fréquents dans le Ferghanah. où ils habitent surtout entre Och et Andidjân; même à Tachkend il existe un quartier exclusivement habité par cette peuplade.
Il nous fallut le surlendemain aller voir la mosquée de Tachti-Soleïmân (pierre, trône de Soliman) c'est le nom indigène d'une montagne qui surgit au milieu d'une plaine et présente quatre sommets dont le troisième est le plus élevé. Il est très-pénible de gravir cette montagne, à cause des grosses pierres qui la couronnent. Sur le premier sommet est une construction en briques formant plate-forme et servant de repos aux pèlerins en contournant cette construction, on arrive devant une mosquée du nom de Khodjamné-Djaï, construite en l'an 1240 de l'hégire. Cette mosquée est très-petite; le sol est pavé de grosses pierres de la montagne tout à fait brutes, mais arrondies par places, sans doute par les pieds des pèlerins, et glissantes comme du marbre poli. Les murailles sont en pierres blanches, polies aussi et en maints endroits enjolivées d'agréables sculptures. La voûte est ogivale; la porte est à deux battants en bois de chêne sculpté. A gauche de la porte et d'un espace couvert se tient le mollah; en face, les croyants viennent s'asseoir sur leurs talons pour prier. Sur la plateforme, on jouit d'une vue admirable au nord sont des montagnes très-élevées; au nord-ouest est Aüdidiân; au sud-est est la Kachgarie; à l'ouest, le chemin de Naoukat; à nos pieds, une mer de verdure qui noie les laides constructions des indigènes; au pied d'une colline verte, le lit de l'Ak-Boura.
On raconte que Soliman (ou Salomon) est venu sur cette montagne, où il y avait un petit kichlak, et que, voulant faire un acte de générosité en faveur des habitants de cet endroit, il leur demanda de quoi ils avaient le plus besoin. Comme il n'y avait là que la steppe, les habitants demandèrent à avoir de l'eau en abondance. Salomon commanda alors aux montagnes les plus rapprochées de s'ouvrir et de livrer passage à la rivière appelée Ak-Boura, qui formait un lac de a l'autre côté de ces montagnes. Près de la mosquée, il y a deux trous creusés dans les pierres dures de la montagne; ces trous sont de la grandeur de la tète et profonds d'à peu près vingt centimètres. On prétend qu'il suffit d'y plonger trois fois la tête pour la guérir de toutes sortes de maux. Derrière la mosquée, il y a également une grande pierre inclinée et raboteuse de près de trois mètres de longueur, sur laquelle on se laisse glisser trois fois pour se guérir de maux de reins.
Dans une autre partie de la montagne, on trouve une grosse excavation dans laquelle on ne peut entrer qu'en rampant; elle contient au fond, dans un creux peu profond, une eau tiède et sulfureuse. On dit qu'un homme est venu s'y réfugier et y a vécu longtemps, alors que la source n'avait pas encore surgi. Après sa mort, arrivée l'an 1230 de l'hégire, cette eau jaillit à côté de son corps.
XX Où le retour est moins amusant que l'aller - Le Fergflanah et ses habitants – Andidjou - Les arbas - La sage-femme de dix-huit ans - Nostalgie du cuisinier - Procédés d'enterrement - Le Kara-Daria - Nous chantons pour prouver que nous n'avons pas la bouche pleine.
Le 18 août, nous partimes d'Oeh, pour faire à cheval le tour du Ferghanah septentrional. Le Ferghanah, ou ancien khanat de Khokand, a été annexé à la Russie en 1876. Il se subdivise en sept districts : Warghellâne, Wadil, Och, Andidjân, Namangân, Tousse et Khokand.
A la tète du Ferghanah, et résidant à Marghellâne, se trouve un général, sous les ordres du gouverneur général de Tachkend. L'ancienne capitale, Khokand, a été abandonnée à cause de son insalubrité, dit-on. L'eau de cette ville est accusée de donner le goitre, à tort ou à raison, car les médecins ne sont pas d'accord. Cependant, trois cents soldats étant devenus goîtreux, l'infirmité était constatée, quoique la cause en fût contestée. On alla donc chercher une autre capitale.
1. Suite. Voy. pages 1, 17, 33, 49 et 65.
Chaque district est sous les ordres d'un natchalnique, espèce de préfet militaire, assisté de deux fonctionnaires appelés pamochniques (sous-préfets) et d'un juge de paix. Les districts se subdivisent en arrondissements, qui ont à leur tète des chefs indigènes (walasnoï). Chaque arrondissement se compose de communes, dont chacune nomme à l'élection un aksakal ou maire.
On peut dire que le Ferghanah est une immense steppe entourée de montagnes dans laquelle se trouvent de ravissantes oasis. Ce pays est habité par un grand nombre de races les Tadjiks, les Sartes, les Kiptchaks, les Uzbegs, les Tourouks les Karakirghises, les Kachgariens, les Bohémiens; Dans les villes, les Sartes constituent la majorité; on y rencontre aussi des Tadjiks, des Juifs, des Persans, des Afghans et des Hindous.
Autour des grands centres, les Uzbegs, les Kara- Kalpaks, les Tourouks mènent une vie mi-nomade. Les premiers versants des montagnes, moins fertiles, rnais plus tempérés que les oasis de la plaine, sont occupés par les Tadjiks cultivateurs; enfin des Kara-Kirghises errent sur les plateaux et dans les vallées les plus élevées qui entourent le Ferghanah. Par-ci, par-là, on rencontre des bohémiens qui dressent leurs tentes blanches auprès des centres populeux. On distingue facilement les Tadjiks (Éraniens) des différentes autres races. Les Uzbegs, Kara-Kalpaks. etc ont tous plus ou moins les yeux relevés des coins; les pommettes saillantes et la face anguleuse du Mongol, tandis que les Tadjiks, avec leurs traits réguliers et leurs faces ovales, rappellent nettement, les populations méridionales de l'Europe.
Le Sarte tient des deux cependant, le plus souvent, c'est le sang tadjik qui l'emporte. Les Bohémiens, couleur chocolat, avec des dents d'une blancheur incomparable, sont d'une taille bien au-dessus de la moyenne; ils mènent une vie semblable à celle de leurs frères européens.
C'était donc tous ces peuples que nous allions voir de plus près. Nous les connaissions déjà pour les avoir vus dans les villes que nous avions parcourues. Nous étions huit personnes et formions une petite caravane assez complète mon mari, M. Muller, Féodorof, un pérévotchik (interprète), un djighite pour nous montrer le chemin, un cuisinier en cas de besoin, un palefrenier et'une arba avec son COl1ductèùr. Après avoir remercié le natchalnique et sa famille de l'hospitalité qu'ils nous avaient donnée, nous partons à deux heures, un peu tard à cause de la chaleur; heureusement, le district d'Och se trouve dans une contrée tempérée et n'a jamais plus de vingt-cinq à trente degrés, ce qui est très-supportable, après les fournaises que nous avons traversées. Le Ferghanah possède, on peut dire, les trois climats, tempéré, torride et glacé nous sommes dans le premier; la route, nous dit-on, sera charmante.
D'Och à Khodjavata, nous rencontrons de nombreux kichlaks. M. de Ujfalvy s'arrête pour demander leur nom, le nombre des maisons (base de la statistique en ce pays-ci), et la race à laquelle appartiennent les habitants.
1. On compte généralement cinq habitants par maison ou tente.
Le chemin est ravissant, la route est bordée d'arbres, les champs sont palissadés, en bois rustique, il est vrai, mais ces clôtures attestent un commencement de civilisation qui réjouit la. vue. Le chemin est agrémenté de mosquées, qui ressemblent un peu, avec leur grillage en bois, à de grandes volières. Ce sont moins des monuments que des stations de pèlerinage. Nous arrivâmes à Khodjavata à la tombée du jour. La cour d'une maison nous servit de refuge pour la nuit; quatre murs en étaient l'unique ornement intérieur et extérieur: il fallut bien s'en Contenter; nous ne pouvions nous montrer plus difficiles que Khoudaïar-Khan, qui avait couché là, y avait dormi, en avait fait son pied-à-terre Les Altesses asiatiques voyagent beaucoup, surtout de nos jours, quelquefois pour leur instruction, quelquefois pour leur agrément, quelquefois aussi. Mais n'anticipons pas; disons seulement que ces voyages princiers ne changent rien à leur manière de voir et à leur manière de faire.
On dîna comme on put, on se coucha de bonne heure, sur l'invitation et à l'exemple des musulmans, qui tiennent à ménager leurs chandelles. L'aksakal, qui vint nous saluer le lendemain, devait en avoir beaucoup brûlé, car il accepta très-allègrement, malgré sa position importante, la somme d'argent que mon mari lui mit dans la main pour payer notre séjour. Ce fonctionnaire était autrefois l'exécuteur du beg; aujourd'hui il sert le gouvernement russe en qualité de collecteur des impôts. Nous partons pour Andidjân; mon mari et M. Muller nous précèdent. Afin de ne pas me fatiguer, il a été décidé que je ferais le chemin en arba, escortée de mon fidèle Féodorof. On me hisse, c'est le mot, sur ce véhicule, car les arbas sont d'une hauteur proportionnée à la profondeur des rivières qu'elles doivent traverser. C'est la voiture par excellence des indigènes; elle passe partout service inappréciable dans. un pays où les chemins sont exécrables. Les khans avaient de très-jolies arbas pour promener leursfemmes.
Type d'une mosquée moderne en Asie centrale. Dessin de E. Thérond, d'après une photographie.
Nous revoyons dans le trajet nos montagnes de glace, mais loin, bien loin. Le chemin que nous traversons peut s'appeler une steppe montagneuse, et nous arrivons à Andidjân à travers un pays rclativement fertile, habité par des Uzbegs et des Kachgariens. Andidjân, l'ancienne capitale du Filiokand, est presque en ruine. Lors de la dernière insurrection, la ville brûla pendant deux semaines entières. Depuis la paix, cependant, les Russes font tout pour la relever. Le bazar a des rues larges et spacieuses, les magasins sont plus réguliers; il y des tchaï-khanné (cafés) d'une véritable élégance ils me donnaient presque envie d'y prendre une tasse de café, mais l'absence de chaises me retint; ce n'est pas petite affaire que de s'asseoir gracieusement à terre.
Les mosquées, qui sont les seules curiosités remarquables dans les villes musulmanes, n'ont rien d'extraordinaire à Andidjân. Une seule, toute neuve, réjouit la vue par sa propreté et ses formes élégantes. Le fort est construit à l'entrée de la ville, devant une place au milieu de laquelle des arbres très-élevés se font remarquer par leur complet dépouillement de verdure. Les cigognes remplacent les feuilles. C'est sur cette place que se tient le marché, auquel nous nous rendîmes, le 9 aoùt, pour y faire des emplettes, les bijoux étant ici assez bon marché.
Que d'encombrements! Des voitures, des chevaux, des ânes, des indigènes avec bonnet chinois à trois cornes, des femmes voilées vendant des fruits. Tout cela va, vient, crie, s'entre-croise avec le flegme et la lenteur particulière aux musulmans. Ici on vend les bijoux au poids et la façon en sus; l'argent est trèspur et peu mélangé, mais tant pis si l'objet est orné de pierreries; quand elles sont vraies, on gagne; mais le plus souvent ce sont des verroteries sans valeur, dont l'ornement ne compense certainement pas le poids. La veille nous étions allés visiter un kichlak modèle situé à quatre kilomètres de la ville, dans une délicieuse vallée qui porte le nom du véritable créateur du Turkestan, dit général Kaufmann. On en a donné les maisons à de pauvres Uzbegs, avec des terrains et des fourrages pour leurs bêtes. Les maisons sont toutes bâties sur le même modèle avec une cour derrière. Pour y arriver nous avons dû traverser une steppe inclinée sur le plateau de laquelle s'élève un tombeau où sont enterrées les petites filles du natchalnique. De ce plateau la vue est réellement splendide, car au milieu de ces steppes les oasis se détachent comme une île sur la mer et forment un rideau de verdure d'un effet ravissant.
Les Kirghises-Kiptchaks du district d'Andidjâr sont les sujets les plus turbulents de là nouvelle province russe; à chaque instant on est obligé de les réprimer ce sont eux qui intronisent ces khans que l'on est obligé de tuer ou d'envoyer mourir en Sibérie. Les Kiptchaks sédentaires (Uzbegs), au contraire, sont les plus fidèles sujets des Russes; ils ont adopté le nouvel ordre de choses et sont devenus des trafiquants et agriculteurs laborieux et pacifiques. Le district d'Andidjân est le plus riche et le plus peuplé du Ferghanah. Il renferme des mines de charbon de terre, du naphte et des eaux minérales sulfureuses dont la chaleur est de trente degrés Réaumur. Des fruits assez bons y représentent les espèces que j'ai déjà citées.
Nous étions logés chez le natchalnique; le jardin servait autrefois de demeuré à Nazr-ed-Din Beg, 2e fils de Khoudaïar. Notre hôte s'y est fait construire une maison à l'européenne; l'ancien palais sert de caserne et d'infirmerie. Il reste encore au milieu du jardin un pavillon d'été avec des sculptures et des peintures sans valeur; ces dernières sont une grossière imitation sur papier des peintures sur bois que l'on voit au palais de Khokand ou ailleurs. Le jardin est le plus grand et le plus beau de toute la contrée ; l'on y peut chasser à l'aise, sans sortir de chez soi, le renard, le lièvre, le faisan, etc. Lorsque nous nous promenions dans ses allées, les fruits nous tombaient pour ainsi dire dans la bouche et faisaient ployer les arbres sous leur poids ; des indigènes ramassaient les pistaches et les amandes afin de les conserver pour l'hiver. En regard de cette abondance de fruits, les fleurs font complètement défaut; l'utile n'est ici jamais mêlé à l'agréable! les belles fleurs que j'avais vu à Takend avaient été importées d'Europe. Le soir nous prenions notre thé sur la terrasse; le nombre des moustiques était si grand qu'il fallait allumer des feux dans la cour afin que la fumée les chassât ce qui nous aurait incommodés partout ailleurs, assurait ici notre tranquillité, mais nous passions à l'état de jambons de Mayence.
Quelques officiers du Turkestan sont mariés, mais en petit nombre; aussi dans la société russe le contingent féminin fait-il grandement défaut. Dans le Ferghanah, province nouvellement conquise, cette absence de femmes se fait encore plus sentir. Il est vrai qu'on est assuré de rencontrer dans chaque chef-lieu de district au moins une femme, c'est la sage-femme instituée par l'autorité.
Les jeunes filles sans fortune qui ont quelque goût pour le métier de Lucine peuvent faire des études médicales à Saint-Pétersbourg, passer leur examen, obtenir leur diplôme, et se faire envoyer ensuite soit dans le Caucase, soit dans le Turkestan, où le traitement est beaucoup plus élevé qu'ailleurs. La sage-femme d'Andidjân avait dix-huit ans elle était d'un extérieur assez agréable, dans le royaume des aveugles les borgnes sont rois, elle montait parfaitement à cheval et conduisait encore mieux. Vous voyez d'ici sa situation; elle était la seule de son espèce; oh la trouvait belle, spirituelle quand même; les jeunes officiers venus dans le Turkestan pour y faire carrière, les officiers de la garde qu'on envoyait là pour les soustraire à leurs créanciers, l'entouraient, la courtisaient, l'adulaient. Il n'en faut certes pas davantage pour tourner la tète d'une jeune personne issue d'une famille fort modeste, aussi la sage-femme d'Andidjân était-elle d'une fatuité et d'une impertinence accomplies, qui contrastaient avec les manières simples et affectueuses de la femme du natchalnique. N'importe! sage-femme à dix-huit ans, avoir déjà en main, de par Hippocrate, l'existence de jeunes générations! Que sera-t-elle à quarante ans?
Aa~ moment de partir, il nous arriva un contretemps fâcheux: notre cuisinier, un ivrogne fieffé, eut tout-à-coup le vin mélancolique. Le culte de Bacchus a, paraît-il, de ces retours. Notre buveur fut pris soudain d'une nostalgie pour sa patrie adoptive, Marghellâne, et pour sa famille, dont il s'était cependant fort peu soucié pendant le voyage. Force nous fut de le laisser partir.
Voici un trait qui peint le caractère des Sartes. Je voyais un jour le cuisinier du natchalnique tuer des canards pour notre dîner. Ce musulman, après avoir. il moitié coupé la tête des pauvres bêtes, les laissait courir et riait à gorge déployée de leurs contorsions. Je m'éloignai brusquement de ce spectacle, indignée de ne pouvoir m'opposer à un pareil acte de cruauté. Au dîner, j'eus toutes les peines à toucher à la volaille; elle était d'ailleurs si dure qu'à défaut de compassion mes dents elles-mêmes se seraient révoltées.
Nous partîmes d'Andidjân le dimanche 12 août, à onze heures, après avoir remercié le préfet et sa femme de leur cordiale réception; bien que nous lui eussions été en quelque sorte imposés par le général Abrainoff, il est des devoirs mieux remplis les uns que les autres; la façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne.
La route qui conduit d'Andidjân à Namangàn est la plus belle et la plus fertile du Ferghanah; de beaux kichlaks se succèdent sur ce chemin bordé d'arbres au pied desquels des ariques répandent la fraîcheur. Les demoiselles rouges, bleues et vertes nous caressent le visage ; des plantations de coton, de maïs et de djougara (sorgho) alternent avec de jolies prairies. Nous remarquons des champs de sorgho d'une telle hauteur qu'un cavalier peut facilement s'y cacher. Ce sorgho remplacerait avantageusement la betterave, sans valoir pourtant la canne à sucre. ..En nous éloignant d'un kichlak, nous rencontrons un enterrement. Les musulmans courent après le corps, qui est lui-même emporté à la course sur ue civière et couvert d'un voile ; leur croyance veut que le mort it hâte d'arriver au paradis. On le met en terre la tête tourée vers La Mecque.
Arrivés le soir à Khodjavata (1),nous commandons un pilao à notre nouveau cuisinier . O déception ! ce cuisinier ne sait pas cuire le riz et il a laissé fondre le beurre. Qui nous rendra son prédécesseur? car tout ivrogne qu'il fût, au moins savait-il son métier. Les moustiques noirs apportent une diversion plus désagréable encore à notre mauvaise humeur. Ah les vilaines bêtes plus on les chasse, plus elles reviennent En quelques instants nous voilà couverts de morsures; rien ne saurait les détourner de leur proie humaine ! Si ce n'est la fumée à laquelle il nous faut recourir une fois encore au risque de nous voir transformés définitivement en jambons. A cette idée de jambon notre estomac s'aiguise que, n'en avons-nous. Une tranche à nous mettre sous la dent. En guise de jambon, il faut se rabattre sur les melons ; c'est du reste maintenant la nourriture habituelle de l'indigène des melons et encore des melons.
Le 13, nous nous remettons en route pour Namangân; notre toilette est vite faite et les tentes de notre demeure roulante sont bientôt empaquetées ; il n'en reste plus que le parquet naturel sur lequel on l'avait dressée. Comme nous les hommes sortent de leurs kichlaks et se rendent aux champs leurs outils sur l'épaule.
Nous traversons Balaktchi, petite ville célèbre par la victoire que le général Skobeleff y remporta sur les Kiptchaks. L'aksakal nous reçoit dans un ancien château de Khoudaïar; la vue et la situation de cette habitation sont superbes.
1. Ne pas confondre avec la localité du même nom entre Och et Andidjân.
Devant la collation. qu'il nous offre, nous sentons notre estomac si contracté par la faim que nous ne pouvons manger; il n'est pas encore remis que les domestiques emportent la collation et font place nette c'est l'usage. Une heure après, nous étions devant le Kara-Daria (eau noire).
Un pont à piles flottantes et affectant la forme d'un navire relie un bord à l'autre; . L'entretien de ce pont ne fait pas honneur aux ingénieurs. Les bords de la rivière sont peuplés de grues, d'ibis; nous tirâmea sur cette gent volatile, mais l'écho seul et des battements d'ailes nous répondirent; beaucoup de bruit, peu d'effet. Le Kara-Daria n'est ni très-large, ni très-profond ses eaux sont bourbeuses et justifient parfaitement son nom. Il nous fallut passer ensuite à cheval un bras de fleuve; voyant ma monture aller à la dérive, j'appelle notre djighite Mohamed-Schah à mon secours; mais, en véritable musulman qu'il est, il arrive quand je suis remisé de mon effroi. Il est vrai que j'avais été tout bonnenient abusée par un vertige, ce qui arrive souvent lorsqu'on passe un gué à cheval.
Après ce bras de fleuve nous traversâmes une steppe pour n'en point perdre l'habitude heureusement celle-ci était plus modeste et nous aperçûmes bientôt le Naryn roulant ses eaux entre deux rives escarpées. Cette rivière, large et profonde, constitue par le fait le cours du Syr-Daria, dont le Kara Daria il n'est qu'un grand affluent. Pour le franchir, il nous faut attendre l'arrivée du bac qui venait à notre rencontre. Malheureusement cette embarcation ne put atterrir assez près de notre. rive faute de profondeur; de plancher il n'en était point question. Nous sautâmes de cheval dans le bateau; mais nos montures, plongées dans l'eau, ne pouvaient s'imaginer ce que leur voulait ce grand coquin de bac immobile. Malgré les coups de fouet, on fut obligé de leur prendre les jambes de devant, qu'on posa sur le rebord du bac. Les cris et les coups des bateliers indigènes les firent monter à l'assaut, non sans danger pour leurs pauvres jambes. L'un d'eux cependant fut tellement entêté qu'on dut l'attacher par une corde à l'arrière du bac et le forcer, quoiqu'il en fût, de nous suivre au ti milieu de la rivière. Nous traversâmes un autre bras du Naryn en arba.
Après ces trois équipées, la route continue à se montrer charmante, comme elle l'avait été d'abord, et traverse des rizières et des kichlaks. Cette promenade nous mit en belle humeur; on entonna des airs d'opéra et même d'opérette. O Mozart, Rossini, Boïeldieuf et vous aussi, Mère Angot vous ne vous attendiez pas à trouver des interprètes dans d'aussi lointains parages. Quelques indigènes n'en croient pas leurs oreilles; ils se demandent, j'en suis sûre, si quelque grand malheur ne va pas fondre sur eux. Raison de plus pour mettre le comble à leur stupeur, et les chants retentissent de plus belle, entrecoupés pourtant par les coups de dents que nous donnons à nos Bacchus n'était pour rien dans ces ébats; nous n'avions pour boisson que de l'eau, mais elle était claire et exempte de sangsues, ce qui lui valait une certaine considération.
XXI Désagréments crâniologiques, La mosquée Khodjamné-Khabri. Le savon panacée. La nécropole Sadpir. Curieux tourbillon de poussière. Ce qu'un indigène apporta un jour dans sa casquette, Une chevauchée de six cent quatre-vingts kilomètres.
Après trente-cinq kilomètres, nous faisons notre entrée à Namangân. Il était temps; la chaleur commençait à nous gâter notre jolie promenade; nous sommes heureux de contempler cette ville de l'Asie centrale, quoiqu'elle ressemble furieusement à ses sœurs: mêmes rues étroites et tortueuses, même poussière, même disposition et même étendue de bazars. Une insurrection qui a eu lieu en 1876, quelque temps après la prise de cette cité, a fourni aux Russes l'occasion de balayer la place autour de la citadelle les maisons bombardées ont cédé le terrain à la construction de la nouvelle ville russe qui s'élève avec rapidité. On y compte déjà cinquante-deux maisons.
Le natchalnique, averti de notre venue, nous cède une vieille mosquée dans la cour de laquelle nous dressons nos tentes. Les indigènes avaient malheureusement l'habitude d'y faire paître leurs chèvres. Nous sommes obligés de chasser ces quadrupèdes, qui ne paraissent pas moins mortifiés que leurs propriétaires de leur brusque expulsion.
Nous déjeunons chez le préfet, où j,e me trouve placée entre une jeune dame qui ne parlait pas et une vieille dame qui parlait trop. Celle-ci savait très-bien le français c'était une grande rieuse, mais visant trop à l'esprit; elle avait fait ses études en Allemagne et en France. Études de quoi? me demandais-je. Mon Dieu! que les femmes russes sont instruites,et quelle honte pour une Parisienne, à qui l'on veut bien attri buer de représenter la fine fleur de l'élégance, de se voir réduite à écouter! Études de quoi? Cela me tourmentait; elle causait en femme qui sait C'était une maîtresse sage-femme; elle savait en tout cas mettre les enfants au monde et contribuer à l'accroissement de la population du Turkestan. Elle traduisait notre conversation au maitre de la maison qui ne parlait que le russe, comme nous ne parlions que le français; notre ignorance mutuelle se compensait au moins de ce côté.
Le dîner eut lieu le soir au fond d'un grand jardin encore inachevé, à peu de distance d'une rivière aux eaux murmurantes. On m'avait placée dans la pénombre d'une bougie, de manière à me soustraire aux entreprises des moustiques.
1. Prononcez Ouifalvi. C'est un nom hongrois. Uj qui signifie neuf, nouveau, et fulvi (de falu) du village; comme qui dirait en français « de Neubourg. »
En rentrant à notre mosquée, comme l'eussent fait de bons mollahs, nous fûmes assaillis par une véritable meute de chiens hideux et presque sauvages qui .nous escortèrent jusqu'à nos tentes; nous eûmes toutes les peines du monde à les chasser; mais nous entendîmes leurs aboiements jusqu'au jour, ainsi que les.trois coups sacramentels que le veilleur de nuit frappe toutes les cinq minutes en parcourant la ville. C'est un usage qui est répandu dans toutes les villes du Turkestan et on s'étonne que les Russes en aient laissé l'accomplissement aux indigènes.
Tout le pays naturellement avait été informé de notre arrivée; le lendemain matin, des petits enfants sartes vinrent nous apporter des fruits. Les piécettes que nous leur donnâmes familiarisèrent les petits garçons, mais les petites filles montraient une peur excessive; peut-être étaient-elles moins poltronnes avec moi, mais, lorsque M. de Ujfalvy leur offrit de l'argent, son geste seul les fit fuir comme des oiseaux effarouchés. Cette scène avait lieu pendant que nous prenions notre thé; elle était si contraire aux habitudes, qu'elle attira trois femmes, probablement les mères des enfants, qui, recouvertes de leur voile noir, vinrent nous regarder et nous remercier. Je me levai et leur offris une tasse de thé; j'en avais déjà donné à un vieux musulman, beau vieillard âgé, me dit-on, de quatre-vingt-quinze ans, qui savourait son breuvage dans un coin et à qui j'avais acheté une belle corbeille de fruits pour deux francs. Les femmes trouvèrent le thé à leur goût, car l'une d'elles me fit comprendre qu'elle en boirait bien une seconde tasse; je cédai à son désir, qui se renouvela encore une fois. Sur ces entrefaites, Mohamed-Schah rentra avec une mine blême et effarée. M. de Ujfalvy lui ayant promis trois roubles par crâne qu'il pourrait rapporter, il avait, en compagnie d'un de ses coreligionnaires, essayé de fouiller les tombes. Le malheur voulut qu'ils découvrissent deux dépouilles fraîches; ils en furent tellement consternés qu'ils purent à peine les remettre en état, pensant que toutes les foudres de Mahomet allaient tomber sur eux. Pour nous distraire de ce récit lugubre qu'il nous faisait en tremblant, nous courûmes regarder des bohémiens Louli qui passaient en cet instant. Ils s'en allaient montés sur leurs chameaux, suivis de leur maison portative, chercher sans doute de meilleurs pâturages pour leurs troupeaux de beaux moutons dont le seul inconvénient était de soulever une poussière épaisse qui obscurcissait l'air cinq minutes encore après leur passage. Les femmes avaient comme les Kirghises le visage découvert et un costume analogue leur tête était entourée d'une étoffe blanche; elles portent des bottes, des pantalons et une large robe retenue à là taille. C'est une assez belle race, au front haut et large, un peu bombé; les sourcils sont très-fournis, les yeux sont droits et noirs; la bouche est moyenne et les dents sont très-blanches la face est ovale. Les hommes ont les cheveux et la barbe noirs; ils ont, ainsi que les femmes, la peau olivâtre et le corps vigoureux; les extrémités sont moyennes, bien qu'ils soient très grands. Les femmes portaient leurs enfants dans leurs bras, mollement bercés par le balancement du chameau. Les plus âgés se tenaient à califourchon devant leur mère. Ces gens fabriquent des ustensiles de vannerie qu'ils vendent dans les villes et dans les villages. M. de Ujfalvy se rendit au bazar accompagné du chef de la police de Namangân et il fit emplette de vieilleries assez curieuses entre autres, d'une belle ceinture, que je changeai contre mon revolver pour ne pas trop nous démunir d'argent.
Nous allâmes ensuite saluer le natchalnique et visiter les deux mosquées de Aziz-Halfa et celle de Khocajamné-Khahri, la plus belle de Namangân ; elle est entourée de bâtiments percés de quelques fenêtres, le tout en briques. Ce sont les seuls matériaux de ce genre que nous ayons vus dans la ville. La mosquée est assez petite; mais quand on aperçoit sa façade, dev ant laquelle se dressent à peu de distance quelques majnifidyes peupliers, on ne peut s'empêcher d'adle beau travail qui la façonna. La mosquée s'élève sur un des côtés d'une cour ombragée. Une tombe placée en avant d'une des entrées renferme les restes d'un saint nommé Ibrahim-Pacha Khodja, ce qui a fait donner à l'édifice le nom de Khodjamné-Khabhri (tombeau saint). Les deux colonnes de droite et de gauche sont d'une richesse d'ornement remarquable; les différentes parties de ces colonnes unies sont séparées par des briques de couleurs avec des reliefs d'un effet agréable. Une petite porte s'ouvre au milieu; elle est encadrée de bois avec des battants sculptés. Au-dessus de la porte il y a une inscription. Une seconde inscription est entourée d'un cadre couvert de sculptures et reposant sur deux saillies sculptées. La porte est dans un enfoncement: cette partie du milieu est surmontée d'une voûte dont des briques en saillie dessinent la forme ogivale qui repose sur deux colonnes bleues couvertes de jolis dessins en relief. A côté de ces colonnes est symétriquement disposée une bordure qui, comme presque toute la façade, a perdu sa couleur, puis un cadre couvert de ravissants dessins un second intervalle sépare ce motif d'un autre semblable et décoré de non moins beaux reliefs. Cette façade est remarquable, c'est la plus belle du Ferghanah. L'intérieur de la mosquée est petit, mais les sculptures, les inscriptions et les peintures qui restent sont très-jolies. Les demi-voûtes faites en saillie dans les quatre coins offrent de charmants reliefs étagés et superposés. Quatre portes placées en face l'une de l'autre et de grandeur pareille donnent accès dans l'intérieur. Les curiosités artistiques ne pullulent pas en Asie centrale, la religion de Mahomet défendant, comme on sait, les peintures et sculptures qui représenteraient la figure humaine.
Un des plus beaux intérieurs de mosquée existe dans les environs de Bokhara; il contraste fort avec les ornements architecturaux employés dans les mosquées du Turkestan russe, et nous avons cru devoir en donner une vue à nos lecteurs.
De Namangàn nous nous rendons à Turé-Kourgàne; les plaines sont bornées à l'horizon par les montagnes de l'Ala-Chan. La route est monotone c'est ce que Tœpffer appelle pittoresquement un. ruban. Elle se déroule indéfiniment comme un peloton de fil dont on ne pressent pas le bout.. Pourtant les environs de la ville sont d'autant plus agréables, lorsqu'on les compare à la route.
Arrivés à Turé-Kourgâne, nous passons la nuit dans la cour d'un ancien château du khan, sous un beau karagatche dont le tronc mesure quatre mètres de circonférence; son feuillage nous tient lieu de toit pour notre tente. C'était un abri vraiment poétique, et la fraîcheur de la nuit ne nous incommoda pas. Les nuits sont chaudes dans cette contrée; la rosée n'existe pas, sinon à Tachkend, où elle est occasionnée, je crois, par le grand nombre d'arbres qui bordent les ariques. Le château était habité par l'aksakal, qui avait le type uzbeg bien prononcé. Le matin, à notre réveil, nous vîmes les serviteurs de l'aksakal faisant leurs ablutions dans une belle mare située au milieu de la cour. Et dire que nous avions bu de cette eau la veille et qu'on allait y puiser un moment après!
Du château ou ancienne forteresse, on jouit d'une des plus belles vues de la contrée; la terrasse est à une hauteur énorme et domine, une superbe vallée au milieu de laquelle coule la rivière de Kassân-Sou. En buvant notre thé, nous contemplions ce spectacle; nos chevaux piaffaient en nous attendant.
Le chemin de Turé-Kourgâne à Kassân passe dans une charmante vallée et se fraye .un sillon ravissant dans des montagnes parsemées de jolis kichlaks habités par un mélange d'Uzbegs et de Tadjiks. Nous arrivons à la ville, qui se trouve sur une hauteur, par une pente assez douce, au pied de laquelle se jette la rivière.
C'était jour de marché, le bazar était excessivement animé. La maison où nous conduisit l'aksakal ressemblait à celle que j'avais déjà vue, mais le mobilier en était tout à fait asiatique. On sent (lue, hormis le natchalique, qui vient faire ses tournées habituelles, aucun profane n'habite cette ville. Je suis; je crois, la première femme européenne qui l'ait traversée. Tout était bien musulman dans la demeure de notre hôte; on y trouvait les deux cours sacramentelles; celle des hommes nous fut réservée. Les chambres étaient sombres, étroites, recevant la lumière par de petites ouvertures et par une porte donnant sur une galerie. Les ouvertures étaient garnies d'un grillage en bois sur lequel on avait collé du papier transparent. Les plafonds, formés de logues poutres espacées l'une de l'autre d'environ trente-cinq centimètres, étaient décorés; le plancher d'argile était couvert de tapis de Bokhara, et des coussins couverts de soie bigarrée y attendaient le bon plaisir de leur propriétaire; à côté d'eux des couvertures ouatées étaient destinées aux personnes de distinction deux seuls fauteuils de forme carrée et qui semblaient égarés là faisaient pressentir la proximité de la civilisation chinoise. Les murs renferment des niches servant de bibliothèque bien rudimentaire, car elle ne consiste qu'en un manuscrit du Coran. La deuxième cour était réservée aux femmes de l'aksakal et à son fils, petit garçon de deux ans, qui nous apparut, sale et barbouillé, entre les mains de deux servantes, vêtu d'un simple khalat ouvert par devant, sans doute à cause de la chaleur. n ressemblait un peu à son père, qui du reste était un fort bel homme; ses manières affables et presque prévenantes contrastaient fort avec celles des autres chefs musulmans. En général, le musulman 'reste peu chez lui; il va au bazar ou se rend aux prières de la mosquée. Après le dîner, auquel j'invitai l'aksakal, qui d'ordinaire prend son repas du soir dans la cour avec ses serviteurs, un mollah survit, auquel on donna la place d'honneur ; il prit le Coran, en lut quelques versets, et, quand il se fut retiré, des garçons d'une dizaine d'années, qu'on appelle batchas, habillés en femme comme ceux que j'avais vus à Samarkand, se mirent à danser; les invités s'assirent en rond pour contempler ce divertissement. La danse est réglée par les sons d'un instrument à cordes; les assistants marquent la mesure en battant des mains. Ces danses se prolongent généralement très-tard et sont la cause, paraît-il, de perturbations domestiques que le Coran est impuissant à empêcher. Je ne pus malheureusement pas voir les femmes de notre hôte; elles étaient à une campagne un peu éloignée; mais il me fit visiter leur appartement, qui ne diffère en rien de ceux que j'avais déjà vus. Il voulut que j'essayasse le plus beau vêtement d'une de ses femmes et j'eus toutes les peines du monde à le lui faire reprendre. Il avait agi d'après les préceptes du Coran, qui ordonne, paraît-il, que tout ce qu'une étrangère a porté doit être gardé par elle.
Les Tadjiks que M. Ujfalvy mensura sont les plus beaux que j'aie vus dans le Turkestan. Leur légende dit qu'ils sont venus dans le pays avant l'introduction de l'islam. Il y a environ six cent soixante-dix ans que les Kalmouks, peuples mongols, envahirent la contrée et la mirent à feu et à sang. Les habitants de Kassân qui ont survécu à ce désastre élevèrent, en l'honneur des morts les plus illustres, une nécropole appelée Sadpir (cent saints), qu'ils ornèrent de pierres avec des inscriptions. Comme cette nécropole n'est pas éloignée de Kassân, nous nous y rendîmes à cheval. Il y reste à peu près soixante-dix tombes. M. de Ujfalvy et M. Muller estampèrent une trentaine d'inscriptions qui leur parurent les plus remarquables, et que le mollah gardien du cimetière ne put leur expliquer. Il est à peine. besoin de rappeler que l'instruction est peu en honneur chez les Asiatiques, la poésie et la littérature étant classées chez eux au nombre des péchés. La légende seule est tolérée chez le bas peuple.
Les mollahs sont les plus lettrés, mais ils sont aussi les plus fanatiques; on dirait que savoir et fanatisme, chez. eux, sont synonymes. Les traités signés avec les infidèles leur paraissent autant de crimes contre la foi aussi les savants engagent-ils toujours les chefs à violer les conventions. Le peuple se laisse facilement entraîner par ces fanatiques, qu'il semble pourtant ne pas aimer. Nous offrîmes au mollah du Sadpir du sucre et des bougies. C'était sans 'ironie et non par allusion ait besoin qu'il devait avoir de s'éclairer il fut enchanté et nous salua jusqu'à terre par trois fois. En revenant, je regardai une maison pauvre; cellelà n'a qu'une cour; .une natte sépare le logis de l'homme de celui de la femme; murs en terre glaise, plafond blanchi à la chaux, le sol rarement couvert d'un mauvais kachma (feutre) le plus souvent même c'est la terre qui sert de plancher.
Kassàn est la plus vieille ville du Ferghanah; elle est exclusivement habitée par des Tadjiks. Nous la quittâmes le soir du deuxième jour, accompagnés par l'aksakal, qui voulut nous faire la conduite jusqu'à la fin de son district. Les arbres étaient brûlés par le soléil, toutes les feuilles jaunies jonchaient déjà la terre, comme chez nous en automne; cependant nous n'étions qu'au milieu d'août. L'aksakal avait un cheval superbe, qui lui avait coûté quatrevingt-dix roubles, ce qui est assez cher pour le pays. Une belle bête va dans les prix de quatre-vingt-dix à cent roubles; les chevaux les plus remarquables ne dépassent pas le prix de trois cents roubles. La route de Kassân à Tousse traverse une steppe de dix-huit kilomètres; au milieu se dresse l'ancienne forteresse de Mallah- Khan, l'oncle de Khoudaïar-Khan le mur d'enceinte est encore assez bien conservé. La steppe est habitée par quelques pauvres Uzbegs groupés autour d'un filet d'eau et de cinq ou six beaux arbres qui seuls dominent ce désert. On m'a assuré que le général Abramoff voulait faire des essais de culture. C'est une affaire d'irrigation : là où une demi-douzaine d'arbres prospèrent, on peut en faire prospérer dix-mille. Ce serait un grand bienfait pour la contrée. Au milieu du désert, nous fûmes surpris par un tourbillon de poussière ; il ne cessait le soir que pour reprendre avec l'aurore.
Pendant ces trois jours, la poussière formant brouillard le soleil n'apparaissait que comme un pain à cacheter collé au firmament. A partir de Baïhlak, la steppe est une peu cultivée. Le soir nous arrivâmes à Tousse, chef lieu du district dans un pays peu fertile et pierreux. La forteresse bâtie, par les Russes domine la ville et la vallée. Le natchalnique, quoique en tournée, avait donné des ordres pour notre réception; aussi, grâce à l'obligeance de son pamochnique (sous-préfet), M. de Ujfalvy liut, se procurer trois crânes tadjiks.
Tousse est habitée par des Tadjiks et par des scorpions il n'est pas rare de trouver tous les soirs une de ces vilaines bêtes dans la cuisine du natchalnique. Les araignées venimeuses (kara-kourt, araignée noire) fourmillent à Lombano, située à quelques kilomètres de Tousse.
On raconte que lorsque M. et Mme Fédchenko vinrent dans cette ville, M. Fédchenko, savant naturaliste, promit quelques kopecks aux enfants qui lui rapporteraient des kara-kourt. Le lendemain, un petit indigène arriva avec sa tibetéïka remplie de ces insectes. Sans réfléchir, il renversa sa coiffure, et toutes les araignée s'éparpillèrent dans la chambre. Je vous laisse à penser la frayeur de tous les habitants; on fut obligé de prendre mille précautions pour rattraper ces dangereuses bêtes, et, comme on n'en savait pas le nombre, on resta longtemps dans des transes continuelles, à la pensée que quelques-unes pouvaient s'ètre dissimulées dans la maison.
Aux environs de Tousse il y a des sables en quantité jusqu'aux bords du Syr-Daria; à gauche, au contraire, les hautes montagnes reparaissent décorées d'une flore très-jolie. Les montagnes, ait nord du Ferghanah, sont riches en minéraux de toutes espèces; on y trouve de très-belles améthystes, du cristal. de roche, des grenats d'un rouge éclatant; ces mêmes montagnes recèlent du charbon de terre et du naphte. Sur l'une de celles qui séparent le Ferghanah du Syr-Daria se trouve un ancien village fortifié appelé Schaïtàn-kichlak, ou village du Diable. La ville de Tousse est la dernière du Ferghanah, dont nous avions achevé l'exploration en six semaines six cent quatre-vingts kilomètres à cheval. Pour une Parisienne qui n'avait jamais fait d'équitation, j'avais le droit d'être fière de cette prouesse.
Nous restâmes trois jours à Tousse sans qu'il nous fût possible de distinguer la ville du haut de la forteresse, à cause du brouillard de sable. M. de Ujfalvy, voyant que ses études avaient pris fin donna le signal du départ: nous remerciâmes le capitaine Dœbner, chef du district, qui, revenu de sa mission, avait été pour nous, durant ces toirs jours, d'une amabilité sans pareil. D'origine allemande, il nous était aussi plus aisé de nous entendre avec lui puisqu'il parlait cette langue avec facilité, les connaissance de la langue russe étant, chez M. de Ujfalvy, assez limitées. Pourtant il avait fini par pouvoir dire ce qu'il voulait.
Le 24 août, nous étions en route pour Khokand, non plus à cheval, mais en tarantasse. Au premier relais, malgré les recommandations qui nous accompagnaient, nous eûmes des difficultés avec le starosta, un starosta tout neuf qui, pour fêter sa prise de possession, s'était enivré de bonne heure. Nous dûmes en outre, atteler six chevaux, jusqu'au Syr-Daria les roues s'enfoncent dans le sable charmantes steppes! 1 Nous traversâmes le fleuve en radeau, le nouveau point sur lequel nous le franchissions n'ayant pas de pont. Les rives étaient abruptes et assez élevées du côté où nous devions nous embarquer. Pendant qu'on transbordait notre voiture, je contemplais un radeau chargé de provisions que deux, chevaux traînaient en nageant d'un bord à l'autre du fleuve. Semblables à Neptune, deux indigènes soutenaient avec des cordes passées sous le ventre ces nobles animaux transformés en coursiers marins. L'embarcation glissant lentement sur l'onde finit par atterrir. Sur l'autre rive, la steppe s'allongeait à perte de vue en se transformant en un véritable désert de sable. Près de Soultan-Beghi, sur le bord du Syr-Daria, nous rencontrâmes deux Kara-Kalpaks, dont 1'tin était très gros. Cette race est portée à l'embonpoint quoiqu’elle fasse partie de la tribu uzbegue; ils sont sédentaires et agriculteurs.; ils habitent la du Syr-Daria. C'est une peuplade douce, pacifique et laborieuse elle tire son nom, comme je crois l'avoir dit plus haut du couvre-chef noir qu'elle porte dans certaines parties du Turkestan.
A vingt kilomètres de Khokand le pays redevient fertile, les kichlaks se succèdent, des champs de coton en fleur animent le paysage. Le coton du Turkestan, quoique de moins bonne dualité que celui de Bokhara, vient très-bien dans cette partie.
Nous revoyons Kokhand avec son arc de triomphe en bois. Nous entrons par une des douze portes. Celle-ci est ornée de deux tours, dont l'une à droite est à moitié écroulée; les murs en terre de la ville sont dentelés. Nous partons le soir et refaisons cette affreuse route de Kokhand à Patar, qui, pendant la nuit, me parut encore plus mauvaise.
Nous repassons le Syr. Nous revoyons Makhram avec sa forteresse en terre trouée que Khoudaïar-Khan avait fait construire pour arrêter les Russes. Pauvres grands murs en terre comment pouviez-vous donc avoir une telle prétention? N'aviez-vous donc jamais entendu parler des canons, de leurs terribles coups, et les merveilles de l'artillerie moderne n'étaient-elles pas parvenues jusqu'à vous?
Une cour chez le chef du district à Kassân (voy. p. 92). Dessin de Barclay, d'après une photographie.
Ou bien, semblables à vos maîtres, vous dressiez-vous mornes et indifférents pour assister aux progrès de la civilisation, c'est-à-dire de la destruction? Le chemin devient intolérable; la chaleur, la poussière, les routes pierreuses, tout concourt à notre supplice, et nous arrivons à Khodjend hébétés, altérés, exténués.
M. de Ujfalvy a la fièvre, qu'il a gagnée dans le Ferghanah, ce qui nous force à séjourner dans cette petite ville beaucoup plus que nous ne l'aurions voulu. Le Syr-Daria avait baissé; on voyait les sillons tracés par son retrait. Ce beau fleuve est très-poissonneux cependant les indigènes ne lui demandent aucun aliment à Tachkend on n'apporte que des silures.
Les poissons des torrents dans le Turkestan ressemblent au genre Brème. Le lac Koutbankoul (Fedchendkoj) nourrit une petite truite; mais si les indigènes en mangent, ils n'en offrent jamais aux étrangers.
A cinq heures du soir, après avoir réagi contre une chaleur extrême et des mouches plus incommodes encore, nous partons.
Nous eûmes bientôt à notre gauche le Mogol-Taou, à notre droite le Syr-Daria. Des collines couvertes de villages entourés de jardins, dont la verdure se détache sur la steppe jaunie et hrùlée par le soleil, bordent et longent la rivière pendant un long espace de temps. Puis la rivière s'éloigne; les ramifications des montagnes commencent, et avec elles nous retrouvons notre horrible chemin; enfin nous passons la nuit à la station Mourzurabat, où le starosta et ses yemchiks ont été égorgés l'année dernière. Cette fois je dors passablement bien dans notre tarantasse. M. de Ujfalvy, qui a de nouveau la fièvre et dont les douleurs de tête sont intolérables, se jette sur un lit qu'on lui a préparé en plein air. Quant à Mohamed-Scha, il se couche philosophiquement sur la tombe du chef de poste. M. Muller est étendu dans sa tarantasse. Auprès de nous, deux kibitkas kirghises élevaient leurs toits ronds, et l'aboiement des chiens troublait seul le silence. Dans la nuit je me réveillai, brisée de fatigue, et contemplai cet étrange dortoir qui s'était augmenté du stanosta et de sa femme.
Tout le monde dormait; nous n'avions pour toit que le ciel étoilé et la lune qui brillait de toute sa pâle clarté. C'était pour un peintre le sujet d'un tableau original; cette steppe montagneuse sur laquelle s'élèvent une seule maison et deux kibitkas, cette tombe et ces voyageurs endormis au milieu de la nature silencieuse, me faisaient regretter de n'en pas emporter une image durable. Il me semblait être le jouet d'un rêve, lorsqu'une arba qui passait me fit comprendre que j'étais bien éveillée. J'aperçus quelques têtes brunies qui se penchaient hors de la voiture; ce fut tout; l'arba s'était éloignée. N'osant réveiller M. de Ujfalvy, je me rendormis moi-même; mais à cinq heures nous étions debout, prêts à partir. Jusqu'à notre arrivée à Pskend, le voyage fut un peu moins rude; nous suivions un petit cours d'eau (lui entretenait la fraîcheur et la verdure. Soudain le yemchik nous force à descendre. Qu'est-il survenu? C'est un pont en si mauvais état que notre tarantasse verse en le traversant. Nous avions obéi à notre conducteur, et ce fut heureux, car le choc fut des plus rudes.
A Pskend nous mangeâmes du raisin et des piochki (pains sartes) puis nous repartîmes pour Tachkend, où nous arrivâmes dans la nuit.