Un beau récit de Joseph Michel Tancoigne, ancien élève de l'Ecole des langues orientales, interprète et bon connaisseur de l’Orient puisqu‘il voyagea aussi en Perse. Une grande partie est consacrée à la description de la Crète (Candie) au début du XIXe siècle.
Joseph Michel Tancoigne (1787-1855) étudia à l’Ecole des langues orientales, fut attaché comme interprète en 1807 à l'ambassade de France en Perse du général Gardane (Claire Barat, réf . ci-dessous), interprète et chancelier du consulat de la Canée de 1812 à 1814, et drogman-chancelier à Smyrne en 1833 et 1838 (Alexandre Massé, réf . ci-dessous).
On le trouve cité, en 1802, dans une "Distribution des prix faite aux élèves du Prytanée, collège de Paris par le citoyen Roederer", an X : il est mentionné comme né à Paris, comme "ayant approché des prix" de compositions en langue turque ("L'une de Turc en Français et l'autre de Français en Turc"), et comme "déjà couronné", donc ayant déjà reçu ce prix.
Il raconta ses voyages dans deux ouvrages :
- Voyage à Smyrne, dans l'archipel et l’île de Candie en 1811, 1812, 1813 et 1814 suivi d’une Notice sur Péra et d’une Description de la marche du Sultan, Paris, Nepveu, 1817, VIII, 176, 148 pages. Une des planches du recueil est une grande gravure qui représente cette « marche du sultan dans les solennités des deux baïrams. » et qui fut souvent reproduite.
- Lettres sur la Perse et la Turquie d’Asie, Paris, Nepveu, 1819, 2 volumes, XIII, 302, 295 pp, 4 planches coloriées
- Traduction du précédent en Anglais : A narrative of a journey into Persia, and residence at Teheran containing a descriptive itinerary from Constantinople to the Persian capital; also a variety of anecdotes, illustrative of the history, commerce, religion, manners, customs of the inhabitants, military policy of the government, &c. From the French of M. Tancoigne, Londres, W. Wright, 1820, 402 pages
- Le guide des chanceliers, ou Définition raisonnée des attributions de ces officiers, appuyée du texte des lois, ordonnances et règlements, et d’extraits des instructions ministérielles les plus récentes sur la matière, Paris, Didot frères, 1847, xiv-103 p.
La version du voyage de Constantinople à Smyrne que nous reproduisons est extraite de la Nouvelle bibliothèque des voyages…, Paris, P. Duménil, sans date (1842), tome XI, pages 350-408
Sources
- « J.M. Tancoigne se rendit à Sinope de retour d’un voyage diplomatique en Perse, à la suite du général Gardane, chargé en 1807 d’une ambassade auprès du Shah de Perse afin d’entretenir l’inimitié entre Persans et Russes, d’offrir un conseil militaire à la Perse et de préparer une expédition éventuelle vers l’Inde. » in Claire Barat, « Voyageurs et perception des vestiges archéologiques à Sinope au temps de la représentation diplomatique française, sous le Consulat et l’Empire », Anabases [Online], 2 | 2005, Online since 01 July 2011, connection on 02 July 2017. URL : http://anabases.revues.org/1666 ; DOI : 10.4000/anabases.1666]
- Alexandre Massé, « « Une place peu convenable » : Être chancelier d’un consulat de France (premier XIXe siècle) », Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 128-2 | 2016, mis en ligne le 18 novembre 2016, consulté le 01 juillet 2017. URL : http://mefrim.revues.org/2751 ; DOI : 10.4000/mefrim.2751]
- Sur l’expédition Gardane en Perse : Vinson David, « « Napoléon en Perse » : genèse, perspectives culturelles et littéraires de la mission Gardane (1807-1809) », Revue d'histoire littéraire de la France, 2009/4 (Vol. 109), p. 871-897. DOI : 10.3917/rhlf.094.0871. URL : http://www.cairn.info/revue-d-histoire-litteraire-de-la-france-2009-4-page-871.htm
Texte du Voyage de Constantinople...
Le 19 décembre 1811, nous nous embarquâmes à Constantinople, sur une sacolève (1), pour nous rendre à l'île de Scio. Bercés de la douce espérance d'y arriver en vingt-quatre ou trente heures, nous fûmes bientôt con vaincus que sur mer, et particulièrement en hiver, on ne peut guère calculer la durée d'un voyage.
La distance de Constantinople à Scio est d'environ trois cents milles ou cent lieues. Dans la belle saison, ce trajet peut se faire en deux jours - mais en hiver, les vents du sud et du sud-ouest régnant presque constamment dans le canal des Dardanelles, les navires sont quelquefois retenus pendant un mois entier dans la mer de Marmara.
Nous mîmes à la voile à une heure après midi, par un vent de nord-est frais, qui nous fit bientôt perdre de vue la capitale. Tout nous annonçait une heureuse traversée, et nous avions déjà reconnu, au coucher du soleil, les îles de Marmara, lorsqu'un coup de vent du sud-ouest nous contraignit de rétrograder et de battre la mer toute la nuit, l'obscurité et l'ignorance de nos marins turcs et grecs ne nous permettant point de nous rapprocher de la terre sans courir le risque d'y échouer. Le temps continuant à nous être contraire, nous mouillâmes, le 20 au soir, dans une petite baie voisine de Kutchuk-Tchekmédjé [Küçük Çekmece], à environ trois lieues de Constantinople.
Héraclée de Propontide [Marmara Ereğlisi]. — Le lendemain, nous allâmes chercher un nouvel abri dans le port d'Héraclée de Propontide. Nous séjournâmes dans ce bourg les 23, 24 et 25, retenus par les vents du sud et du sud-ouest, qui ne cessaient de souffler alternativement.
Nos provisions étant épuisées, par suite de notre faux calcul, nous résolûmes de nous adresser, pour les renouveler, à des caloyers ou moines grecs établis dans un vaste monastère situé sur une colline qui commande le port ; mais, soit égoïsme, soit mauvaise volonté, ces religieux inhospitaliers nous refusèrent assez brutalement quelques objets, que nous offrîmes même de leur payer au delà de leur valeur. Nous prîmes alors le parti de nous adresser aux Turcs, chez lesquels nous parvînmes à nous ravitailler complétement. Nous trouvâmes à Héraclée un baïrak, ou corps de deux ou trois cents [351] soldats asiatiques, avec leur drapeau, qui allaient rejoindre l'armée du grand vizir Jousouf-Pacha, sur les bords du Danube. Cette horde indisciplinée, qui venait de commettre, selon son usage, mille désordres dans ce bourg, ne nous laissa, pendant toute cette journée, que peu de liberté de nous écarter du rivage de la mer. Nous attendîmes leur départ, qui, à notre grande satisfaction et à celle des habitants, eut lieu le lendemain, pour parcourir les en virons. Nous y vîmes les restes d'une fameuse muraille en briques, autrefois bâtie pour préserver le territoire de Byzance des incursions des Thraces; les ruines d'un temple antique, et de vastes magasins souterrains, qui servent aujourd'hui de retraite aux bestiaux.
1 Sacolève, espèce de barque turque qui ne porte qu'un mât de misaine, trois voiles car rées, et mie grande voile latine à l'arrière. La grandeur disproportionnée de cette dernière occasionne souvent des accidents.
Dans la matinée du 26, nous sortîmes du port d'Héraclée. Un violent coup de vent du sud-ouest nous obligea de nous réfugier le soir même dans une petite anse hérissée de rochers, sur la côte d'Asie, et à peu de distance de Culaïa.
Les Dardanelles. — Le 27, à la pointe du jour, nous entrâmes dans l'Hellespont, ou canal des Dardanelles [Çannakale], dont la largeur est d'une demi-lieue; et nous passâmes bientôt à pleines voiles devant Gallipoly, au moment où cette ville célébrait, par une décharge d'artillerie, la solennité du Courban-Baïram (1). A midi, nous jetâmes l'ancre devant le second château d'Asie et la petite ville, où résident les consuls européens.
Il est difficile de voir un spectacle plus imposant que celui de l'Hellespont. L'Europe et l'Asie, séparées par un simple bras de mer couvert de vaisseaux et de barques voguant dans tous les sens, offrent au voyageur un des points de vue les plus pittoresques qu'il y ait peut-être sur le globe.
Nous donnons ici la description des lieux les plus remarquables de la côte d'Asie.
Vallée des Eaux Douces d'Asie.
Kyat-Khana [Kağıthane], que les Francs appellent la Vallée des Eaux Douces, est un charmant vallon, placé à la base d'une chaîne de collines, et situé entre Eyoub [Eyüp] et Hassa Kuï [Hasköy], le quartier des Juifs. Il est entièrement fermé de tous les côtés, et, vu des hauteurs qui l'environnent et qui sont froides et arides, il semble une immense émeraude. Au travers de l'herbe épaisse de la vallée, et sous l'ombrage de ses arbres magnifiques, coule le Barbyses, ruisseau limpide, mais peu considérable, sur les bords duquel s'élèvent deux des plus beaux édifices qui aient jamais offert un abri au prince comme au paysan. Le plus vaste est un palais d'été, dans lequel les favorites du sultan viennent, pendant les longs et brillants jours de la belle saison, oublier les contraintes du sérail, et changer leurs impénétrables appartements du harem
1. Les Turcs ont deux Bairams ou fêtes solennelles. Le premier, qu'ils nomment simplement Baïram, termine le Jeûne du mois de Ramazan, et dure trois jours ; le second, ou Courban-Baïram [Kurban bayrami] (fête des Sacrifices), a lieu soixante-dix jours après, et en dure quatre, pendant lesquels il est d'usage d'immoler des moutons, dont on distribue la viande aux pauvres, en commémoration du sacrifice d'Abraham.
impérial contre les frais ombrages et les tapis de verdure des jardins du palais ; se livrant aux douceurs du repos dans les kiosques étincelants d'or placés au bord de l'eau, ou au charme de la promenade dans de brillants arabas ' traînés par des bœufs d'une blancheur éblouissante.

Il ne faut pas croire cependant qu'indépendamment de tous ces plaisirs il soit permis aux belles sultanes de communiquer avec ce monde dont la jalousie les sépare avec tant de soin. Quand le harem doit se rendre à Kyat-Khana, un cordon militaire est établi le long des hauteurs qui dominent sur la vallée, et personne ne peut approcher des points qui entourent immédiatement le palais. On peut néanmoins entrevoir les belles prisonnières, lorsque, entièrement voilées, et suivies d'autres bateaux remplis d'une partie de la garde noire du palais, elles se promènent sur le Barbyses dans leurs magnifiques caïques.
L'endroit prend son nom de Kyat-Khana, qui signifie littéralement la Maison de papier, parce qu'une fabrique de papier fut établie dans la vallée, par un renégat nommé Ibrahim, dans l'année 1727, sous le règne d'Achmed III. Mais on ne tarda pas à l'abandonner, ainsi qu'une imprimerie montée par le même individu, par suite du refus que fit l'uléma d'autoriser l'impression du Coran, d'une trop haute sainteté à ses yeux pour être publié par les presses des infidèles. Les bâtiments et tout le matériel qu'ils renfermaient se trouvaient à peu près dans le même état de délabrement, lorsque le sultan Sélim, oncle et prédécesseur du souverain actuel, jaloux d'introduire dans sa nation un art si utile, ordonna que rien ne fût épargné pour le rétablissement de la manufacture et de la fabrique. Mais ces projets, ainsi que plusieurs autres qu'il avait formés pour améliorer le sort de ses sujets, restèrent sans exécution, et s'évanouirent à sa mort. Il ne reste plus rien de ces entreprises, et les bâtiments sont de nouveau devenus une résidence impériale.
Le petit édifice est un kiosque, appartenant aussi au sultan, et occupé accidentellement par les grands officiers du palais. Il est placé sur les bords du Barbyses, et les caïques glissent légèrement sous ses fenêtres, ou se font un passage au travers du feuillage touffu des arbres plantés sur l'autre bord, avec une rapidité qui étonne toujours l'étranger ; tandis que les habitants du kiosque, livrés à une fastueuse indolence, fument leurs pipes, respirant la fraîcheur délicieuse des eaux, et récréés par la vue des promeneurs en bateaux.
Considérée isolément, la vallée est délicieuse : la verdure y est d'une beauté que n'offre aucune autre partie de la cité. Dans le printemps, on y met les chevaux du haras impérial, et les magnifiques coursiers de l'Arabie y sont installés en grande pompe, attachés à des piquets à la manière orientale, et gardés par des Bulgares qui tendent leurs tentes dans la vallée, et qui, sous aucun prétexte, ne peuvent s'éloigner jusqu'à ce qu'ils aient été relevés de leur poste. Dans l'été, la vallée est un lieu de promenade pour toute la population :
1. Voitures turques.
[ 353]
chaque vendredi, dimanche des Turcs, elle s'y rend pour jouir de ce que personne n'apprécie mieux que les Orientaux, d'un ciel pur, d'un limpide courant bordé de fleurs, de la plus belle verdure, et éclairé par les brillants rayons de l'astre du jour. Des voitures attelées de bœufs, et couvertes de draperies en soie de couleur, brodées d'or ; de riches arabas traînés par de rapides coursiers ; des caïques, dont le nombre et l'élégance de costume des rameurs indiquent le rang ou la fortune de ceux auxquels ils appartiennent, circulent avec rapidité ; tandis que l'épais feuillage d'arbres majestueux protége contre l'ardeur du soleil des groupes de dames couvertes de voiles blancs, et qui, accroupies sur des nattes ou des tapis, et entourées de leurs esclaves, passent des heures entières à écouter des musiciens valaques et bulgares, auxquels elles font donner quelques paras pour les récompenser de leurs peines ; achetant des bouquets emblématiques que leur apportent de jeunes Bohémiennes aux yeux noirs; ou regardant les danses ridicules des Slavons, qui, au son d'une cornemuse qu'ils portent sous leur bras, exécutent des espèces de mouvements mesurés qui ressemblent assez aux pas d'un ours auquel on a appris à danser. Çà et là on voit quelques groupes de Grecs avec leurs costumes pittoresques. Plus loin, de charmants enfants, des individus qui vendent des rafraîchissements ou des sucreries, parcourent ces vertes pelouses, recevant un aimable accueil de tous côtés. En un mot, la vallée offre la scène la plus animée ; et la classe peu aisée, qui n'a à sa disposition ni voiture ni caïque, brave la fatigue et la grande chaleur pour venir prendre sa part des plaisirs de ce délicieux endroit.
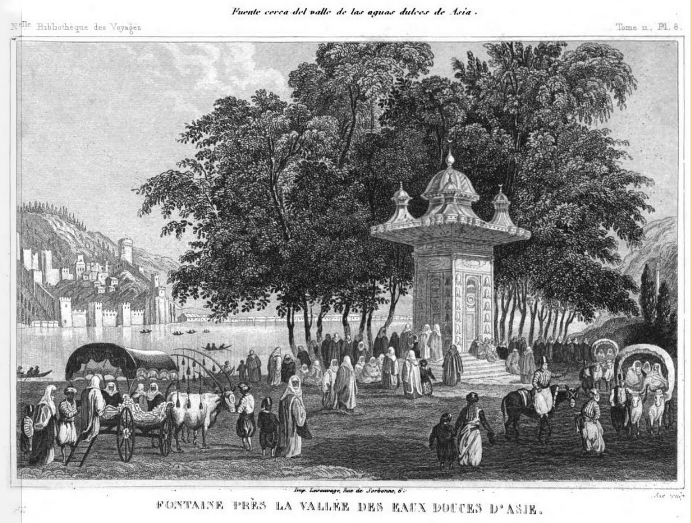
La plupart des affaires publiques se font accidentellement à Kyat-Khana; et alors le brillant Barbyses est couvert des barques des pachas et des beys, qui volent sur les eaux comme des météores. Le haut personnage est soigneusement garanti des rayons du soleil par un parasol écarlate étendu, au- dessus des coussins sur lesquels il repose en fumant tranquillement sa pipe, par un esclave assis à l'extrémité du rapide canot, immédiatement derrière son maître.
La vallée de Kyat-Khana est la résidence favorite du sultan actuel, qui a dépensé des sommes considérables pour embellir le palais, et pour décorer les fontaines et les kiosques qui en dépendent. Mais il n'y a pas longtemps qu'elle fut entièrement abandonnée pendant deux années, par suite de la mort de l'odalisque favorite, qui mourut au palais subitement, dans la fleur de la jeunesse et de la beauté, durant une visite que lui fit l'empereur. Les regrets qu'il éprouva de cette perte furent si vifs, qu'il ne voulut pas revenir dans la vallée jusqu'à ce que le temps eût adouci sa douleur. Un joli mausolée, érigé à la mémoire de la favorite, avec une inscription en lettres d'or, et ombragé par des saules pleureurs, a été élevé sur une plate-forme carrée, en face des fenêtres du salon occupé par l'empereur; et la brise, en se jouant
1. Le para est la plus petite monnaie connue : il en faut dix environ pour faire un sou de France.
[354]
au milieu des flexibles rameaux des saules, porte leur feuillage tout près des fenêtres de l'appartement. On dit que le sultan Mahmoud, qui passe pour être un poëte assez distingué pour un sultan, a écrit, à l'époque de son désespoir, une ballade touchante en l'honneur de celle qu'il pleurait. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'elle a été depuis longtemps oubliée, au milieu des beautés qui remplissent maintenant les appartements dorés du palais de Kyat-Khana.
Fontaine des Eaux Douces d'Asie.
La vallée de Guiuk-Suy [Göksu], dans une charmante situation à moitié route du Bosphore, et que les Européens appellent Eaux Douces d'Asie, doit son charme et sa popularité, comme le vallon de Kyat-Khana dont j'ai déjà parlé, à ce qu'elle est traversée par un joli courant d'eau fraîche qui, après avoir serpenté sous l'ombrage touffu des arbres qui le bordent, finit par porter son léger tribut aux ondes rapides du canal. L'Anadoli Hissari [Anadolu Hisarı], ou château d'Asie, est construit sur ses bords, et reporte péniblement l'esprit sur les tristes et sombres réalités de la vie ; car la nature a tant de charme à Guiuk-Suy, que l'étranger peut se croire transporté en Arcadie.
Les vendredis, sabbat des mahométans, la vallée est remplie d'oisifs qui fêtent cette journée : aussi le voyageur peut y observer les habitudes et le caractère des femmes turques mieux qu'il ne le pourrait faire partout ailleurs ; car, sur le sol asiatique, elles sont chez elles plus accessibles, et moins gênées par les restrictions imposées par leur croyance, que dans les autres environs de la capitale. Les voiles qui les couvrent sont fermés moins scrupuleusement; elles sont plus affables avec les étrangers, et elles font les honneurs de la vallée avec la politesse la plus gracieuse.
Toutes les classes se rendent dans ces lieux embaumés. Les sultanes se promènent sur les vertes pelouses, couchées nonchalamment dans leurs arabas dorés, traînés par des bœufs couverts de harnais brillants, et sur montés de rideaux de velours brodés en or ; les riches voitures des harems des pachas roulent avec rapidité, décorées de draperies élégantes, attelées de coursiers pompeusement caparaçonnés, et portant de jeunes beautés étendues sur des coussins de velours ou de satin, et souvent couvertes de châles d'une valeur très considérable. D'un autre côté, des femmes de beys, d'effendis et d'émirs descendent de leurs arabas, et s'asseyent sur des tapis de Perse, au doux ombrage des superbes érables qui sont en grand nombre dans la vallée; passant là des heures entières, les plus âgées avec leurs pipes, les plus jeunes avec leurs miroirs. De toutes parts se font et se rendent des saluts et des civilités, et les pâtissiers ambulants et les vendeurs d'eau font une riche récolte.
La fontaine de Guiuk-Suy est placée au milieu d'une double avenue d'arbres plantée sur le bord du Bosphore. Elle est en marbre blanc, construite sur un dessin élégant, et ornée d'arabesques travaillés avec soin. Elle sert de point de réunion aux oisifs et aux promeneurs de la vallée, surtout lorsque [356] autres pour ainsi dire, comme pour se disputer chaque ponce du terrain trois fois sacré qu'elles occupent.
Comme les Turcs sont imbus d'une idée superstitieuse, à laquelle ils ont une grande croyance, qu'à la fin du monde les mahométans doivent être chassés d'Europe, ils ont tous le désir d'avoir leur tombeau sur la terre d'Asie, pour préserver leurs cendres du contact du profane Giaour : alors, chaque année, la forêt de cyprès empiète sur les vignobles pourprés, et sur les terres couvertes d'épis dorés ; alors disparaissent successivement les vergers fleuris, et le gracieux maïs dont la brise agite le flexible et long feuillage. La faux du moissonneur, le couteau du vigneron ne servent plus à rien ; car ces moissons, fruit des travaux du laboureur, seront peut-être recueillies pour la dernière fois.
[Cimetière]
Il est d'usage qu'à l'enterrement d'un Turc, l'imam, ou prêtre, qui accompagne le corps, plante un cyprès à la tête et un autre au pied de chaque tombeau ; et, quoique le plus grand nombre de ces arbres périsse nécessairement par défaut d'air et d'espace, il en reste encore suffisamment pour en former une épaisse et sombre forêt. Dans quelques endroits, on a laissé des espaces ouverts pour donner un passage à l'air, et en même temps pour prévenir le danger de l'infection provenant des exhalaisons des tombes : mais la plus grande partie du cimetière est un vaste encombrement de morts, où les turbans en pierre placés à la tête des tombeaux, où les colonnes chargées d'inscriptions, s'élèvent comme des spectres, lugubres restes de ce qui n'est plus. De grandes leçons peuvent sortir de cette silencieuse et funèbre enceinte. Des tombes sculptées, et entourées d'une balustrade, surmontées soit d'une branche de rose pour désigner une épouse, soit d'un turban pour indiquer le chef de la maison, et ornées des mêmes emblèmes exécutés avec plus de soin, sont chargées de pompeuses inscriptions qui portent les noms et les titres d'une riche et puissante famille, couchée là séparément, et ne confondant point ses cendres avec des cendres plus communes : et cependant les morts moins aristocratiques qui sont placés de chaque côté ne jouissent pas moins qu'elle d'un sommeil profond et d'un repos éternel. D'un côté, la pierre tumulaire minée par le temps, et qui s'est abaissée peu à peu sur le sol qui à cédé à son poids, est à demi enterrée au milieu de l'herbe élevée : d'un autre côté, des colonnes brillantes de dorures, orateurs lugubres de la mort, n'ont point encore subi les atteintes de cette faux impitoyable qui a détruit les autres. Chaque année, cet ouvrage de destruction s'accomplit ; une génération succède à une génération, même dans cette cité de la mort : ici reposent ceux qui sont arrivés hier et aujourd'hui, et près de là il y a un espace suffisant pour ceux qui arriveront demain. Mais une émotion plus profonde encore se fait sentir dans le cœur de celui qui parcourt cette paisible enceinte, lorsqu'il s'arrête devant un groupe de colonnes assez élevées, sur montées d'un turban, et placées dans un petit carré couvert de dalles. Ces colonnes portent aussi les emblèmes de la mort, mais le petit bloc de granit [357] ou de marbre qui forme leur base n'indique point un tombeau : car, quel que soit le faible espace que chaque corps exige, le peu de place que l'on remarque ici ne suffit pas pour que les restes d'un être humain y soient convenablement déposés. Cette émotion qu'éprouve le voyageur ne le trompe pas, car ces pierres couvrent seulement les têtes de victimes, ou de leurs fautes, ou d'intrigues étrangères, dont le tronc déshonoré a été peut-être privé d'un lieu de repos. Ces personnages, conspirateurs trahis, hommes d'État qui ont échoué dans leurs expéditions, ou rivaux sacrifiés à la vengeance, ont été frappés au milieu de leurs rêves d'orgueil et de pouvoir, et n'ont pas même obtenu la tombe qui, cette fois au moins, les aurait mis de niveau avec leur espèce. Y a-t-il quelque chose de plus dérisoire que de voir, au-dessus de chacune de ces têtes mutilées, des turbans artistement sculptés, indiquant avec exactitude, par leur ampleur, leur forme et leurs plis, le rang de la malheureuse victime dont une faible partie est placée dans ce lieu; ironie perpétuelle d'autant plus amère qu'aucun nom n'indique à qui ils appartenaient! Là aussi se trouvent des tombes d'amour, jonchées de fleurs, et dont prennent soin le regret et la tendresse. C'est un adoucissement et un besoin de s'occuper de celles-ci, et d'oublier qu'une main, autre que celle qui dis pose des destinées humaines, a contribué à peupler ce cimetière ombrage de cyprès.
Chaque lieu de repos en Turquie a ses légendes superstitieuses ; mais celui de Scutari se distingue tellement par la poésie et quelquefois même par l'extravagance des siennes, que je ne peux pas me dispenser d'en dire un mot.
[Oiseaux du Bosphore]
Le Bosphore est fréquenté par des nuées d'oiseaux, à peu près de la grosseur d'une grive : leur plumage est noir, sauf sur la poitrine, où il est d'un bleu pâle. On croit que c'est une espèce d'alcyon ; mais comme les Turcs ne permettent pas qu'on les détruise, et qu'il serait dangereux pour un Franc d'en tirer un seul, les ornithologistes ne peuvent pas facilement vérifier le fait. On ne voit jamais ces singuliers oiseaux manger ou venir à terre. A peine se dérangent-ils pour laisser passer un calque, quand, ainsi que cela leur arrive quelquefois, ils volent très bas. Dans quelques occasions, ils s'élèvent un peu davantage ; mais, dans d'autres, ils laissent passer le bateau au milieu d'eux, sans paraître y faire attention. Ils volent rapidement et sans bruit de la mer Noire à la Propontide, où ils tournent un moment, et reviennent ensuite au Pont-Euxin. Arrivés là, ils y font encore un tour, et retournent à la mer de Marmara. C'est ainsi que, pendant des jours et des mois entiers, on les voit presque sans cesse aller et venir le long du canal, sans but apparent, sans se reposer, sans prendre de nourriture, et surtout sans se détourner en aucune manière de la route qu'ils suivent.
Il n'est pas arrivé une seule fois qu'on ait trouvé mort un de ces oiseaux ; et leurs habitudes sont tellement mystérieuses, tellement étrangères à celles des autres oiseaux, qu'on les a nommés âmes damnées, d'après une tradition, à laquelle beaucoup de Turcs ajoutent foi, que ce sont les âmes des méchants
[358]
dont les restes mortels occupent, à la vérité, une place dans le grand cimetière, mais dont la partie spirituelle ne peut pas se confondre avec les âmes des justes, qui jouissent d'une plus pure immortalité. Il y a une circonstance qu'on suppose avoir donné lieu à cette superstition : c'est que, pendant les tempêtes, lorsque ces oiseaux ne peuvent pas faire leur voyage ordinaire le long du canal, on les voit voler vers la forêt de cyprès pour s'y mettre à l'abri : et comme c'est alors seulement qu'on entend leur cri, les personnes crédules et superstitieuses (et elles sont en grand nombre dans l'Orient) disent que le son aigu qu'ils font entendre est un cri d'agonie, et qu'ils sont forcés, pendant toute la durée de leur voyage maritime, de se raconter les uns aux autres la série des crimes qui les ont privés du repos de la tombe, et les obligent à errer continuellement sur la surface des eaux.
[Scutari]
Mais, en faisant la description des particularités remarquables du grand cimetière asiatique, je ne dois pas omettre de parler de la Cité d'Argent de Scutari, dont il est une des plus belles dépendances. Ses brillantes maisons couronnent le gracieux promontoire qui termine la chaîne de montagnes servant de bornes aux rives du Bosphore du côté de l'Asie, et dont la base se plonge dans le bassin vaste et argenté de la mer de Marmara. On ne peut rien imaginer de plus magnifique que la position de la ville de Scutari, bâtie sur ce pittoresque promontoire, et projetant au loin, sur le miroir du Bosphore et vers la côte européenne, les ombres légères et élancées de ses minarets ; lorsque la côte escarpée, à la base de laquelle elle est placée comme une perle, semble reculer devant les vagues de la Propontide, recevant elle-même l'ombre du majestueux Bulgurlhu Daghi, qui dessine sur l'azur des cieux son front, quelquefois sombre et menaçant, présage de la tempête ; lorsqu'enfin les rayons du soleil dardent sur les flots qui roulent à ses pieds, et vers lesquels descendent insensiblement les jardins suspendus des principales habitations, qui forment sur les contours de la côte comme un feston de broderies gracieuses et variées, et dont le reflet produit sur les eaux des ondulations et des ombres fantastiques, que varie sans cesse une brise légère. Les groupes de maisons sont encadrés par une brillante végétation; les kiosques impériaux, peints des diverses couleurs de l'arc-en-ciel, donnent à ces côtes l'apparence d'un éternel printemps ; la verdure descend en masses touffues jusqu'aux bords des deux mers qui baignent la rive ; et enfin, à moins d'une portée de flèche du quai, se trouve la Tour de la Demoiselle [Kız kulesi], château petit et pittoresque, bâti sur un rocher de si peu d'étendue que les fondations en couvrent toute la surface, de sorte que l'édifice a l'air de flotter sur les eaux.
Cette petite forteresse, avec sa cour élevée et ses murailles crénelées, est aussi le sujet d'une légende qu'on rapporte ainsi : Un certain sultan, dont le nom est oublié, avait une très jolie fille, seul enfant que le Prophète lui avait accordé, et qu'il chérissait tendrement, comme son unique espérance. Belle comme une houri, gracieuse comme une déesse, aimable comme le [359] doux zéphyr d'été, quand il se joue au travers des jardins de rose de Nischapor, la jeune fille commençait à grandir, quand son père, plein de sollicitude sur ses futures destinées, voulut consulter un célèbre astronome. Celui-ci, après avoir parcouru avec attention les feuillets, peints en partie, d'un livre mystérieux dans lequel on pouvait lire le sort des humains, prononça cette effrayante prophétie, qu'à sa dix-huitième année la jeune personne deviendrait la proie d'un serpent.
Frappé d'horreur à cette affreuse nouvelle, le sultan fit construire Guz-Couli [Kız kulesi], ou la Tour de la Demoiselle, et y fit renfermer sa jolie fille, avec ordre de la séparer du monde entier jusqu'à ce que l'époque fatale fût passée, de manière à éloigner jusqu'à la possibilité du terrible événement qu'on craignait. Mais, dit la légende, qui peut se défendre de son sort ? qui peut échapper à son étoile ? Ce qui est écrit est écrit, et l'avenir a été dévoilé. La princesse trouva la mort dans un panier de figues fraîches venant de Smyrne, et parmi lesquelles était caché un petit aspic. Le jour où elle atteignit sa dix- huitième année, elle fut trouvée sans vie sur son sopha, ayant les fruits près d'elle : le reptile, pareil à celui qui porta la mort dans les veines de la reine Cléopâtre, gorgé du sang de sa malheureuse victime, reposait sans mouvement sur son sein.
Le conte est joli ; mais il existe une autre tradition qui présente avec celle-ci quelques différences, et qui dit que le serpent était caché dans les habillements d'un jeune prince persan, dont la curiosité fut excitée par les récits merveilleux qu'il entendait faire de la beauté incomparable de la jeune prisonnière, et qui se dirigea en caïque, pendant la nuit, vers les murs de Guz-Couli. Il réussit à avoir une entrevue avec la captive, gagna son cœur, et, au moyen d'une corde en soie et d'un bras vigoureux, il allait l'enlever de sa prison, lorsqu'arriva la crise fatale qui avait été prédite. Entre ces deux versions d'un événement historique, le lecteur a le choix.
Fontaine et marché à Scutari.
Le marché aux fruits, à Scutari, est placé au bord de la mer : au milieu on voit une ancienne fontaine, d'un style simple, mais gracieux. Elle fournit une grande quantité d'excellente eau, qui vient du sombre sommet du Bulgurlhu ; et, par une superstition dont il est difficile de connaître la cause, les Turcs n'ont jamais voulu souffrir qu'elle servît aux besoins des habitants de la côte européenne, même dans les temps de la plus grande sécheresse. Aussi, en 1836, dans un moment où l'eau était excessivement rare, et que, des villages placés à l'entrée de la mer Noire, on la transportait à grands frais et après beaucoup de temps à la ville qui en manquait, on laissait la fontaine de Scutari couler à grands flots, et porter jusqu'au Bosphore la surabondance de ses eaux.
On a du marché une vue magnifique de l'ensemble du canal ; et l'endroit en lui-même est remarquable et digne d'intérêt. L'énorme quantité des fruits les plus parfumés et les plus délicieux qu'on y voit, ainsi que leur bon marché, [360] a quelque chose de surprenant pour un Européen. Les raisins et les melons de Scutari ont une grande réputation dans tout l'Orient ; ses figues rivalisent avec celles de Smyrne ; et il n'y a pas une seule des îles de l'Archipel dans laquelle les grenades soient plus belles et plus juteuses. Les oranges, les citrons, tes pêches, les délicates pommes d'api, qui n'ont de celles de l'Occident que la forme, y sont en abondance; et, avec quelques piastres, le Franc peut en remplir son calque.
Musiciens à la Vallée des Eaux Douces d'Asie.
J'ai déjà parlé de la Vallée des Eaux Douces d'Asie, de ses majestueux platanes, de sa charmante rivière, de ses délicieuses pelouses, des jeunes beautés qui viennent se reposer sous ses ombrages, des sultanes qui les embellissent par leurs brillants équipages, et des jeunes enfants qui font retentir les airs de leurs chants. Mais les musiciens font une classe à part, et méritent une notice séparée.
Leur musique n'a rien de bien harmonieux : le virtuose ne doit chercher aucun art dans leurs accords, et le poète ne peut pas se plaire à entendre leurs absurdités ; cependant il est impossible de ne pas rire de ce qu'ils disent, et de ne pas partager la bruyante gaieté qu'ils excitent autour d'eux. Le calpac [kalpak] de l'un et le turban de l'autre couvrent également le malin et l'homme industrieux. Que de choses on peut dire dans un poème, et donner à entendre dans une stance ! Là on voit la matrone, toujours circonspecte et vigilante, se rappelant ses jeunes années, et les piéges dont elle était entourée : maintenant, séduite par l'artificieuse musique des bardes voyageurs, elle semble tout oublier, sauf les charmes de leur vive imagination et de leur apparente simplicité. Près d'elle est la jeune beauté voilée, et dont la toilette indique de jalouses précautions, il est vrai, mais dont le cœur est aussi brûlant, l'imagination aussi ardente que si les grilles et les jalousies étaient inconnues dans le pays où elle est née. Ses joues, où règne la pâleur, se couvrent d'un doux incarnat, son pouls bat avec plus de force aux paroles qu'elle entend; car les récits des bardes font sur elle une impression plus profonde que sur sa tranquille compagne. Dans cette foule nombreuse se remarquent aussi des groupes d'enfants qui, dans une muette admiration, prêtent une attention soute nue aux chants des musiciens. Ceux-ci débitent de vieilles légendes d'un ton bas, traînant et monotone, qui ne contribue pas beaucoup à relever le peu d'intérêt qu'elles ont quelquefois : mais le tambour de basque et le bruyant carillon de ses sonnettes argentées, ainsi que le son un peu sourd du petit tambour arabe, dont ils s'accompagnent ordinairement, font oublier l'ennuyeuse monotonie de leur débit. Il faut au reste que ce spectacle ait un grand charme ; car on voit les spectateurs rester là plusieurs heures de suite, écoutant, et faisant retentir les airs de nombreuses et bruyantes acclamations, sans donner la moindre marque d'ennui.
Il y a parmi ces musiciens beaucoup de Valaques et de Juifs : et rien n'est [361] plus singulier que de les voir rester pendant un temps considérable sur une seule note, la téte en arrière, la bouche ouverte, les yeux fixes, et en prononçant avec force et rapidité une phrase entière sans reprendre haleine. Mais ces troubadours orientaux ne sont pas sans rivaux dans l'admiration des beautés voilées qui les entourent : les sorciers, les improvisateurs, les conteurs et les danseurs bulgares leur enlèvent une partie de leur auditoire; et autour d'eux règne un bruit continuel, causé par les vendeurs d'eau, de fruits et de sorbets. Cependant, de tous ces hommes-là, ce sont les musiciens qui sont les plus populaires; et celui d'entre eux qui a un talent reconnu ne manque guère de gagner une bonne journée, à chaque fête qui a lieu aux Eaux Douces d'Asie.
Beglier Bey [Beylerbey]
Le palais d'été impérial de Beglier Bey, sur la côte asiatique, est ce que le Bosphore offre de plus élégant. C'est un bâtiment très étendu, et dont la façade est irrégulière, construit sur le bord du canal, dont les flots baignent le pied d'une magnifique terrasse en marbre, et s'introduisent même quelquefois dans les mystérieux appartements inférieurs. Le palais est en bois; et la partie où est placé le harem se compose d'une suite de pignons dans lesquels sont pratiquées de longues rangées de fenêtres défendues avec le soin le plus minutieux par des contrevents en bois doré. Le Salemliek [Selamlık], qui renferme les appartements de parade, les salons particuliers du sultan, et les pièces occupées par la famille impériale, est un édifice octogone, dont le toit pointu est surmonté d'un croissant supportant une étoile, dont les rayons richement dorés jettent l'éclat du feu, lorsqu'ils sont éclairés par les rayons du soleil. Tout l'édifice est peint en blanc et en or pâle; et il a plutôt l'aspect d'un palais de fées élevé par enchantement, que l'ouvrage de l'homme.
Une porte en marbre ferme la terrasse du côté de la ville : c'est par là qu'on fait entrer les visiteurs dans un jardin rempli des plus belles fleurs, et embaumé de leur parfum; où de nombreux jets d'eau rafraîchissent l'air, et, par leur doux murmure, ajoutent à l'agrément du lieu; où des oiseaux errent à volonté, et dont le plumage éblouissant brille des couleurs de l'arc-en-ciel, de même que les fleurs au milieu desquelles ils se jouent. Une grille dorée défend du côté de la mer cette retraite délicieuse : au-delà, une porte, d'un beau travail et de superbes proportions, conduit à la grande salle d'entrée.
Dans le premier moment, l'intérieur n'a rien d'imposant : le double escalier, formant une espèce de croissant dans le milieu de la pièce, en diminue la grandeur et en fait presque disparaître les proportions; défaut que rendent moins sensible le beau travail des sculptures, et les dorures des colonnes et des balustrades. Néanmoins cet effet du premier coup d'œil est trompeur: car de cet appartement, couvert d'ornements en bois précieux, dont le plafond est peint en arabesques, et qui est parfaitement éclairé, on entre dans huit salons spacieux, disposés pour la famille impériale.
[362]
Au-delà sont les appartements de parade, resplendissants de dorures, et qui sont meublés avec tout le luxe que peu vent déployer l'Orient et l'Occident. Des divans turcs en étoffes d'or et en velours brodé, des sofas et des lits de repos a la mode d'Europe, de la bijouterie de Genève, de la porcelaine de Sèvres, des marbres d'Italie, des mosaïques de Pompéi, des tapis de Perse, des tentures d'Angleterre, y sont à profusion. Dans le principal salon, on voit six des plus belles glaces qu'on puisse voir dans le monde, si ce ne sont pas même les plus belles: c'est un présent fait au sultan par l'empereur de Russie, après le traité d'Unkiar Skelessi [Hünkâr İskelesi]. Entourées de larges cadres de vermeil, et portant les armes réunies des deux empires, ces glaces magnifiques réfléchissent dans toutes les directions les ornements dont la pièce est décorée, et produisent un effet presque magique. D'un autre côté, le plafond richement travaillent sur lequel sont sculptées d'élégantes guirlandes de fleurs, le riche et brillant tapis qui couvre le plancher, viennent contribuer à donner à ce salon un aspect enchanteur et délicieux, qu'augmentent encore toutes les beautés du jardin placé sous les fenêtres, avec-ses jets d'eau, ses orangers, et ses beaux treillages.
Le salon de réception est petit, et remarquable seulement par l'élégance et la commodité du divan sur lequel le sultan reçoit les visiteurs, ainsi que par la vue magnifique dont on y jouit, et qui s'étend sur tout le canal, de puis la pointe du sérail jusqu'au château de Mahomet.
La salle de banquet est entièrement lambrissée de bois rares et précieux, travaillés en mosaïque. Le plafond et le parquet représentent des guirlandes de feuilles de vigne et de grappes de raisin, entremêlées de pommes de pin du travail le plus exquis.
De là une longue galerie conduit à l'appartement privé du sultan : de chaque côté sont de gracieuses fontaines de marbre blanc, dont les eaux jaillissantes retombent avec un harmonieux murmure dans des bassins ornés de sculptures. Dans une d'elles, le filet d'eau coule par un bouquet de plumes en albâtre, dont le travail est si délicat qu'elles paraissent plier sous le poids de l'eau qui en tombe. Dans une autre, l'eau se répand avec abondance sur une fleur de lotus, au bord de laquelle est placé un groupe d'Amours. Les appartements particuliers qui séparent le harem des pièces de parade réunissent toutes les commodités imaginables. Deux des pièces sont lambrissées en osier, admirablement travaillé, et revêtu d'une couleur à la crème. Il est difficile de voir une idée aussi gracieuse rendue avec plus de goût.
Le harem est comme un livre fermé : car les femmes du sultan n'ont pas même la permission de satisfaire leur curiosité, en visitant la partie du palais réservée à Mahmoud lui-même ; et on ne peut pas supposer qu'un étranger fût admis à franchir le seuil, si scrupuleusement gardé, qui conduit chez elles.
Il ne me reste plus qu'à parler des vastes et magnifiques jardins, dont les terrasses s'élèvent les unes au-dessus des autres jusqu'au sommet de la
[363]
montagne qui domine le palais. Chaque terrasse est confiée à la garde d'un jardinier étranger, et disposée suivant le goût et la manière de son pays. La plus belle partie du jardin renferme une charmante pièce d'eau, qu'on nomme le Lac des Cygnes, et sur laquelle on voit en grande quantité ces beaux oiseaux, que le sultan aime avec tant de passion qu'il passe quelquefois des heures entières à les voir glisser sur la surface des eaux. Des bateaux peints et dorés sont amarrés à l'ombre des magnolias, des saules, et d'autres beaux arbres qui entourent le lac. A plusieurs toises du bord est un charmant et délicieux pavillon appelé le Bain d'Air, et qui sert d'abri contre les grandes chaleurs de l'été. Le toit, les murs et les planchers sont en marbre, sur lequel sont gravés des emblèmes maritimes. Des fontaines répandent leurs eaux sur une suite de coquilles, de divinités de la mer, de plantes marines et de petits rochers de corail, et entretiennent un courant continuel d'air frais, en faisant entendre un doux et délicieux murmure. Plusieurs autres pièces font suite à ce magnifique salon, et tout l'ensemble forme le plus joli bijou qu'il soit possible d'imaginer. Les ondulations que forme la côte, garnie de maisons, et abritée par des collines couvertes d'une épaisse verdure, les rochers fortifiés ; les voiles brillantes des vaisseaux passant sur le canal ; et, plus loin, l'orageux Euxin, semblant dédaigner de baigner de ses flots les forteresses qui hérissent ses barrières : tout se réunit pour former un tableau digne de fixer l'attention du peintre, et d'exciter l'admiration du voyageur.
Après cette longue digression, qui n'aura pas été, nous le pensons, sans intérêt pour le lecteur, nous allons reprendre la narration de notre voyage.
Lorsque notre sacolève eut subi la visite ordinaire de la douane des Dardanelles, et que nous eûmes rendu nos devoirs au consul de France, nous continuâmes notre route vers l'embouchure du canal. Nous passâmes entre les deux premiers châteaux d'Europe et d'Asie, et découvrîmes, dans le lointain, la côte de Troie, que le soleil couchant éclairait de ses derniers rayons.
A six heures du soir nous sortîmes de l'Hellespont, par un vent frais du nord-est, qui nous favorisa tellement toute la nuit, que le 28, à la pointe du jour nous nous trouvions au sud-ouest de Mételin (1), à la vue de l'île de Scio, où nous aurions bientôt abordé, sans un calme plat qui nous retint toute la journée entre Ipsara et l'entrée du golfe de Smyrne.
Scio. — Nous ne jetâmes l'ancre dans le port de Scio que le 29, à huit heures du matin. C'était le troisième jour du Courban-Baïram, la fête la plus solennelle des musulmans.
1. Mételin est l'ancienne île de Lesbos. Elle a une quarantaine de lieues de tour : ses deux meilleurs ports sont Porto-Sigri et Port-Olivier. J'eus occasion de relâcher dans ce dernier, à mon premier voyage à Constantinople. La ville est bâtie en amphithéâtre, à peu de distance de la mer, et sur des rochers très escarpés. On y voit peu de Turcs ; la majeure partie des habitants de l'île sont Grecs.
Les drapeaux de soie des janissaires [364] flottaient sur la forteresse, et la variété de leurs couleurs produisait un coup d'œil charmant. Quoique nous fussions à la fin de décembre, l'air était aussi doux et le temps aussi beau qu'au mois d'avril.
Nous ne passâmes, cette fois, que deux jours à Scio. J'entrerai plus bas dans quelques détails sur cette île, où je demeurai dix-huit jours, à mon retour de Smyrne.
Après avoir fait une visite au consul de France, nous cherchâmes de suite une occasion pour nous rendre à Smyrne, où nous devions passer une partie de l'hiver.
Nous nous embarquâmes sur un petit bateau turc, chargé d'oranges et de citrons, qui nous transporta de Scio à Tchesmé [Çeşme], sur la côte d'Asie, dans l'espace de deux heures et demie. La largeur du canal n'est que de cinq lieues; mais nous souffrîmes cruellement de la mer dans notre frêle embarcation, qui contenait une vingtaine de passagers entassés les uns sur les autres, sans compter les matelots turcs et leur flegmatique patron, qui ne cessa pendant tout le trajet de fumer et de dormir, sans se mêler en rien de la manœuvre.
Tchesmé [Çeşme]. — A notre arrivée à Tchesmé, nous nous fîmes conduire, par un matelot, chez l'agent de France, pour lequel le consul de Scio nous avait donné une lettre de recommandation.
Cet agent était un jeune Grec, vêtu à l'orientale, et d'une ignorance complète des mœurs et de la langue de la nation qu'il représentait, quoique dans le pays tout le monde le saluât du titre de consul. Il nous offrit assez poliment sa maison pour y passer la nuit, à condition que nous déménagerions le lendemain ; mais il nous déclara formellement qu'il lui était impossible du nous donner à souper, parce que c'était vigile, et qu'il ne se trouvait rien dans le pays qui fût digne de nous être présenté. Nous nous récriâmes unanimement contre une pareille déclaration, protestant que nous n'étions pas d'humeur à nous coucher sans souper ; et nous offrîmes même de payer d'avance toutes les provisions qui nous seraient nécessaires. Ces dernières paroles produisirent tout l'effet que nous en avions attendu sur l'esprit de cet honnête agent, qui, bien convaincu qu'il ne réussirait point à nous faire jeûner, devint tout à coup l'homme du monde le plus traitable, et s'empressa d'expédier de tous côtés ses domestiques, qui ne tardèrent pas à rentrer avec d'excellent poisson, de très bon vin, et des fruits de toute espèce.
1. Les consuls de France ont, sur différents points de leurs départements, des agents chargés de les représenter, et de protéger en leur nom les voyageurs français. Ces agents sont le plus souvent des gens du pays, qui gagnent par ce moyen la protection du gouvernement qu'ils servent, mais qui ne se comportent pas tous de manière à le faire respecter. Il serait fort à désirer, pour l'honneur de la nation, que les consuls n'accordassent ces places de confiance qu'à des Français.
L'agent fit alors dresser une table ronde, couverte d'une nappe d'indienne de couleur, assez malpropre : il ne voulut jamais se mettre à table avec nous, malgré nos instances réitérées. Pendant tout le souper, il resta constamment debout, avec ses domestiques et les nôtres, occupé à nous verser à boire et à changer nos assiettes.
Au moment où, pour nous délasser des fatigues de la journée, nous nous disposions à prendre quelque repos sur un sofa qui occupait tout le tour de l'appartement, notre agent, qui venait de disparaître subitement, rentra d'un air embarrassé, une écritoire et une feuille de papier blanc dans une main, et dans l'autre une grosse liasse de papiers écrits, enfilés par un long fil de fer. Nous ne pouvions deviner où il allait en venir, lorsqu'il nous pria le plus humblement possible de lui délivrer, avant de nous endormir, un petit certificat par lequel nous reconnaîtrions avoir été reçus et hébergés chez lui, afin que ladite pièce pût lui servir et valoir en tant que de besoin ; et, pour nous déterminer plus vite à lui accorder cette faveur, déroulant en un clin d'œil sa liasse de papiers, il étala avec complaisance une trentaine d'attestations semblables, que lui avaient délivrées divers voyageurs et passagers français. Nous rédigeâmes, à l'instant même, un acte en bonne forme, tel en tout point qu'il l'avait désiré ; et la pièce fut incontinent et en notre présence enfilée avec les autres, pour être exhibée dans l'occasion. Je ne cite ce fait que pour donner au lecteur une idée du mélange d'orgueil et de bassesse dont se constitue le caractère de la plupart des agents de nos consuls : on doit penser que nous rîmes beaucoup de l'aventure. Nous consacrâmes le reste de la soirée à faire nos préparatifs, afin de continuer notre route dès le lendemain matin. Nous fîmes en conséquence arrêter des chevaux pour nous rendre par terre à Smyrne, qui n'est éloignée de Tchesmé que de quinze lieues.
Tchesmé est une ville de cinq ou six mille habitants turcs et grecs, située sur la côte d'Asie, en face de l'île de Scio. C'est dans ce port que fut détruite, le 7 juillet 1770, la flotte ottomane sous le commandement du fameux Gazi-Hassan-Pacha, par l'amiral russe Spiritow. Les campagnes environnantes sont, comme celles de Scio, couvertes d'orangers et de citronniers.
Il existe au bord de la mer, et à peu de distance de la ville, une source d'eau chaude; bientôt on cesse de côtoyer le rivage pour entrer dans des montagnes arides, en se dirigeant sur le pic des Deux-Frères, le point le plus élevé de la chaîne de montagnes qui finit au cap Karabournou.
Ourlak [Urla]. — Nous n'arrivâmes que fort tard à Ourlak, gros bourg à un quart de lieue de la plage, sur le promontoire Karabournou [Karaburnu], et que quelques voyageurs prétendent être l'ancienne ville de Clazomène, l'une des sept cités qui se disputaient l'honneur d'avoir donné naissance à Homère.
Nous passâmes la nuit à Ourlak, dans la maison d'un Grec qui tient une espèce d'auberge : et, remontés à cheval à la pointe du jour, nous descendîmes, à travers des rizières très étendues, au bord de la mer, que nous côtoyâmes jusqu'à notre arrivée à Smyrne.
Avant d'entrer dans cette ville, on traverse un bois d'oliviers qui se [366] prolonge au sud-ouest, derrière le château, l'espace d'une grande lieue; on y rencontre trois postes de janissaires, qui ne manquent jamais de rançonner les voyageurs, sous le prétexte qu'ils sont là pour veiller à leur sûreté.
Smyrne [Izmir]. — Smyrne est située à l'extrémité sud-est d'un golfe dont la profondeur est de quinze lieues, depuis le cap Karabournou jusqu'à l'entrée de la rade : cette rade est séparée du reste de la baie par une langue de terre basse, couverte d'oliviers, et défendue, du côté du nord, par un mauvais château et quelques batteries. La passe, entre le château et la rive septentrionale, serait assez large pour permettre aux vaisseaux de la forcer, sans avoir rien à craindre des batteries; mais les bas-fonds qui la bordent obligent nécessairement tous les navires qui entrent et qui sortent, de passer sous le canon du fort.
Je ne parlerai ni de l'origine ni de l'antiquité de la ville de Smyrne : plusieurs savants voyageurs m'interdisent d'en parler après eux. Mon but n'est de rapporter que ce que j'ai vu. Je me bornerai à donner quelques notions sur l'état actuel de cette ville.
Smyrne renferme plus de cent mille habitants, parmi lesquels on compte au moins soixante mille Turcs. Le reste de la population se compose d'à peu près vingt-cinq mille Grecs, dix mille Arméniens et cinq mille Juifs. Ses rues sont toutes sales et étroites, et les maisons bâties, comme à Constantinople, de terre, de briques cuites au soleil, et de bois ; les incendies y sont aussi fréquents que dans la capitale. En arrivant par mer, on aurait peine à se figurer d'abord toute l'étendue de cette grande et riche cité : la majeure partie des quartiers turcs est bâtie dans un vallon plus bas que le niveau de la mer, et l'on y respire un air humide et malsain. Je ne pus jouir de sa vue entière que du haut d'un kiosque très élevé.
Les bazars sont ce que cette ville offre de plus curieux. Un étranger ne peut s'empêcher d'en admirer l'étendue, aussi bien que l'ordre et la symétrie avec lesquels sont étalées les plus riches marchandises de l'Orient. Chaque état, chaque profession a ses galeries particulières, séparées par des portes qui se ferment chaque soir, au coucher du soleil. On est seulement surpris de voir les denrées les plus précieuses exposées aux incendies, dans de misérables échoppes de bois, tandis que les fruits secs, les comestibles de toute espèce se vendent sous de magnifiques voûtes de pierre : bizarrerie dont on cesse bientôt d'être étonné, lorsqu'on connaît l'apathique insouciance des Turcs.
Smyrne, comme presque toutes les villes de la Turquie, n'offre aucune édifice remarquable : la maison du gouverneur, une des plus apparentes du quai, n'est bâtie que de bois peint, et ses mosquées même sont toutes petites et mesquines.
Cette cité est l'apanage de la Validé-Sultane (mère du Grand Seigneur), qui y entretient un mulésellim, ou simple gouverneur, qui ne relève que de cette princesse, et ne reconnaît pour chef aucun des pachas voisins. Ce mutésellim a sous ses ordres une soldatesque nombreuse et turbulente de [367] janissaires, qui ne demandent que pillage et désordre, et auxquels les incendies qui ravagent si souvent cet entrepôt du commerce de l'Anatolie procurent de fréquentes occasions de s'abandonner à leur penchant pour la rapine.
Deux autres fléaux, les tremblements de terre et la peste, affligent presque continuellement cette ville, surtout le dernier, que lui apportent assez ordinairement les navires de Constantinople et ceux d'Égypte, ou les caravanes de l'Asie Mineure. En 1812, la contagion fit des ravages affreux dans presque toutes les parties de l'empire ottoman : elle enleva, dans un seul été, deux cent cinquante mille habitants à Constantinople, et plus de quarante-cinq mille à Smyrne.
Malgré tous ces inconvénients, Smyrne est l'échelle du Levant qui offre le plus d'agréments aux Européens que leurs affaires ou leurs fonctions appellent en Turquie. On y compte, tant Français qu'Anglais, Italiens, Hollandais, Allemands, Russes et autres, une petite colonie de cinq ou six mille individus établis sur le pays avec leurs familles, et qui habitent un quartier particulier, à proximité du port, et entièrement séparé de ceux des Turcs. Toutes les nations y entretiennent des consuls, dont les maisons sont situées sur le quai et décorées de jolis mâts de pavillon.
Excepté plusieurs des consuls, un petit nombre d'officiers des consulats et quelques négociants, on voit à Smyrne peu de véritables Européens ; les autres sont ce qu'on appelle, en Levant, des Francs, c'est-à-dire des hommes originaires de tous les pays, nés, mariés et établis en Turquie, ne connaissant guère d'autres mœurs et d'autre langage que ceux des Grecs, et qu'on pourrait comparer, sous quelques rapports, aux créoles de l'Inde.
Les consuls et les négociants francs accueillent avec beaucoup de politesse les étrangers que la curiosité ou le hasard conduisent à Smyrne. Partout ils sont fêtés, bien reçus, et c'est à qui les traitera le mieux. Il faut rendre à chaque pays la justice qui lui est due : c'est tout le contraire à Constantinople.
Nous arrivâmes à Smyrne dans la saison des plaisirs, pendant la semaine du jour de l'an, dont les visites se font et se rendent avec beaucoup de cérémonial et d'étiquette. A la même époque commence le carnaval, qui est ici un temps de bombance et d'amusements de toute espèce. Je n'ai vu nulle part, dans le Levant, des tables servies avec plus de choix, et même de profusion, qu'à Smyrne ; il faut cependant convenir que l'amour-propre et le désir de briller n'y entrent pas pour peu de chose.
Les négociants de toutes les nations ont un lieu de réunion qu'ils nomment le Casin. Moyennant un abonnement médiocre, on y trouve, à toutes les heures du jour, un bon feu, des livres, des brochures, des journaux, des billards, et des rafraîchissements de toute espèce. Ce lieu peut être considéré à la fois comme le Wauxhall et la Bourse de Smyrne : on y danse, et on y traite toutes les affaires de banque et de commerce.
[368]
Pendant le carnaval, les abonnés se cotisent extraordinairement, pour donner aux dames des fêtes et des bals où se réunit toute la meilleure société de la rue Franque. Les consuls, qui ne peuvent faire partie de l'association, y sont invités avec leurs familles, ainsi que les étrangers et les voyageurs présentés par un des membres. Deux commissaires, l'un français et l'autre anglais, en font les honneurs, et y maintiennent le bon ordre et ce qu'ils appellent la police : il serait fort à désirer que le maintien de la décence entrât aussi pour quelque chose dans leurs attributions. Nous assistâmes à plusieurs de ces brillantes réunions, où personne n'est gêné par l'incommode étiquette des palais de Péra; mais où, dès le premier abord, on est frappé du peu de goût qui préside à la toilette des dames, et de l'allure un peu brusque de quelques jeunes gens. On remarque également avec surprise plusieurs fautes d'orthographe dans les deux placards encadrés qui renferment les règlements de la société.
La Longue, ou Promenade anglaise, est la danse favorite des Francs de Smyrne ; et l'anglomanie la plus outrée est ici, comme dans toutes les échelles, la passion dominante du Levantin. Tous, depuis le négociant jusqu'au courtier, depuis le courtier jusqu'au simple commis, sont ridiculement costumés à l'anglaise ; et plusieurs portent cette bizarre manie au point d'imiter l'accent anglais dans la prononciation de leur propre langue, bien qu'ils ne soient jamais sortis de leur pays.
Les Latins ont à Smyrne deux jolies églises : celle des Capucins, qui est sous la protection de la France, et celle des Soccolans, ou Récollets, protégée par l'Autriche. Les lazaristes français, qui tiennent une école composée d'une vingtaine de jeunes enfants, y avaient autrefois aussi la leur; mais elle fut réduite en cendre dans le grand incendie de 1797, et, depuis cette époque, elle n'a pas été rebâtie '. Les familles protestantes vont au service divin dans la chapelle du consul d'Angleterre. En général, on ne se pique pas en ce pays d'autant de fausse dévotion et de bigotterie qu'à Constantinople.
Il n'y a point d'évêque catholique dans cette ville : un religieux, supérieur des Soccolans, en remplit les fonctions, sous le titre de vicaire apostolique et de révérendissime.
On trouve à Smyrne plusieurs auberges et un grand nombre de boutiques, bien fournies de tous les objets à l'usage des Francs; mais les denrées, même de première nécessité, y sont, depuis quelques années, à des prix exorbitants : on peut s'en faire une idée par le loyer d'une maison ordinaire, qui s'élève depuis trois jusqu'à six mille piastres (2,800 fr.-5,600 fr.)
La France, l'Angleterre et la Hollande ont chacune un hôpital pour les pestiférés.
Depuis la funeste catastrophe de 1797 [Note : En I797, tout le quartier franc de Smyrne fut incendié et mis au pillage par les Turcs, à la suite du meurtre d'un musulman par un Esclavon, sujet vénitien.], les habitants n'ont pas cru [369] prudent de relever leur petite salle de spectacle, qui leur a attiré plusieurs avanies.
Le Turc de Smyrne, quoique fanatique et toujours disposé à la révolte, s'accoutume cependant à respecter la personne et les propriétés de l'Européen. Il est rare, surtout la nuit, de rencontrer des musulmans dans le quartier franc, qui est éclairé par des réverbères, et dans lequel la police du pays ne peut s'exercer qu'extérieurement.
Les Grecs y jouissent d'une liberté presque illimitée ; on les reconnaît partout à l'insolence de leur démarche et à leur bruyante gaieté : ils ont, comme les Arméniens, leur archevêque métropolitain, et plusieurs belles églises, où les Turcs leur permettent d'exercer en paix leurs cultes respectifs.
La place de Smyrne, entrepôt du commerce de presque toute l'Asie et de celui que l'Europe fait avec la Turquie, est, pour nos négociants, l'échelle la plus importante du Levant. La France en exporte des soies écrues, des poils de chèvre d'Angora, du cuivre de Tocat [Tokat], et une quantité considérable de cotons et de laines de très bonne qualité ; elle y importe en échange des draps du Languedoc, des toileries, et toutes sortes de denrées de son territoire et de ses manufactures. Ce commerce, longtemps languissant, ne tardera pas à reprendre son ancienne activité ; quelques années de paix suffiront pour lui rendre toute sa splendeur.
On voit aux environs de Smyrne les villages de Bournaba [Bornova], Sewdi-Keui [Seydiköy], Boudja [Buca] et Coucloudja, où les Francs ont des maisons de campagne char mantes. A moitié chemin du premier, et à peu de distance des bords du Mélès, on trouve une fontaine qui a conservé parmi les Grecs le nom de Bains de Diane. Deux lieues au-delà de ce bourg, ou plutôt de cette petite ville, les curieux vont visiter ce qu'on appelle les Grottes d'Homère. L'auteur d'Anacharsis ne parle que d'une seule. Selon son témoignage, elle était sacrée pour les anciens habitants de Smyrne, qui prétendaient qu'Homère y avait composé ses ouvrages.
Un quart de lieue plus loin, dans un des sites les plus pittoresques, on remarque un énorme rocher qui a la forme d'un cône tronqué, et qu'on a cru depuis peu reconnaître pour le tombeau d'Homère. Une fosse, creusée à son sommet et dans le roc vif, paraît avoir contenu un sarcophage. On lit sur la pierre les noms de plusieurs célèbres voyageurs.
Le 29 janvier 1812, je me séparai à Smyrne, de mes trois compagnons de voyage, dont l'un devait rester dans cette ville. Les deux autres partirent pour Stancho (l'ancienne Cos, patrie d'Hippocrate), et je m'embarquai seul, de mon côté, sur une sacolève qui allait en Candie. Le lendemain de mon départ, les vents contraires me firent de nouveau relâcher à Scio, où ils me retinrent jusqu'au 14 février.
Scio. — Je descendis, à mou arrivée, dans une mauvaise petite auberge, la seule de tout le pays, et tenue par un Grec. [370] L'île de Scio a environ trente lieues de longueur, du nord nu sud, sur six ou huit dans sa plus grande largeur, de l'est à l'ouest. Sa circonférence est d'au moins quatre-vingts lieues. On y compte quarante-cinq mille habitants, dont quarante mille Grecs; quatre mille Turcs et mille Juifs. Outre la capitale, qui, avec le château, renferme seule plus de vingt mille âmes, il y a dans l'île quarante beaux villages, presque entièrement peuplés de Grecs.
La ville est située au bord de la mer, du côté de l'île, en face de Tchesme. Toutes les maisons, solidement construites en pierres de taille, sont l'ouvrage des Génois, que les Turcs chassèrent de cette île il y a plus d'un siècle. On remarque, sur les portes des principaux palais, les armoiries des familles nobles génoises qui étaient établies à Scio, et dont on trouve encore de nombreux rejetons parmi ses modernes habitants.
Les rues sont étroites comme à Gênes, et sales comme celles de toutes les villes de la Turquie. Elles sont remplies d'une foule de femmes grecques, qui attirent les passants par leurs agaceries et la gaieté souvent trop libre de leurs discours, et dans la seule vue de faire quelque saignée à leur bourse. Les filles les mieux vêtues abordent hardiment les étrangers, et n'ont ni honte ni scrupule de recevoir quelque monnaie, pour prix de leurs propos. Elles acceptent un para ' avec autant d'assurance qu'un mendiant de profession; le plus léger prétexte leur suffit pour entrer en conversation avec les jeunes gens, et'pour leur demander s'ils sont mariés. C'est une question inévitable, à laquelle il faut répondre à tous les coins de rue.
La liberté dont jouissent les femmes à Scio est inconcevable dans un pays sous la domination des Turcs. Elles vont et viennent librement, à toutes les heures du jour, dans les rues, sur les places et les promenades, par bandes de dix ou douze, se tenant par les bras ou par les mains, riant, chantant, et critiquant tout ce qui se rencontre sur leur passage, sans que les musulmans y fassent la plus légère attention.
Elles ont presque toutes la taille peu élégante, le sein et les jambes d'un volume énorme, de vilaines dents, et avec cela beaucoup de coquetterie. Totalement défigurées par la quantité de rouge et de blanc dont elles se fardent le visage, leur costume bizarre, surchargé de dorures et d'ornements de mauvais goût, ajoute encore au peu d'élégance de leur tournure, et au dé faut de grâces de toute leur personne. On ne peut cependant, sans injustice, leur refuser de beaux yeux et beaucoup d'esprit naturel.
Les femmes et les filles des Latins, dont le nombre ne s'élève pas à plus de douze cents individus, sont plus modestes, plus retenues ; et leur évêque, vieillard respectable, les a obligées à porter un costume plus décent, auquel on les reconnaît à la première vue. On trouve, parmi ces dernières, des femmes qui peuvent, en tout pays, passer pour fort jolies.
Scio est l'apanage d'une sultane, qui en nomme le mutésellim ou gouverneur ;
1. Le para est une petite pièce de monnaie turque, qui, aujourd'hui, n'équivaut pas à deux liards de France. Il faut quarante paras pour former une piastre turque.
[372]
et ce dernier trouve souvent, dans les intrigues sans cesse renaissantes des Grecs, mille occasions de leur faire des avanies.
Les Grecs sont, à Scio, en possession de plusieurs belles églises, et nulle part ils n'exercent intérieurement et extérieurement leur culte avec plus de liberté.
A l'apparition d'un vaisseau de la flotte du capitan-pacha, ce fantôme de liberté s'évanouit tout à coup pour faire place à la terreur. L'épouvante est générale; et, pendant toute la durée de leur séjour dans le port de Scio, les galioundjis (soldats de la marine), peu accoutumés à respecter les priviléges des Grecs, se répandent dans la ville et dans les campagnes, où ils signalent toujours leur arrivée par les plus affreux brigandages, et par tous les désordres auxquels se livre d'ordinaire une soldatesque sans frein. L'autorité de leurs chefs serait insuffisante pour empêcher de pareils excès ; et les chrétiens n'ont alors d'autre ressource que de s'enfermer dans leurs maisons, et surtout de cacher leurs femmes à tous les regards. Les inquiétudes disparaissent avec le vaisseau, et la gaieté et la confiance reviennent à mesure qu'il s'éloigne de ces parages.
Lors de notre premier séjour, nous fûmes présentés, mes amis et moi, à l'évêque catholique, M. Timoni, originaire d'une noble famille génoise, vénérable patriarche qui, par sa modestie et sa bienfaisance, est parvenu a s'attirer la considération et le respect des habitants de toutes les sectes. Ce prélat, protégé et pensionné par la France, nous fit un jour l'honneur de nous inviter à dîner; et le plaisir que nous trouvâmes dans son entretien surpassa de beaucoup celui que put procurer, à des voyageurs accoutumés à vivre de privations, l'excellente chère qu'il nous fit faire. En évaluant sa dépense sur l'appétit de ses commensaux ordinaires, nous jugeâmes qu'elle devait être très considérable. Son grand âge et la goutte ne lui permettant plus de sortir que très rarement, il est obligé, depuis quelque temps, d'abandonner la conduite de son église à ses vicaires, qui ont su justifier une aussi honorable confiance.
Outre le clergé attaché à l'église épiscopale, il y a de plus, à Scio, un capucin qui dessert la chapelle du vice-consul de France, deux religieux soccolans, protégés par l'Autriche, et un grand nombre de prêtres séculiers, rayas du Grand Seigneur, qu'on distingue du clergé franc à leurs longs cheveux flottants, et à leur ralpak ou coiffure grecque, qui forme un contraste assez singulier avec leur habit ecclésiastique.
La France et l'Autriche sont les seules puissances qui aient à Scio des vice-consuls nationaux. Celui d'Angleterre est un Grec de Zante, et l'ex-vice-consul de Raguse représente aujourd'hui la Russie, la Suède, le Danemark, et toutes les nations qui veulent bien se servir de lui. [Note : A ce sujet, je ne puis m'empécher de parler d'un personnage du même genre que Je rencontrai chez le consul de France à Smyrne. C'était un Grec de Tinos, qui faisait dans son île le vice-consul pour toutes les nations, excepté pour la France. Il portait un uniforme russe, une cocarde suédoise sur un chapeau rond, des épaulettes autrichiennes, et faisait flotter sur sa maison les pavillons de toutes ces puissances.]
[373]
Il ne faut point oublier de prévenir les voyageurs contre les médecins dont fourmillent la ville et la campagne. Comme dans le reste de l'empire, ce sont de misérables intrigants de toutes les nations, pleins d'effronterie, qui, à la faveur de l'ignorance du peuple et de l'insouciance du gouvernement, exercent leur homicide profession avec une liberté et une audace bien funestes à la pauvre espèce humaine.
Je terminerai cet article par quelques détails sur les productions et le commerce de cette île.
L'île de Scio est en général bien cultivée dans toutes les parties susceptibles de l'être, c'est-à-dire vers les côtes, sur quelques collines qui s'élèvent en amphithéâtre derrière la ville, et dans plusieurs vallées charmantes, arrosées par des ruisseaux nombreux et abondants. Le centre est couvert de montagnes pelées et arides qui ne sont propres à aucune culture. Dans le lointain, elles préviennent d'abord le voyageur d'une manière peu favorable contre cette lie.
Malgré ses mauvaises qualités, le Sciote est industrieux, adroit, et actif dans le commerce. Il entend assez bien le jardinage et la culture des terres. Le Grand Seigneur et les riches propriétaires de Constantinople préfèrent les jardiniers sciotes à tous les autres. On les voit souvent amasser dans la capitale un petit pécule, pour l'emporter un jour dans leur patrie : semblables aux domestiques originaires de Tine et de Syra, qui, après avoir fait quelques épargnes au service des Francs, retournent achever leur vie au milieu de leurs compatriotes, qui les regardent dès lors comme des gens d'importance.
La principale richesse de Scio consiste dans ses orangers et ses citronniers, qui sont à peu près les seuls arbres qu'on y voit : le nombre en est prodigieux. On m'a fait remarquer, dans plusieurs endroits, quelques-uns de ces arbres qui ont plus de cinq cents ans ; leur grosseur égale celle de nos ormeaux. C'est un spectacle charmant que cette multitude de jardins qui couvrent les campagnes et l'intérieur même de la ville. On a souvent, sur le même arbre, des fruits desséchés et durcis, des fruits mûrs ou naissants, et de la fleur d'oranger. Au printemps l'air en est embaumé à plusieurs lieues à la ronde; et j'ai ouï dire que lorsqu'on passe, en temps de calme, entre l'île et le continent, le parfum des orangers se fait sentir jusqu'au milieu du canal. Je ne doute point de la vérité de cette assertion ; mais je ne pus m'en assurer par moi-même, ayant fait ce trajet pendant l'hiver.
Il est difficile de respirer un air plus pur et de vivre sous un climat plus sain. Il n'y fait presque jamais froid ; les vents du canal y tempèrent les chaleurs de l'été, et cette saison y est beaucoup moins brûlante qu'à Smyrne, qui n'est cependant qu'à trente lieues de distance. L'eau y est excellente ; [374] mais je n'ai pas trouvé que ses vins méritassent aujourd'hui la réputation dont ils jouissaient chez les anciens. Parmi ses productions les plus communes, on doit compter le mastic, qui découle du lentisque; les femmes du Levant aiment à mâcher cette gomme aromatique malgré son amertume, et l'on en transporte, tous les ans, une quantité considérable à Constantinople. Les Sciotes sont, dit-on, obligés d'en fournir gratuitement le sérail du Grand Seigneur. On tire aussi de ce mastic une excellente eau-de-vie, qui, mêlée avec de l'eau, procure pendant l'été une boisson aussi agréable au goût que saine et rafraîchissante.
L'île ne produit pas assez de blé pour la consommation de ses habitants; elle retire cette denrée de première nécessité, et plusieurs autres, de l'Asie Mineure et de la capitale. On y fabrique des étoffes d'or et de soie, des ceintures et des turbans, qui sont très recherchés parmi les Grecs.
Avant de quitter Scio, je me proposais d'aller visiter, à une lieue au nord de la ville, une espèce de cirque en marbre, que l'on appelle l'École d'Homère ; mais les vents étant devenus favorables, je renonçai à ce projet, et Il fallut songer à mon départ.
Échelle-neuve [[Kuşadası]. —J'arrivai en vingt-quatre heures de Scio à Échelle-Neuve ( l'ancienne Néapolis), nommée par les Italiens Scala-Nuova, et par les Turcs Kouch-Adasi [Kuşadası] (l'Ile des Oiseaux).
Échelle-Neuve est une ville commerçante, située sur la côte de l'Asie Mineure, en face de l'île de Samos, près des ruines d'Éphèse et celles de Magnésie. On compte d'Échelle-Neuve à Smyrne, par terre, environ quinze lieues, et plus de quarante par mer. Le château où réside l'aga, avec la garnison et tous les musulmans, est bâti au pied d'un roc escarpé, sur lequel se trouvent le quartier des Grecs et celui des Arméniens. La population entière de cette ville ne s'élève pas à plus de douze mille âmes. Le port, ou plutôt la rade, est peu sûre lorsque le vent du nord souffle avec violence; mais les navires y sont à l'abri de tout danger avec les autres vents. On voit dans l'ouest, à l'entrée de cette rade, un vieux château construit sur un îlot couvert d'oiseaux marins ; et c'est à leur passage continuel que la ville doit sans doute le nom qu'elle porte parmi les Turcs.
Échelle-Neuve est, depuis quelques années, l'entrepôt d'une partie du commerce de l'Anatolie. On y réunit beaucoup de blé, de riz et d'orge, que des caravanes apportent sans cesse de l'intérieur, et souvent de plus de quarante journées de distance. On y fait aussi un débit considérable de fruits, de légumes secs, de poutargue, et de plusieurs espèces de comestibles, dont la plus grande partie est enlevée par les Anglais, et transportée à Malte et dans leurs possessions de la Méditerranée. Ce port serait devenu de la plus haute importance pour eux, si la guerre maritime eût encore duré longtemps; et il eût été du plus grand intérêt pour la France d'éclairer les musulmans sur la contrebande énorme que faisaient leurs propres agas avec nos rivaux. Tous les blés et autres denrées, détournés du pays pour passer, assure-t-on, [375] dans les îles de l'Archipel et les ports du Grand Seigneur, ne servaient et ne servent probablement encore qu'à alimenter ceux qui sont sous la domination de l'Angleterre. Funeste effet de la cupidité des gouverneurs turcs, qui en font le monopole, et ne livrent qu'à des prix exorbitants, à leurs administrés, le peu qu'ils veulent bien leur en vendre.
Le 22 février, à la pointe du jour, nous mîmes à la voile de la rade d'Échelle-Neuve. Peu d'heures après, nous allâmes mouiller dans une baie déserte de l'île de Samos, en face du Mont Mycale.
Cette île a environ vingt-deux lieues de circonférence. On y compte aujourd'hui un très petit nombre d'habitants. Elle produit d'excellents vins, ses côtes sont très poissonneuses, et ses montagnes remplies de gibier de toute espèce.
M. Bonfort, agent du consulat général de Smyrne pour Échelle-Neuve et Samos, se distingue, parmi ses collègues, par l'accueil aimable et hospitalier que reçoivent chez lui tous les Européens qui visitent ces parages, mais surtout les Français.
Nous quittâmes Samos le lendemain ; et, favorisés par un bon vent du, nord, nous laissâmes successivement derrière nous les îles de Nacarie, Pathmos, Naxie, et les écueils sans nombre dont cette mer est semée. Un autre danger est à craindre dans cette partie de l'Archipel : ce sont les forbans, dont le repaire principal est l'île de Forni, nommée par les Turcs Fouroun-Adasi. Nous eûmes le bonheur de leur échapper.
Tout nous présageait une prochaine arrivée en Candie, lorsque le vent- d'ouest, qui ne cessait de nous contrarier depuis le commencement de l'hiver, nous força, le soir même, de jeter l'ancre dans le port de Nio, après avoir failli nous briser sur les récifs de la côte, par l'ignorance et la maladresse ordinaires de nos Grecs.
Je me consolais d'autant plus facilement de tous ces contre-temps, qu'ils- me procuraient toujours l'occasion de voir de nouveaux pays ; et la conduite de notre capitaine, à notre arrivée dans celui-ci, ne fit que piquer plus vive ment ma curiosité, à la vue d'une terre que je n'avais pas encore visitée. Plusieurs Turcs candiotes, fanfarons et insolents, selon l'usage, avaient manifesté dans leurs discours des intentions hostiles contre les habitants, et s'étaient armés de fusils et de pistolets avant d'entrer dans la chaloupe. Le capitaine venait de défendre à tout passager de mettre pied à terre avec des armes. Les Candiotes insistèrent, et poussèrent l'audace jusqu'à le menacer lui-même ; mais il fut inébranlable, et sa fermeté acheva ce que sa prudence avait commencé. Les bandits quittèrent tout cet attirail de guerre, et purent alors descendre dans l'île de Nio. Je ne manquai pas de questionner le capitaine sur les raisons qui l'avaient porté à agir ainsi ; et il me répondit que, trois mois auparavant, un Turc candiote, ayant exercé des violences dans ce pays, avait été massacré par les insulaires. Depuis ce désastre, ses compatriotes étaient revenus, au nombre d'environ soixante, avec la résolution de venger [376] sa mort et d'exterminer tous les habitants. Mais ceux-ci les avaient vigoureusement repoussés, et leur avaient fait même essuyer un échec considérable. Pour nos quatre Candiotes, ils s'imaginaient sans doute que rien ne devait leur résister, et ils croyaient leur honneur intéressé à continuer cette trop dangereuse querelle. Sans la sage précaution de notre capitaine, ils eussent infailliblement partagé le sort de ceux qui les avaient précédés.
Nio (l'ancienne Ios) est une petite île de douze lieues de circonférence, à huit lieues nord-ouest de Santorin, et à trente lieues de Candie : elle est stérile et montagneuse.
On n'y voit qu'un bourg de deux cents feux : les insulaires, pour se garantir des descentes et des incursions des forbans, se sont retranchés sur la croupe d'un roc presque inaccessible, au nord-est d'une baie qui, de l'aveu des marins, est le meilleur et le plus sûr mouillage de l'Archipel. Dans le bourg seul on compte quinze églises, toutes desservies par plusieurs papas. Chaque particulier riche ou aisé se fait un devoir et un honneur d'en fonder ou d'en entretenir une à ses frais; mais elles sont toutes petites et de peu d'apparence. La principale, qui n'est guère plus grande ni mieux décorée que les autres, domine tout le village. On m'a assuré qu'il y a plus de cent cinquante de ces chapelles dispersées dans les montagnes et les vallons.
Toutes ces églises ont une ou deux cloches, provenant de Venise ou de la Russie. Un tel privilége n'appartient qu'aux seules îles de l'Archipel, où il n'y a, comme à Nio, ni autorités ni habitants musulmans. A toutes les heures du jour, les échos des montagnes répètent les sons aigus de cette multitude de cloches, dont les papas ne cessent de fatiguer l'air, pour les moindres cérémonies.
L'aspect du pays est triste et peu varié ; l'œil n'embrasse de tous côtés que des montagnes arides, et le bord de la mer n'offre que des ruines, et deux petits magasins bâtis auprès d'une chapelle de forme circulaire. Toute cette partie de l'île présente l'image du plus affreux désert. La crainte des pirates, et l'air méphytique qu'exhalent les marais dont elle est couverte, semblent en avoir pour jamais éloigné les hommes : il faut aller les chercher au milieu des roches escarpées, qui seules assurent leur tranquillité et leur indépendance.
Je me fis conduire au village par un sentier roide, et tracé en ligne droite dans le roc, dont il se détache quelquefois des masses énormes qui roulent avec fracas jusqu'au bord de la mer. J'y arrivai haletant, et pouvant à peine me soutenir. J'admirai plus d'une fois la légèreté et l'aisance avec lesquelles les insulaires, hommes, femmes et enfants, grimpent, chargés des plus pesants fardeaux, jusqu'au sommet de la montagne. Cette agilité leur a fait donner par les Turcs le surnom de taouchân [tavşan], qui signifie un lièvre.
Mon guide me fit entrer dans un noir cabaret, où je trouvai rassemblés autour d'une table vermoulue plusieurs Grecs occupés à boire, à jouer et à chanter. Une vieille femme, que je fus d'abord tenté de prendre pour une [377] tireuse de cartes, accroupie au coin de la cheminée, remuait avec un morceau de bois un café rougeâtre et épais, dont elle vint, d'un air riant, m'offrir dans une tasse de faience, recollée avec de la colle forte. Je la remerciai le plus poliment qu'il me fut possible, en lui faisant comprendre que je désirais trouver quelques oques1 de pain frais, plusieurs douzaines d'œufs, une ou deux poules, et un peu de vin. Vous aurez bien de la peine à trouver tout cela ici, me répondit-elle sèchement, piquée sans doute de ce que j'avais refusé son dégoûtant café. J'allais faire briller quelques petits sequins pour me la rendre plus favorable, lorsqu'un des archontes du lieu, vêtu à la turque et coiffé d'un vieux kalpak, m'invita, d'un ton aussi cérémonieux que grave, à prendre la peine de le suivre dans sa maison, où il se faisait fort de me procurer tout ce dont j'aurais besoin. Je suivis à l'instant ce noble personnage, qu'on nommait, s'il m'en souvient bien, le signor Spiridion ; et j'acceptai ses offres obligeantes avec d'autant plus de plaisir, que la foule des curieux, attirés par l'arrivée d'un Franc, commençait à me donner de l'humeur.
L'archonte, à notre arrivée chez lui, me fit d'abord servir des œufs, un morceau de pain d'orge et un reste de fromage, que je dévorai avec une avidité dont il ne parut pas peu surpris. Il expédia ensuite dans le village un de ses fils, qui ne tarda pas à reparaître avec les provisions demandées. Je les lui payai bien au delà de leur valeur, sans en excepter le déjeuner, persuadé que le meilleur moyen de lui témoigner toute ma reconnaissance était de ne point marchander; et le signor Spiridion, qui ne voulait pas être en reste de politesse avec un étranger, poussa l'attention jusqu'à ordonner à son fils de m'accompagner, et de porter mes provisions à bord.
J'étais à peine rentré dans ma chambre, qu'une barque, montée par deux jeunes archontes de l'île, en bas jaunes et en bonnets de coton blanc, et par un homme habillé à l'européenne, vint aborder la sacolève. Après les premiers compliments, l'Européen, que j'appris bientôt être un capitaine de Raguse, marié et établi dans le pays, m'annonça en italien que les deux jeunes gentiluomini que je voyais étaient fils du primat ou chef de l'île, et envoyés par leur père, qui m'invitait à accepter un logement dans sa maison, jusqu'à ce que le temps me permît de remettre à la voile; ajoutant qu'il était bien fâché de n'avoir pas été plus tôt informé de mon arrivée, parce qu'il m'aurait évité la peine de retourner à bord, et surtout celle de remonter au village par un aussi mauvais chemin. Comme cette dernière difficulté était effectivement celle qui me retenait le plus, je fis tout mon possible pour me dispenser d'accepter la politesse du primat; mais je ne pus longtemps résister aux instances de ses fils, et, abandonnant de nouveau mon bâtiment, je me déterminai à grimper une seconde fois au sommet de la montagne.
1. L’oque est un poids de Turquie, qui équivaut à peu près à deux livres et demie.
Je n'eus pas lieu de me repentir de ma peine; le primat et sa femme me reçurent avec beaucoup de cordialité ; et ce bon vieillard m'ayant renouvelé son invitation, je cédai avec plaisir à sa prière et à celle de toute sa famille. Je restai dix-huit jours dans cette maison vraiment patriarcale, et j'y ai trouvé plus d'une fois l'occasion de m'instruire des mœurs et de quelques usages curieux des habitants de cette île. Je vais citer un fait qui, peu important en soi, servira cependant à donner une idée de l'ignorance et de la crédulité de ces insulaires, et à expliquer les succès des charlatans qui parcourent l'Archipel.
Un jour, le fils aîné du primat ayant ressenti une légère incommodité, sa mère, qui me prenait sans doute pour un médecin, vint tout éplorée, dans ma chambre, me prier de l'aider de mes conseils. J'eus beau protester que je n'entendais rien à la médecine, il fallut absolument donner quelque satisfaction à ces honnêtes gens. Comme la fièvre du jeune homme ne provenait que du froid et de la fatigue qu'il avait éprouvés la veille, je pris sur moi d'ordonner qu'on lui donnât une infusion de thé, et qu'on le tînt chaudement dans son lit, afin d'exciter la transpiration.
Cependant la mère avait déjà mandé un papas, qui fit mettre à genoux le jeune homme, et qui lui donna, pendant l'espace de plus d'une heure, à baiser une petite croix de bois et le bas de son étole, tandis qu'il récitait, au-dessus de sa tète, les prières d'usage en pareille circonstance. J'étais d'autant plus surpris de tout cet appareil, qu'en d'autres pays on ne fait venir les ministres de la religion que dans le cas d'un danger éminent ; mais j'appris depuis que les Grecs appellent leurs prêtres dans les plus légères indispositions, qui ne sont pas la moindre partie du casuel des papas.
Le lendemain, mon malade était sur pied ; et je n'eus pas de peine à me persuader qu'une guérison aussi prompte fut attribuée au papas, bien plus encore qu'à mes ordonnances.
Quoi qu'il en fût, la mère de mon hôtesse, femme presque octogénaire, ne tarda pas à venir me consulter à son tour pour son propre compte. Elle avait, disait-elle, toujours froid : rien ne pouvait la réchauffer. « Couvrez-vous mieux pendant la nuit, et faites meilleur feu pendant le jour, lui répondis-je sans hésiter; et cela se passera. » Cette savante réponse acheva ma réputation; et je suis tenté de croire que, depuis bien des années, l'île de Nio n'avait vu de médecin plus habile et surtout plus prudent que moi.
On ne s'étonnera plus alors de la facilité avec laquelle certains intrigants acquièrent en peu de temps de la renommée et de la fortune en Turquie. Une audacieuse assurance réussit mieux en de pareilles contrées que la science elle-même.
On voit à Nio de fort jolies femmes: sans avoir le ton hardi et les manières libres de celles de Scio, elles sont familières avec les étrangers, qu'elles attendent au passage pour leur offrir des bas et des bonnets de coton, seuls produits de l'industrie du pays. Leur costume, qui est simple et agréable, ressemble, sous quelques rapports, à celui des paysannes de l'Italie.
[378]
Les hommes sont presque tous pêcheurs ou marins, et ils passent pour fripons et voleurs. Le peu de relations que j'ai eues avec eux ne m'a pas mis à même de remarquer s'ils étaient adonnés à ces deux vices. Ce que je puis affirmer, c'est qu'ils sont portés à une gaieté bruyante et grossière, et que l'ivrognerie est leur goût favori. J'ai été témoin, pendant leur carnaval, de plusieurs mascarades aussi ridicules qu'obscènes ; elles ne laissaient pas ce pendant que d'attirer une foule de femmes, de filles, et même de papas, que cet ignoble spectacle paraissait beaucoup divertir, quoique des masques sales et hideux se permissent publiquement les plus grandes libertés avec la première femme qui se rencontrait sur leur passage.
Le pays produit un peu de blé, qui ne suffit point à la consommation des habitants, bien que le plus grand nombre ne se nourrisse que de pain d'orge ; des figues, du miel, d'assez bon vin en petite quantité, quelques olives de qualité médiocre, très peu d'oranges et de citrons.
On remarque, hors du bourg, plusieurs moulins à vent qui appartiennent aux plus riches particuliers.
La veille de mon départ, je fus témoin d'une cérémonie religieuse dans laquelle on retrouve quelques traces des usages des anciens Grecs.
Mon hôte venait de perdre sa fille aînée, qu'il paraissait vivement regret ter. Suivant la coutume des Grecs modernes, il avait laissé croître sa barbe, jusqu'au quarantième jour fixé pour la cérémonie dont je vais parler, et qui devait se renouveler tous les ans.
Une vingtaine de femmes, parées de leurs plus beaux habits, se rendirent à la maison du primat. Chacune d'elles portait un grand plat rempli de blé et de riz bouillis, de raisins secs et de fleurs ; d'autres les suivaient avec des gâteaux, des flacons de vin, et des cierges. Tous les plats, ayant été déposés sur une table décorée en forme d'autel, furent immédiatement recouverts des bracelets, des colliers et des principaux ornements de la défunte ; et l'on commença à se lamenter et à sangloter, jusqu'à l'arrivée de deux papas revêtus de leurs étoles, qui firent transporter le tout à l'église. Je suivis la foule, qui croissait à chaque pas. A notre entrée dans le temple, les plats, les gâteaux et les flacons de vin furent rangés symétriquement sur un tapis en face de l'autel; et les prêtres entonnèrent les vêpres, qui furent suivies des prières ordinaires pour les morts. Les parents et les amis jetèrent ensuite- quelques Heurs sur la tombe de celle qu'ils pleuraient, s'arrachèrent les cheveux, et l'appelèrent plusieurs fois par son nom. Le tout se termina par la distribution du collyva (1), aux papas et aux plus pauvres des assistants. Il est inutile de dire que les parents ne négligèrent point, avant ce partage, de reprendre et d'emporter chez eux les bracelets et les ornements de leur fille.
Deux fois nous sortîmes du port de Nio, et deux fois les vents contraires nous forcèrent d'y rentrer. Le vent du nord-est, qui s'éleva dans la nuit du 10 au 11 mars, nous permit enfin de lever l'ancre et de quitter cette île, après y avoir séjourné trois semaines.
1. C'est ainsi qu'on appelle le riz et le blé, mêlés de raisins secs et de fleurs, contenus dans les plats dont J'ai parlé.
[380]
J'y laissai la sacolève sur laquelle j'étais venu de Smyrne, parce qu'elle était destinée pour le port de Candie; et je m'embarquai sur une bombarde grecque d'Échelle-Neuve, qui allait directement à la Canée.
Nous laissâmes à l'ouest l'île de Sikino, dont les habitants sont, dit-on, adonnés à la piraterie, et à l'est celle de Santorin, connue par ses excellents vins blancs; nous vîmes, à peu de distance de cette dernière, l'île Brûlée, rocher aride nommé en grec Kaiméni.
Pendant la nuit, un vieux Grec de Retimo, qui retournait dans sa patrie, mourut d'hydropisie dans la chambre du bâtiment. On trouva sur lui une assez forte somme d'argent, qui fut, en présence de tous les passagers, mise sous le scellé par le capitaine, pour être ensuite déposée entre les mains de sa famille. Ses compatriotes, après l'avoir étendu sur le pont du navire, vinrent tour à tour le baiser sur le front, et le jetèrent ensuite à la mer, sans autre cérémonie, quoique nous fussions en calme, et à deux portées de fusil au plus de l'île de Sikino, où ils eussent pu facilement le transporter avec la chaloupe, et lui rendre les derniers devoirs.
Le 12 mars, à la pointe du jour, nous découvrîmes la terre de Candie, et les caps Mélek à l'est, et Spada à l'ouest; à onze heures, nous entrâmes dans le golfe de la Canée, et nous jetâmes enfin l'ancre dans ce port à deux heures après midi.
Ile de Candie. [Crète]
La Canée. — La Canée est située sur les lieux où quelques voyageurs prétendent que se trouvait la ville de Cydonie, une des plus puissantes de la Crète. Savary assure qu'elle se prolongeait une demi-lieue au delà, du côté de Saint Odero, où l'on voit sur le bord de la mer des restes d'anciennes murailles, construites avec beaucoup de solidité. Il fonde son opinion sur le témoignage de Strabon, qui la place au bord de la mer, du côté qui regarde la Laconie; témoignage qui s'accorde avec celui de Diodore, et qu'on est d'autant plus disposé à adopter, qu'aucune autre trace d'antiquités ne se trouve à plusieurs lieues à la ronde. La ville actuelle, bâtie par les Vénitiens, est éloignée de la rade de la Sude d'une heure de marche par terre, et de plus de six lieues par mer. On a peine à concevoir comment les Vénitiens, au lieu de s'établir à la Sude, rade belle, sûre et commode, ont préféré fonder leur ville dans l'emplacement où se trouve la Canée, dont le port est étroit, peu profond, et dangereux pendant les gros vents du nord de l'hi ver et des deux équinoxes.
La Canée n'a d'autres faubourgs qu'une petite rue de deux cents pas de longueur, qu'on trouve en sortant de la ville. Elle n'a qu'une seule porte du côté du sud-est, confiée à la garde d'un orta de janissaires, et qui se ferme exactement tous les soirs au coucher du soleil, et ne s'ouvre qu'à son lever. Une demi- lune, destinée à la couvrir, tombe aujourd'hui en ruines, [380] et ne sert plus que de clôture aux cimetières des Turcs. La forme de la forteresse est celle d'un fer à cheval, dont le port représente le vide. Ses murailles, solidement construites en belles pierres de roches, avec de larges fossés, sont encore en bon état, et peuvent avoir un mille et demi de circuit. La partie qui regarde la mer est défendue, à gauche, par un fort muni d'artillerie de gros calibre, et à droite par un long mur qui enferme le port, et qui est assis sur des rochers à fleur d'eau, et flanqué de deux tours, sur l'une desquelles s'élève un fanal.
Le port, dans son état actuel, peut à peine contenir une quarantaine de gros navires marchands. Chaque jour il se comble de plus en plus; et dans peu d'années, si les Turcs ne se décident à le faire curer, il ne pourra plus recevoir que des barques. Il est exposé à toute la fureur du vent du nord, qui élève les flots à une hauteur prodigieuse, et jusque par-dessus le fanal et le mur de clôture. Le seul abri qui pourrait alors s'offrir aux vaisseaux, la darse de l'arsenal, presque aussi vaste elle seule que le port lui-même, est tellement comblée, que les plus petits navires peuvent à peine mouiller à son entrée : le reste n'a que la profondeur nécessaire pour recevoir de simples bateaux. On peut juger de l'insouciance du gouvernement turc par le trait suivant. Depuis le mois de décembre 1806, époque à laquelle la Porte Ottomane déclara la guerre à la Russie, on retint à la Canée deux navires de cette nation ; on les laissa échouer et pourrir dans le port, et leurs débris obstruent encore aujourd'hui l'entrée de la darse de l'arsenal, sans qu'il soit question de les enlever, sous le prétexte qu'on n'a pas reçu d'ordres du Grand Seigneur.
Derrière les ruines des beaux arsenaux où les Vénitiens construisaient et remisaient leurs galères, on remarque le château, ou sérail du pacha, autrefois habité par le provéditeur de la république. C'est un misérable édifice qui s'écroule de toutes parts, et que les Turcs ont, suivant leur usage, défiguré par quelques kiosques de bois suspendus sur la tête des passants, qu'ils semblent incessamment menacer de leur chute.
Au-dessous du principal de ces kiosques, où le pacha vient ordinairement prendre l'air, et d'où la vue embrasse toute l'étendue du golfe de la Canée, on voit une vieille chapelle convertie en magasin : à en croire les habitants, elle renferme encore des provisions considérables de lentilles qui datent de la prise de la ville par les Turcs, c'est-à-dire de plus de cent soixante ans. Ils prétendent qu'au printemps, ces lentilles, s'échappant par les crevasses du mur, viennent régulièrement germer sur la terre : je laisse aux naturalistes le soin d'expliquer ce phénomène. Je n'ai jamais pu m'assurer de la vérité du fait, puisqu'il n'est permis à qui que ce soit, et surtout aux Francs, de pénétrer dans ce magasin; mais j'avoue que j'ai vu plus d'une fois des lentilles germer au pied de ses murailles. Venaient-elles réellement du magasin, ou bien étaient-elles semées à dessein, pour entretenir le peuple dans cette erreur, si c'en est une, c'est ce que je ne puis affirmer.
1. Un habitant de Candie m'a assuré avoir vu, dans les magasins de cette ville, des biscuits de mer portant l'empreinte du lion de Venise, parfaitement durcis et conservés, et qui datent du siège de Candie.
[382]
On s'aperçoit encore aujourd'hui que la ville de la Canée est l'ouvrage d'une nation européenne : ses rues sont larges et bien alignées, et l'on y trouve à chaque pas des restes de belles maisons de pierres, dont les ruines abandon nées attestent la barbarie des conquérants de cette île malheureuse. La façade d'un beau palais, voisin de celui du pacha, dans la grande rue du château, et les anciennes casernes de cavalerie, occupées aujourd'hui par un orta de janissaires, sont les bâtiments les mieux conservés parmi ces tristes débris, aux quels se rattachent de si glorieux souvenirs. La cathédrale, dédiée à saint Marc, patron de la république, et plusieurs autres églises, ont été converties en mosquées. La chapelle de Saint-Roch, sur la place, est devenue une école d'enfants turcs. Enfin, les portes de l'arsenal et celles du port sont encore décorées du lion vénitien, horriblement mutilé par les musulmans.
Au milieu de ces ruines, les Turcs ont soigneusement conservé les magasins souterrains, destinés, en cas de siége, à renfermer les approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants pendant plusieurs mois. Ces magasins ne sont autre chose que des puits creusés dans le roc vif, et revêtus intérieurement et extérieurement d'un ciment dur et de la plus grande solidité, composé de chaux vive, de cailloux, et d'une terre rougeâtre que produisent les environs. Les grains s'y conservent pendant deux ou trois ans, sans se détériorer en aucune manière : avantage que l'on doit peut-être en partie à la sécheresse de l'air dans l'île de Candie.
Je ne répéterai pas ici ce que plusieurs voyageurs, et notamment Savary, ont rapporté sur les événements qui ont fait tomber cette île au pouvoir des Ottomans. On sait qu'en l'an 1645, sous le règne du sultan Ibrahim, une flotte ottomane, sortie du port de Constantinople, et portant soixante mille hommes de débarquement et quatre pachas, parut, en pleine paix, à la vue de la Canée. Je me contenterai de citer à ce sujet deux particularités, dont la tradition, vraie ou fausse, s'est conservée parmi ceux de ses habitants qui descendent des Vénitiens, et que je tiens de l'un d'eux, aujourd'hui vice-consul d'Autriche a la Canée.
Plusieurs embarcations, détachées de la flotte, s'étant présentées à l'entrée du port, l'officier qui les commandait demanda à parler au gouverneur vénitien, pour le rassurer sur le but de cette expédition, qui, disait-il, était destinée à attaquer Malte, et pour lui demander un asile en faveur de quelques malades, qui furent admis sans défiance. On ne tarda pas cependant à s'apercevoir que ces prétendus malades n'étaient que des espions, qui, une fois assurés de l'état des lieux, trouvèrent bientôt le moyen de rejoindre la flotte. Leur évasion fut immédiatement suivie du débarquement des Turcs sur la côte nord-ouest de l'île, à trois lieues de la Canée, et du siége de la place, qui dura cinquante jours.
Les Vénitiens, qui se reposaient sur la foi des traités, surpris d'une attaque [383] aussi imprévue, opposèrent longtemps la bravoure à la force; mais obligés enfin décéder à la supériorité du nombre, et privés de munitions, ils demandèrent à capituler, et sortirent avec tous les honneurs de la guerre, après avoir fait éprouver des pertes immenses aux assiégeants. Ou ajoute que la perfidie des Grecs, et leur haine implacable coutre les Vénitiens et la religion romaine, ne contribuèrent que trop à la reddition de cette forteresse importante; mais si cette circonstance, est vraie, ils en ont été bien punis : leurs trahisons ne leur ont rapporté partout que la honte, l'avilissement et l'es clavage.
Trois ans après la prise de la Canée, commença le célebre siége de Candie, qui dura trente ans, et dont la conquête coûta aux Turcs autant d'hommes et de trésors que celle d'un empire. Cette capitale, réduite à la dernière extrémité, et ne recevant plus de la métropole aucuns secours en troupes ni en argent, se vit forcée de suivre le sort de la Canée et de l'île entière. Les Vénitiens y conservèrent encore, pendant plus de quatre-vingts ans, les forts de la Sude, de Karabouzo et de Spina-Longa, qu'ils abandonnèrent enfin d'eux-mêmes, faute de pouvoir suffire aux dépenses énormes qu'entraînaient ces inutiles possessions. C'est ainsi qu'en Candie, comme dans presque toutes les provinces de la Grèce, les Ottomans n'ont établi leur domination que par la ruse ou la violence.
Le Turc candiote est peu estimé dans les autres parties de l'empire. Cette mauvaise réputation est fondée, chez les musulmans, sur sa négligence à observer certains points du Coran ; et chez les chrétiens, sur sa férocité naturelle, les vexations et la tyrannie insupportables qu'il exerce contre les Grecs.
Cependant, comme à Scio, il s'allie fréquemment avec des femmes chrétiennes. Mais ce qui contribue dans cette dernière île à adoucir le caractère farouche des musulmans produit dans celles-ci un effet tout contraire. Quelle peut en être la raison? Comment deux causes semblables amènent- elles, dans deux pays situés pour ainsi dire sous le même climat, deux résultats si opposés? Il ne faut, ce me semble, en accuser que les dispositions naturellement vicieuses avec lesquelles naissent les Crétois de toutes les religions, dispositions dont ils semblent avoir hérité de leurs ancêtres.
Le mélange des sangs grec et mahométan influe, dans l'île de Candie, d'une manière bien plus sensible que partout ailleurs sur le moral et même sur le physique des Turcs candiotes. Ils réunissent éminemment la fourberie, l'intrigue, le mensonge, et tous les vices innés chez les Grecs, à l'intolérance, au ton de supériorité et d'arrogance des musulmans. Leur physionomie seule les fait reconnaître partout au premier abord ; leur langage et leur accent sont ceux des premiers ; et, pour un étranger qui a vu les vrais Osman- lis de Constantinople et de l'Asie, un Turc candiote ne paraîtra jamais qu'un Grec travesti. Sa gourmandise, et l'usage qu'il fait de certaines viandes et de plusieurs gibiers interdits par la loi de Mahomet, achèvent de le rendre [384] méprisable aux yeux des vrais sectateurs du Coran, qui le regardent comme un mauvais musulman, comme un demi-infidèle, comme un être dégénéré, indigne des grâces du Prophète. On a vu, depuis la guerre d'Egypte, et notamment pendant ces six dernières années, à quels excès peuvent se porter de tels hommes, lorsqu'ils ne reconnaissent plus d'autorité que celle de quelques chefs rebelles, toujours en guerre les uns contre les autres : suites naturelles et nécessaires du régime féodal, qui s'est maintenu jusqu'à nos jours dans l'île de Candie, où tout aga, possesseur du moindre fief, se regarde comme un petit souverain, et travaille sans cesse à augmenter son crédit ou sa puissance aux dépens d'un voisin plus faible ou moins intrigant que lui. Delà l'horrible tyrannie des subalternes, qui, ouvertement appuyés par le maître qui les soudoie, croient pouvoir piller et désoler avec impunité une nation plongée dans le plus vil esclavage, et qui n'a pas même conservé le droit de se défendre contre ses oppresseurs.
Presque tous les Turcs de Candie sont janissaires. La Canée seule en renferme cinq ortas ou régiments, qui ont chacun leur kichla ou caserne, où les chefs seuls résident habituellement. Ces officiers sont un oda-bachi, chef de chambrée ; un ousta, maître cuisinier; deux bach-kalfas, et plusieurs simples kalfas, sous-officiers, distingués des autres janissaires par une ceinture de cuivre d'une forme particulière.
On connaît le pouvoir redoutable de cette milice indisciplinée, qui s'arroge souvent le droit de changer et de déposer à son gré ses faibles souverains. La chute tragique de l'infortuné sultan Sélim III n'a fait qu'augmenter, dans ces dernières années, la terreur de leur nom. Tant qu'existera ce corps, aujourd'hui l'effroi de son pays et la risée des troupes européennes, jamais le prince ne sera tranquillement assis sur son trône. Les janissaires causeront un jour la ruine de l'empire, comme ils en ont jadis fondé la puissance. Leur régime et leurs priviléges sont, en Candie, les mêmes que partout ailleurs.
Le janissaire-aga (iénitcher-agasi), ou commandant de janissaires, est un officier que la Porte envoie de Constantinople, et renouvelle tous les ans dans chaque ville. On peut dire qu'il n'a qu'une ombre d'autorité sur cette soldatesque insolente, sans discipline, qui n'obéit qu'à sa propre volonté. Le janissaire-aga est, à la Canée, comme dans toutes les autres places, chargé de la police de la ville, et prélève à son profit un droit sur tous les comestibles qu'on y fait entrer par terre, sans compter les avanies qu'il ne manque jamais de faire aux Grecs. Le janissaire effendi (jénitcher-efendissi), intendant du corps des janissaires, les oda-bachi, et les ousta de chaque orta, viennent immédiatement après lui. Ces derniers ne peuvent se marier, ni découcher hors de leurs kichla, qui ne sont que des lieux de rendez-vous pour les individus d'un même corps; car les janissaires exercent ordinairement une profession ou un métier, et habitent leurs propres maisons avec leurs familles.
[385]
Les kichla jouissent du droit d'asile; c'est-à-dire qu'un voleur, un assassin, un homme condamné au dernier supplice, lorsqu'il parvient à se réfugier dans le dépôt des marmites sacrées du régiment, ne peut en être enlevé que du consentement des chefs de la caserne; et ceux-ci, pour ne point compromettre ni perdre un privilége aussi révoltant, ont toujours soin de faire évader les criminels qui viennent se jeter dans leurs bras.
Aucun janissaire ne peut être puni ni emprisonné pour un délit ordinaire, que dans l'intérieur de son kichla. Lorsqu'un yoldach (frère d'armes) (1) a mérité la bastonnade, tous les janissaires du régiment sont invités à se rendre, vers le soir, coiffés de leurs bonnets de cérémonie, dans la salle du conseil du quartier. Là, le coupable est dépouillé d'une partie de ses vêtements ; et l'un des kalfa, détachant sa lourde ceinture de cuivre, en applique sur les épaules du patient un certain nombre de coups, suivant la gravité du casj Après cette correction fraternelle, il est remis de suite en liberté ; à moins que, pour quelque faute majeure, on ne le retienne en prison ou aux fers pendant quelques jours. Il a fallu, depuis deux années, toute la fermeté du gouverneur actuel; Hadji-Turk-Osman-Pacha, et la terreur qu'inspire son nom seul, pour parvenir à détruire une partie des abus, et à soumettre cette milice.
Quand un janissaire a mérité la mort, il est conduit par plusieurs de ses yoldach dans le fort nommé Sou-Koulé, bâti sur les rochers qui ferment le port. Pendant toute la journée son cachot est ouvert à sa famille et à ses amis, qui peuvent le voir et lui apporter à manger, jusqu'au moment de l'exécution, fixée à trois quarts d'heure après le coucher du soleil. La garde le fait alors sortir de sa prison, pour l'amener dans un vestibule où il doit faire sa dernière prière. On l'assied ensuite sur la terre, et on lui passe au tour du cou une corde à nœuds coulants, que deux Grecs ou deux Juifs tirent chacun de leur côté (2). Au moment où le coupable expire, un officier de la garde, placé sur l'esplanade du fort, élève son fanal en forme de signal, et un coup de canon annonce au pacha et à la ville que l'exécution est terminée (3).
Tous les ans, au mois de mars, la Porte envoie à la Canée un scéanédji, officier chargé d'effectuer la paye des janissaires de cette ville ; la cérémonie a heu dans la maison du douanier qui avance les fonds nécessaires. Chaque orta ou régiment s'y fait représenter par ses chefs et par plusieurs députés, ornés de leurs plus riches habits, qui rapportent aux kichlas des sacs d'argent qu'on distribue de suite aux janissaires jouissant de la paye.
1. Littéralement, compagnon de voyage. C'est le nom que se donnent entre eux les janissaires.
2. La mort la plus ignominieuse pour un musulman est d’être étranglé de la main d'un infidèle. Un assassin condamné, il y a quelques années, au dernier supplice, par le pacha de la Canée, crut prévenir cette honte ineffaçable, en se faisant étrangler d'avance par deux Turcs de ses amis.
3. A Constantinople, et dans plusieurs grandes villes de l'empire, le supplice des seuls Janissaires est annoncé par le canon. En Candie, tous les musulmans indistinctement jouis sent de ce singulier privilége.
[386]
Cette paye s'élève depuis trois jusqu'à quinze aspres (1) par jour, et rapporte par conséquent plus d'honneur que de profit. C'est une espèce de droit de présence dont sont prives les hommes absents de leurs corps.
Dans les solennités des deux baïrams, les janissaires de la Canée et de Candie marchent en grande cérémonie, armés d'une simple baguette blanche, recourbée par le haut, et ornée de fleurs et de fils d'or. Ce cortége, qu'ils nomment Alai, parcourt toute la ville et les remparts, précédé de plu sieurs derviches, la hallebarde en main, poussant des hurlements affreux ; et il est suivi d'une fou le d'enfants de janissaires, dont les plus jeunes sont portés sur les épaules de leurs esclaves. Le janissaire-aga, à cheval, ferme la marche, environné des différents chefs de corps, à pied, revêtus de longs et grotesques habits de cuir chargés de plaques et de grelots d'argent.
Une autre milice, qu'on nomme les yerlû, est aussi employée à la garde des forteresses de la Canée, de Candie et de Rétimo. Les yerlu ne sont point janissaires, et ils ont un chef particulier qu'on nomme le yerlû-agasi. Ce corps n'est composé que des Turcs de la dernière classe du peuple, et leur service se réduit à veiller pendant la nuit sur les remparts, en s'avertissant mutuellement par des cris prolongés, à peu près à la manière des sentinelles dans nos places de guerre. Les yerlû n'ont d'ailleurs ni kichla, ni priviléges, comme les janissaires, qui se croient en droit de les mépriser.
Le nombre des charges publiques est très considérable à la Canée, comparativement au peu d'étendue et de population de la ville, qui ne renferme pas plus de douze mille habitants. Tout particulier qui possède une petite fortune veut acheter, à quelque prix que ce soit, un titre qui lui donne entrée dans le conseil du pacha. Il en est de même à Candie et à Rétimo. Avant de faire l'énumération des plus éminentes de ces charges, je vais dire comment est gouvernée l'ile de Candie.
L'île est partagée en trois pachalik ou départements, savoir : celui de Candie, celui de la Canée et celui de Rétimo.
Le gouvernement de Candie est toujours confié à un pacha à trois queues (utch toughlû), sous le titre de vésir-sérasker. On peut le considérer comme le gouverneur-général de toute l'île. L'administration des finances, provenant du kharatchel autres impositions, est entre les mains d'un tefterdar, ou trésorier. Ce dernier est indépendant du sérasker.
Le département de la Canée est gouverné par un vésir, ou pacha à trois queues, qui ne relève que de la Porte. Il ne reçoit aucun ordre du sérasker de Candie ; mais, dans les affaires majeures, il doit seulement en référer à son avis. Quand le pacha de la Canée n'est décoré que de deux queues, il est alors sous les ordres immédiats du gouverneur général : ce cas est extrêmement rare.
1. II faut trois aspres (aktché) pour faire un para. Le para vaut aujourd'hui un peu moins de deux liards de notre monnaie.
[387]
Le département de Rétimo, le moins étendu des trois, est toujours administré par un pacha à deux queues (iki toughlù), qui relève du sérasker. Le pacha actuel de la Canée est le premier qui depuis longtemps ait réuni dans sa personne ces trois gouvernements à la fois.
Chaque pacha a un kiaya-bey ou lieutenant qui le remplace, lorsqu'il vient à s'absenter; hors cette circonstance, ce Maya n'a aucun rang parmi les autorités de la ville.
Voici les titres des principaux officiers civils et militaires de la Canée et des autres villes de l'île de Candie:
Le janissaire-aga (jénitcher-agasi), commandant les janissaires;
Le yerlû-agasi, commandant des yerlû;
Le muphty;
Le cadi;
Le dizdar-aga, commandant de la forteresse;
Les agas particuliers, ou commandants des différents forts, tels que l'aga du sou-koulé, l'aga du fanal, etc.;
Le sipahilar-agasi, commandant des spahis on de la cavalerie, quoique ce corps n'existe pas;
Le toptehi-bachi, commandant de l'artillerie;
Le koumbaradji-bachi, commandant de bombardiers;
Le tersana-émini, intendant de l'arsenal;
Le kharatchi-bachi, percepteur de l'impôt nommé kharatch;
Le bach-tchaouch, chef de la police, sous les ordres du janissaire-aga.
Les autres charges sont de trop peu d'importance pour mériter une mention particulière. Je n'y comprends pas celle du grand-douanier geumruk-émini, ce fonctionnaire n'étant que le fermier d'une sultane, dont les douanes sont l'apanage le plus considérable.
A Candie, le tefterdar (trésorier) a la préséance sur toutes les autres autorités. Il ne cède le pas qu'au seul sérasker.
Candie ou Castro est la capitale du royaume. Cette ville est grande et bien percée; on n'y peut faire un pas sans rencontrer les ruines de beaux édifices, construits par les Vénitiens. Si elle était peuplée en raison de son étendue, elle contiendrait plus de trente mille habitants. Son port est sûr et commode, mais très resserré, et tellement comblé qu'il ne reçoit plus que les bateaux de la côte. Les navires marchands doivent charger et décharger leurs marchandises à Standié (l'ancienne Dia), petite île distante de cinq lieues, où les plus gros vaisseaux de guerre peuvent mouiller en toute sécurité. Les Turcs de Candie sont les plus intraitables de l'île.
Rétimo (Rhitymnia) est la troisième place de la Crète moderne: c'est une ville peu considérable et presque déserte. Comme Candie et la Canée, elle doit son existence aux Vénitiens et sa dégradation aux musulmans. Le [388] port est dans le même état d'abandon que les deux premiers ; cependant, si les Turcs entendaient mieux leurs intérêts, Rétimo serait l'échelle la plus commerçante de l'île. L'huile qu'on retire des oliviers de son territoire est réputée la meilleure de tout le pays.
Des Grecs.
Les peuples de la Grèce étaient parvenus au plus haut degré de gloire que puisse atteindre une nation : tout à coup les armes des Romains les précipitent du faîte des grandeurs ; le germe de la corruption se développe dans leur sein, et la translation de l'empire à Byzance achève bientôt ce pernicieux ouvrage.
Tel était le déplorable état de la Grèce, lorsque les Ottomans firent la conquête de cette terre à jamais célèbre. La valeur et l'amour de la liberté étaient sortis de tous les cœurs, et la plus grossière superstition y passait pour la première des vertus.
On a souvent agité cette question : Le mépris que nous inspirent les Grecs d'aujourd'hui est-il fondé sur la justice? Rendus à l'indépendance, pour raient-ils reconquérir l'estime des nations?
Il est incontestable que leur dépravation fut la seule cause de tous les maux qui les accablent depuis quatre siècles. Mais loin de nous la prévention, loin de nous l'opinion de ces partisans outrés de la tyrannie ottomane, qui veulent que le Grec soit né pour l'esclavage ! Quel peuple donna jamais des preuves plus victorieuses du contraire ? Sous un gouvernement à la fois réparateur et sévère, qui laisserait prendre à leur génie naturel, à cet esprit actif qui les caractérise encore, tout l'élan dont il est susceptible, peut-être retrouverait-on un jour, dans les Grecs, une nation estimable. Délivrés du joug de fer qui pèse sur leurs têtes, affranchis du besoin de ramper devant leurs oppresseurs, des sentiments plus généreux effaceraient peut-être de leurs cœurs avilis tous ces vices honteux, enfants de la servitude ; le fanatisme et l'ignorance fuiraient devant le flambeau de la civilisation, et les sciences et les arts viendraient refleurir dans leur berceau.
Le sceptre du conquérant paraît s'être appesanti plus particulièrement sur les Grecs de l'île de Candie; ils ne sont nulle part plus maltraités ni plus avilis. L'humiliation où ils sont plongés est telle, qu'il leur est interdit de passer à cheval sous les portes des villes. Leurs archevêques et évêques faisaient cependant exception à la règle générale ; mais l'évèque de la Canée, vieillard infirme et goutteux, fut dernièrement dépouillé de cette prérogative, qu'on trouvait attentatoire au respect dû par un infidèle aux janissaires et à leurs marmites [Note : On sait que les janissaires ont pour leurs marmites le même respect que nos soldats pour leurs drapeaux].
[389]
L'autorité du nouveau pacha a été insuffisante pour la lui con server. Le métropolitain de Candie est aujourd'hui le seul qui n'ait pas éprouvé ce nouvel affront (1) ; les autres prélats font conduire leurs chevaux hors des portes, et sortent modestement à pied de la ville.
L'archevêque métropolitain est considéré comme le chef immédiat des Grecs de l'île de Candie, et le pacha-sérasker peut le rendre personnellement responsable de tout délit commis dans son département par des individus de cette nation. Les autres évêques lui doivent obéissance, et sont, dans leurs diocèses respectifs, soumis à la même responsabilité vis-à-vis des deux autres pachas.
Les Grecs forment, dans chaque ville, une communauté régie par un conseil composé de plusieurs notables décorés du titre pompeux d'archontes : l'évêque en est le président né. Le premier des archontes est chargé de la caisse de la communauté. Ces fonds sont destinés à l'entretien du culte et de ses ministres, au salaire du maître d'école, au service de l'hôpital, et souvent à satisfaire aux grosses avanies que font, au moindre prétexte, les pachas et leurs subdélégués : avanies occasionnées, la plupart du temps, par leurs intrigues et leurs tracasseries perpétuelles ; entretenues par d'avides tyrans ha biles à les faire tourner à leur profit. L'arrivée d'un nouveau pacha devient un surcroît de dépense pour la communauté. Obligée de le meubler à neuf, de l'habiller et de le nourrir avec toute sa suite pendant les huit premiers jours, elle lui doit encore, à titre d'hommage, un présent considérable en argent : trop heureuse si son altesse daigne l'agréer avec bonté, si elle veut bien s'en contenter, et ne pas demander quelque forte somme en sus, à titre d'emprunt! On s'exposerait beaucoup si on lui refusait ce léger service, ou même si on le lui rendait de mauvaise grâce.
La nation a son drogman, ou grammaticos, qui est son intermédiaire dans toutes ses affaires, bonnes ou mauvaises, avec le pacha. Ce grammaticos est un personnage qui porte un kalpak blanc et des papoutches jaunes : c'est le plus distingué des archontes, un illustrissime, bien orgueilleux avec ses compatriotes, bien vil avec le dernier des musulmans, et qui finit très souvent par être la victime de sa sotte ambition et de sa ridicule vanité.
Le hasard me fit rencontrer plus d'une fois le grammaticos de la Canée dans les premières maisons grecques de cette ville. Aux égards qu'on avait pour lui, à l'air de grandeur et d'importance dont il recevait tous les hommages, on l'eût pris d'abord pour un satrape, ou du moins pour le plus puis sant des protecteurs. Ce même personnage, devant un Turc, devenait pour tant le plus rampant des hommes ; on ne trouvait plus en lui qu'un gram maticos.
Dans toutes les provinces ottomanes, l'humiliation des Grecs ne diffère que du plus au moins ; les causes en sont partout les mêmes.
1. Les Consuls et les Francs ne sont point assujettis à cette honteuse formalité. Comme les musulmans, ils passent à cheval sous les portes de la ville et devant les marmites des janissaires.
[390]
Ce sont elles qui amenèrent la chute de leur empire, et qui le maintiendront sans doute longtemps encore dans l'esclavage : je veux parler de cet esprit d'intrigue et de jalousie qui ne cesse de les travailler, et dont l'île de Candie n'est que le moindre théâtre.
Constantinople peut être considérée comme le centre et le foyer de la vanité grecque. Qu'on porte un moment ses regards sur cette caste du Fanal ', restes dégénérés, pour ne pas dire douteux, des plus illustres familles de l'empire. Nulle part on ne verra un plus monstrueux assemblage d'arrogance, d'avilissement et de bassesse.
Sous ce rapport, Candie offre en raccourci le même tableau que la capitale. Il n'est pas une famille qui ne veuille descendre d'une noble race vénitienne: on y conspire à qui mieux mieux pour nuire à un autre plus riche ou plus considéré que soi; on y machine mille complots pour parvenir à ce qui constitue le comble des honneurs, et quels honneurs ! celui d'être grammaticos, ou de siéger dans la communauté.
L'esprit turbulent et inquiet qui caractérise si éminemment les descendants des Crétois se fait surtout remarquer dans une classe destinée à servir d'exemple à toutes les autres. Cette maladie morale semble avoir attaqué plus particulièrement le clergé: le vicaire prosterné aux pieds de son évêque, le moine qui baise la main de son supérieur, trament au même instant d'horribles trahisons contre leurs chefs. Demain peut-être ils s'élèveront sur les ruines de ceux qu'ils encensent aujourd'hui; mais d'autres, plus fourbes ou plus adroits, les auront bientôt renversés eux-mêmes.
Trop ennemis les uns des autres pour conserver le peu de liberté qui leur reste par l'union et la franchise, trop faibles pour agir par eux-mêmes dans leurs perfides manéges, les Grecs sont obligés de se faire, parmi les Turcs, des patrons dont la protection ne s'achète qu'au poids de l'or. La perte de leur fortune est souvent le fruit de ce honteux moyen, et ceux-ci les abandonnent alors à la vengeance et à toute la fureur de leurs adversaires. Enfin, ce qu'on aura peine à croire, on ne voit pas en Candie un seul raya (2) qui ose exploiter le commerce par lui-même. Le plus petit marchand chrétien, ou juif, a toujours un associé musulman, qui ne place ses fonds dans la société qu'aux plus gros intérêts, et jouit, en raison de son seul patronage, de la moitié de tous les bénéfices, sans entrer dans aucune des pertes. Cependant, sur la côte méridionale de Candie, au delà des Monts-Blancs (3), il existe une nation dont la valeur et l'énergie peuvent être comparées à celles de leurs ancêtres.
1. Le Fanal est un quartier de Constantinople habité par certaines familles grecques, qui se prétendent issues des plus illustres maisons du Bas-Empire. C'est de ce séjour d'intrigues et d'agitations que sortent les drogmans de la Porte , qui deviennent ensuite princes de Valachie et de Moldavie.
2. On appelle rayas tous les sujets non musulmans du Grand Seigneur. Eux seuls, comme nous l'avons dit plus haut, payent le kharatch ou capitation.
3. Les Monts-Blancs, appelés par les anciens Lemi Montes, coupent à l'ouest l'Ile de Crète en deux parties. Ces montagnes, ainsi nommées des neiges qui les couvrent pendant plusieurs mois, séparent le territoire de la Canée de ceux de Candie et de la Sphachie.
[391]
Les Sphachiotes sont les seuls Grecs de la Crète qui, de nos jours, aient su conserver et faire respecter leur indépendance. Retranchés dans des montagnes presque inaccessibles, et couvertes huit mois de l'année de neiges épaisses, ils ne souffrent au milieu d'eux aucun mahométan. Ce peuple guerrier, sans méconnaître ouvertement l'autorité du Grand Seigneur, se gouverne par lui-même et n'obéit qu'à son capoudan (capitaine). L'officier du pacha de la Canée, qui vient tous les ans y percevoir le kharatch, doit, avant tout, déposer ses armes aux frontières du territoire de la Sphachie. Là, il est reçu parles chefs de la nation, qui l'accompagnent jusqu'au principal village, où le capoudan lui remet le tribut. Sa mission remplie, on le reconduit jusqu'aux confins avec les mêmes formalités et les mêmes précautions.
Le Sphachiole est actif, industrieux, et passe pour le meilleur marin de l'île de Candie. En aucun lieu de la Grèce, l'amour de la liberté ne s'est mieux conservé dans toute sa pureté. Ce petit coin de terre, presque inconnu au reste de l'empire, renferme peut-être les seuls hommes fiers encore de porter le nom de Grecs.
De l'Ile de Candie.
La peinture de ses habitudes et de ses goûts achèvera peut-être de donner une idée juste et précise d'un peuple qui a perdu jusqu'au souvenir et jusqu'au nom de ses ancêtres. Sans rappeler toutes les brillantes qualités de ces derniers, nous nous bornerons à tracer légèrement le tableau fidèle des vices et des défauts de leurs descendants : un nouveau contraste s'établira de lui-même entre les temps présents et les temps passés.
Chez les Grecs modernes, un père rougirait de donner à sa fille les plus légères marques de son affection ; il croirait avilir la dignité paternelle : jamais, au retour d'un long voyage, on ne le voit la serrer dans ses bras, ni lui sourire, ou lui adresser une parole agréable. Un père est un maître absolu dont on redoute la présence ; et les enfants ne sont que de timides esclaves, plus dis posés à la crainte et à la méfiance qu'au respect et à la piété filiale. La tendresse maternelle, qui seule pourrait les consoler, semble ici exclusive ment réservée pour les jeunes gens : et ceux-ci, trop vite abandonnés à eux-mêmes, et corrompus de bonne heure par le pernicieux exemple de leurs parents, ne cessent de propager dans leurs familles tous ces vices inhérents à l'éducation générale.
Pour la jeune fille, employée aux plus viles fonctions du ménage, assujettie à préparer la pipe de son père et de ses amis, nonchalamment étendus sur un sofa, on ne lui saura pas même gré d'une complaisance que n'aurait pas ailleurs le dernier des valets.
1. A l'époque où Constantin transporta le siége de son empire à Byzance, les Grecs prirent le nom de Romains ou Romaioi ; et dans tout l'Orient ils ne sont plus connus aujourd'hui que sous celle dénomination. Les Turcs ont depuis corrompu ce mot, et en ont fait celui de Roum ou Ouroum. Ils appellent encore Roum-Ili (Romélie), ou pays romain, une partie de l'ancienne Thrace ni tout le territoire de Byzance.
[392]
Dégradés à ce point inconcevable dans leur jeune âge, les enfants se dédommagent bientôt de leur dépendance passée quand ils se marient, ou que les années leur permettent de devenir maîtres de leurs actions. Leurs parents ne doivent plus alors en attendre ni respects ni égards : un ton brus que et hautain remplace la soumission et la contrainte; et l'orgueilleuse supériorité qu'ils s'arrogent sur les auteurs de leurs jours en impose souvent à ceux-ci, lorsque la vieillesse ou le malheur les obligent de réclamer les secours de ces êtres dénaturés.
La musique et le dessin, ces deux arts agréables, devenus par l'usage un des points essentiels de l'éducation des dames européennes, sont encore étrangers à celles de l'île de Candie. Quelques-unes apprennent à lire, à écrire et à broder ; toute la science des autres se borne à savoir tricoter, pétrir et faire la pâtisserie : encore les connaissances des premières ne sont-elles, à vrai dire, que pour la forme : car aussitôt qu'une fille a atteint sa quinzième année, c'est-à-dire lorsqu'on la suppose suffisamment instruite, ja mais on ne reverra dans ses mains un livre, et encore moins une plume. Les Grecs ont cependant de bonnes traductions des meilleurs ouvrages français, italiens et allemands; mais elles ne sont connues que d'un petit nombre d'hommes qui cultivent les belles-lettres. Peu de femmes sont à portée de les entendre, et leur indolence naturelle ne leur permet guère de chercher à s'instruire : cette île est d'ailleurs peu fréquentée des Européens ; et les dames grecques y vivant dans une retraite égale à celle des musulmanes (1), il leur est difficile de se faire une idée de ce qui se passe hors de leur intérieur, et par conséquent de trouver quelque intérêt à des lectures qui demanderaient une éducation préliminaire, et des connaissances qu'il n'est pas en leur pouvoir d'acquérir.
Le défaut d'imprimerie et la rareté des livres se joignent à tous ces inconvénients pour arrêter en Candie le progrès des lumières et de l'instruction. Des papas, aussi ignorants que superstitieux, sont les seuls précepteurs de la jeunesse; et les livres classiques se réduisent à l'Ancien et au Nouveau Testament. Peu de Grecs sont familiarisés avec la langue d'Homère : la plu part sont hors d'état de comprendre ce qu'ils lisent, ou de rendre compte de ce qu'ils ont lu. J'ai vu, entre les mains d'un logiotatos, une traduction de notre Télémaque, dont il récitait à tout venant plusieurs passages du ton le plus pédantesque et le plus emphatique. Malgré sa réputation colossale d'érudition, ce logiotatos n'avait pourtant aucune connaissance ni de la mythologie ni de l'histoire :
1. Je ne parle ici que des femmes grecques de l'ile de Candie; celles de Constantinople et de Smyrne jouissent aujourd'hui d'une liberté presque aussi grande que les dames franques.
il ignorait jusqu'aux noms des dieux et des anciens héros de sa patrie. En aucun pays du Levant, les filles grecques ne sont soumises à une [393] réclusion plus rigoureuse que dans l'île de Candie : jamais on ne les voit, durant le jour, hors de la maison de leurs parents; elles ne font de visites que le soir, accompagnées de leurs mères et de leurs servantes : encore ces visites, fort rares, ne sont-elles d'obligation qu'entre parentes et amies intimes ; alors toute la famille doit marcher, père, mère, enfants et valets. Rien de plus solennel, à la Canée, qu'une visite de cérémonie. Hors cette circonstance et les deux dernières nuits de la semaine sainte, une fille ne peut sortir, même pour aller à l'église. Je n'ai pu savoir la raison d'un pareil usage.
Les fiançailles d'une jeune Crétoise viennent encore ajouter à la gêne et à la contrainte où elle a vécu depuis son enfance : cette époque lui impose de nouvelles chaînes, et lui interdit désormais tout commerce avec la société. Séquestrée du monde entier, elle ne paraît plus devant les hommes, pas même devant les amis de son père : on craindrait d'éveiller la jalousie du futur époux, qui, de son côté, ne la voit plus que rarement, et comme à la dérobée.
Les fiançailles se font avec beaucoup d'appareil et de solennité, et toujours par le ministère d'un papas. Les deux accordés font l'échange de deux bagues semblables à l'anneau nuptial. Quoique cette formalité n'impose pas les mêmes obligations que l'union conjugale, il est cependant très rare de voir deux fiancés renoncer à leurs premiers engagements, le mariage ne dût-il avoir lieu que plus de vingt ans après, comme cela arrive quelque fois.
Les mariages sont ordinairement célébrés après les fêtes de Pâques. Dans les familles de haut parage, la cérémonie ne se fait point à l'église : un prêtre vient unir chez eux les deux époux, et il est d'usage de l'inviter au repas de noces. La fête ne serait point complète si l'on n'était obligé de faire em porter le soir la plupart des convives sur les épaules de leurs valets.
En fait de mariage, l'inclination des jeunes gens est moins consultée chez les Grecs qu'en aucun lieu du monde. Les alliances s'arrangent souvent entre les familles, à la naissance même des enfants. L'intérêt et les convenances en sont les bases principales.
L'amour trouve cependant ici, comme dans nos heureuses contrées, plus d'un moyen de forcer des barrières en apparence impénétrables.
Malgré la sévère vigilance d'une mère ou d'une aïeule, en dépit de la bigotterie, et d'une foule d'espions domestiques toujours prêts à mal interpréter ses moindres démarches, une jeune Candiote sait, pour tromper le regard de ses argus, trouver mille ressources innocentes, inconnues et inutiles dans les pays où le beau sexe jouit de toute sa liberté. Les amants sont convenus entre eux d'un langage hiéroglyphique, à l'aide duquel on parvient, dit-on, le plus facilement du monde, à nouer et à filer une intrigue, sans que l'œil le plus clairvoyant y distingue autre chose que des objets purement matériels. Par exemple, un petit morceau de drap rouge signifie, mon cœur brûle d'amour pour vous; un clou de girofle, ma passion n'a pas d'égale;
[394]
une pistache, je voudrais avoir la tête sur votre oreiller. Je ne parle pas du langage des fleurs, qui demanderait seul un vocabulaire particulier.
Pendant le carnaval, les filles non fiancées jouissent d'un peu plus de liberté; et cet heureux temps, trop court pour les amants, leur fournit plus d'une occasion de se répéter et de mettre à exécution ce qu'ils n'ont pu jus que-là se faire entendre que par symbole. Le tumulte d'un bal aide merveilleusement à toutes ces petites intrigues.
Au milieu d'un nuage épais de fumée de tabac, aux sons aigres et discors d'une lyre grossière, commence le chôros, espèce de danse qui con serve encore, dans sa monotonie, de la ressemblance avec celle des anciens Grecs.
Les danseurs forment une longue chaîne, dirigée par le plus habile de la compagnie. Tous partent du même pied, en cadence, le dos rentré, le ventre tendu, et la tête penchée sur l'épaule, sans perdre de vue les mouvements du chef de la bande. Celui-ci présente alternativement à sa danseuse les deux bouts d'un mouchoir brodé, et accompagne quelquefois ce geste de contorsions ridicules et de passes à l'allemande. Ces figures sont toujours les mêmes, et ne varient que par le plus ou le moins d'agitation que se donnent les danseurs, soit en avant, soit en arrière, souvent à la même place, et par des pauses qu'annonce la musique. Le jeune galant, ivre de vin et d'amour, serre enfin dans sa main celle de sa jeune maîtresse, dont les langoureux regards semblent provoquer maintes petites libertés, que favorise encore l'effroyable tintamare de cent voix qui chantent toutes sur le même ton. Le carême vient-il? adieu les ris, adieu les amours ! le plaisir fuit pour une année : il faut de nouveau recourir au langage hiéroglyphique.
Le carnaval a d'autres attraits pour ceux qui ne sont ni de tempérament ni d'âge à faire l'amour. C'est alors que le Grec, ennemi de toute modération, s'abandonne à cette gaieté bruyante et à tous les excès qui constituent à ses yeux le véritable bonheur : les tables sont chargées de viandes, le vin coule à grands flots, et l'air retentit de ses chants d'allégresse.
Un mot sur la cuisine des Grecs ne sera peut-être pas déplacé à l'article du carnaval.
L'art de satisfaire la gourmandise humaine est encore loin, chez ce peuple, de la perfection où l'ont porté dans ce siècle les cuisiniers français : on chercherait eu vain sur leurs tables ces mets délicats, fruits des veilles et des méditations de nos gourmets. Qu'il n'aborde jamais ce rivage, celui dont le palais sensuel veut être flatté chaque jour par de nouvelles combinaisons gastronomiques! qu'il sache que les Grecs mangent encore aujourd'hui ce que mangeaient leurs pères, il y a plus de quatre cents ans.
Un pilaw (2), un iakni, ou un kapama, espèce de daube mêlée d'herbes amères, et qui saisit d'abord l'odorat par l'ail dont elle est assaisonnée; un mousaka ou hachis de viande et d'oignons pilés, aussi indigeste que détestable au goût ;
1. La lyre des Grecs modernes n'a aucune ressemblance avec l'instrument du même nom en usage chez les anciens : elle n'a que trois cordes, et sa forme est celle d'une mandoline de la plus petite dimension. Les Grecs jouent de cet instrument avec un archet.
2. Riz à peine crevé, et assaisonné avec un peu de beurre.
[395] du poisson bouilli ou grillé, dès escargots, du caviar (1) et des anchois ; et, dans les fêtes solennelles, quelque grosse volaille ou une épaule de mouton cuite au four : voilà les meilleurs plats de ces modernes épicuriens , qui estiment en général beaucoup plus la quantité que la qualité. Mais rien n'est comparable à leur pâtisserie, à cette branche importante de la gastronomie. Il faut avoir touché cet heureux sol, pour se faire une idée des beureks aux épinards ou aux oignons, des kalizounias au fromage, des baklavas (2) au miel et à la mantéga, beurre fort, mêlé de graisse de mouton fondue : de telles friandises sont au-dessus: de l'imagination. Malheureusement, il n'est pas permis à tout le monde de s'en rassasier avec impunité. L'estomac d'un Crétois peut seul se flatter d'une heureuse digestion, après un semblable festin de carnaval.
Les Grecs ne sont pas plus difficiles sur l'article de la boisson que sur celui des mets. Un vin ou une liqueur, quel que soit d'ailleurs leur goût, sont toujours à leurs yeux un vin et une liqueur, et conséquemment toujours bons à boire. Autant il serait honteux et criminel d'enfreindre les lois sacrées du carême, autant il serait ridicule de ne pas s'enivrer au moins une fois par jour dans les fêtes du carnaval. Pendant ce temps de bacchanales, un peuple de valets semble rivaliser d'intempérance avec ses maîtres. C'est une lutte effrayante et continuelle d'ivresse et de gloutonnerie.
Il est d'usage en Candie d'avoir un nombreux domestique; mais ce luxe n'exige pas comme ailleurs une fortune considérable, puisqu'on ne paye pas ses serviteurs. Ce sont tous de malheureux enfants, enlevés dès leur jeune âge de leurs familles et de leurs villages, et qui, sans état, sans ressources, deviennent pour ainsi dire la propriété de maîtres durs et avares, qui les laissent souvent manquer du nécessaire. C'est pitié de voir l'état de misère et d'abjection où sont réduites ces infortunées créatures; et leur triste condition fait souvent gémir sur le sort de la pauvre humanité.
Clergé grec, églises, couvents.
J'ai parlé plus haut de l'archevêque métropolitain de Candie. Ce prélat est le chef suprême de tout le clergé du royaume. Ses principaux suffragants sont l'évéque de Cydonie (la Canée), ceux de Rétimo et de Sélino, petit district situé dans la partie occidentale de l'île. Plusieurs autres, répandus dans les diverses provinces, sont tellement indigents, qu'à peine on les connaît hors de leurs diocèses. Tous leurs revenus se bornent aux aumônes et à la charité des fidèles, trop pauvres eux-mêmes ou trop peu généreux pour leur être d'un grand secours.
1. Le caviar est une pâte noire et compacte, composée d'oeufs d'esturgeons séchés au soleil. Le meilleur caviar vient de la Russie.
2. Pâtisseries turques et grecques, dont la digestion esl aussi difficile que la vue en est peu appétissante.
[396]
Aussi l'existence d'un moine est-elle en Candie bien préférable à celle d'un évêque.
Ces moines ou kaloyers sont en possession de plusieurs beaux monastères et de biens immenses. Des paysans, et des hommes de la dernière classe du peuple, sont généralement les seuls que la misère ou l'amour de l'oisiveté portent à embrasser la profession religieuse : on peut donc aisément se faire une idée de l'état de turpitude et d'ignorance où croupissent ces grossiers et égoïstes kaloyers. Étrangers à toutes les connaissances, hors celle de leur rituel, leur occupation principale est de parcourir les campagnes, et d'y tirer le meilleur parti possible de la considération que leur accorde le peuple, pour augmenter leurs revenus, qui suffiraient seuls pour nourrir tous les malheureux de l'île de Candie.
Les couvents de la Sainte-Trinité, de Saint-Jean de Governetto, de Gonia et de Chrysopû, sont les plus considérables du territoire de la Canée : le second passe pour le plus riche en biens-fonds ; mais le premier est le plus vaste de tous, et le plus agréable par sa position.
Les Vénitiens occupaient encore l'île de Candie, lorsque deux saints personnages le fondèrent, il y a près de cent quatre-vingts ans. Une double inscription en grec et en latin, gravée sur la façade de l'église, rappelle à la postérité leurs noms et leur munificence; et les kaloyers, par respect pour leur mémoire, célèbrent un service annuel en leur honneur, le lendemain de la Sainte-Trinité.
Cette dernière fête donne lieu à ce que les Grecs appellent un panaghiri. C'est une espèce de foire où se rendent presque tous les habitants de la ville et des campagnes.
Pendant la liturgie, on apporte, au milieu de l'église, de grands plateaux chargés de pain, de col/yva, de fruits, de poissons secs et de flacons devin. l'igouménos, ou supérieur, les bénit, et les distribue aux pauvres, après avoir réservé la part des défunts, qu'on transporte en grande pompe au réfectoire. Les religieux en font leur déjeuner, et ils n'oublient jamais à cette occasion de boire largement au salut et au repos des âmes de leurs pieux fondateurs.
Le reste de la journée est consacré à la danse et aux plaisirs de la bonne chère.
L'église de la Sainte-Trinité (Agia-Triada) est bâtie au milieu d'une belle cour, ombragée de mûriers et entourée d'un double étage de cellules habitées par les kaloyers. L'architecture de ce monument est simple et élégante ; on regrette seulement de le voir encore imparfait. L'invasion subite de l'île de Candie, par les Turcs, ne permit point de terminer la façade ni le dôme du sanctuaire; et ce dernier n'est recouvert que d'un simple toit debois. On y remarque un lustre de bronze d'une énorme dimension, orné d'aigles à deux têtes, et de divers attributs de la maison d'Autriche : c'est, dit-on, l'offrande d'un consul d'Autriche, originaire des États vénitiens. Les portes qui séparent [397] l'église du vestibule sont décorées, dans toute leur hauteur, de figures de saints, sans proportions, et dont la vivacité du coloris fait le seul mérite. L'église est bien éclairée, tenue avec beaucoup de propreté; mais elle est trop étroite pour sa profondeur. Le pourtour de la nef et celui du chœur sont garnis de stalles en bois dé noyer, réservées aux papas et aux archontes. Les hommes se placent au milieu du temple, et les femmes sous le péristyle.
La cloison « qui sépare le sanctuaire des assistants est richement dorée, et couverte d'une multitude de tableaux et de mauvaises peintures qui représentent le paradis, l'enfer, et les saints les plus vénérés ; tous sont chargés d' ex-voto, et les fidèles s'empressent de venir les baiser dévotement avant et après le service divin.
Au fond de la cour, à droite, on fait voir aux étrangers une salle où sont déposés les ossements des fondateurs de ce monastère, et ceux des kaloyers qui y finissent leurs jours.
Ces religieux ne vivent point en communauté, comme ceux de l'Église latine : ils ne se réunissent, au réfectoire, que deux ou trois fois dans l'année, à certaines fêtes solennelles. Chacun fait son ménage séparé, cultive son terrain, et peut s'absenter quand il lui plaît : la seule formalité qu'il ait à remplir est d'en donner avis à son supérieur.
Vu d'une certaine distance, le couvent de la Sainte-Trinité ressemble à une petite forteresse. Environné de hautes murailles, et situé au milieu d'un bois d'oliviers, il semble commander à toutes les campagnes environnantes qui font partie de ses domaines.
Le couvent de Saint- Jean de Governetto, bâti au milieu des roches inac cessibles du cap Mélek, est beaucoup moins considérable, mais plus riche encore que le précédent : on y jouit de la vue magnifique de la pleine mer et de plusieurs îles de l'Archipel. Une caverne, que les religieux appellent la grotte de Saint-Jean, est la seule curiosité qu'on y montre aux étrangers.
Le gouvernement turc ne permettant point aux Grecs de réparer leurs églises sans un firman ad hoc qu'on leur vend toujours fort cher, les ka loyers du couvent de Gonia, protégés pour leur argent par un riche et puissant aga de la Canée, s'avisèrent depuis quelque temps d'un singulier stratagème pour élargir la nef de leur église : ils demandèrent et obtinrent la per mission de bâtir, de chaque côté de celle-ci, deux grands magasins à paille. Lorsque ces deux prétendus magasins furent suffisamment élevés pour couvrir entièrement les murailles de l'église, ils abattirent intérieurement ces dernières, et leur temple se trouva parce moyen élargi des deux tiers : tous les fidèles s'empressèrent à l'envi de concourir à cette pieuse fraude, et, par [398] le fait, elle ne coûta aucune dépense aux religieux, qui retirèrent des donations du peuple bien au delà des sommes déboursées pour se rendre favorable l'aga leur protecteur.
1. Dans toutes les églises grecques, une semblable cloison dérobe au peuple la vue de l'au tel et celle du célébrant. Ce dernier ne parait qu'au moment de l'élévation, et fait processionnellement le tour du temple, suivi de plusieurs acolytes qui portent des images. Les portes du sanctuaire se referment aussitôt que le calice est replacé sur l'autel.
Les autres monastères des environs de la Canée ne méritent point de mention particulière.
L'île de Candie renferme deux couvents de kalogra, ou religieuses grecques : ces maisons se nomment kalogrado. La première est voisine de la capitale, et la seconde à une lieue de la Canée, à Acrotizi. Je visitai plus d'une fois cette dernière, dont la distribution est la môme que celle des couvents d'hommes. Quant au régime, il y a peu de différence : chaque religieuse travaille pour son propre compte, et vit à sa manière ; elles ont toutes une cellule et un petit jardin, où l'on est admis sans difficulté.
Excepté le logement de l'abbesse (igouménissa), et ceux de deux ou trois religieuses qui jouissent de quelque aisance, tout annonce la plus grande mi sère dans ce couvent. Ces sortes d'établissements n'ont point, comme en Europe, de dotations, ni de fonds affectés à leur entretien : ce sont des maisons de retraite, dont chaque habitante tire sa subsistance du travail de ses mains.
Les religieuses de kalogrado font des bas et des bonnets de coton, et leur habitude est de rançonner les étrangers qui s'adressent à elles. Leur cos tume consiste dans une robe de grosse serge noire, avec un voile de mousse line de la même couleur; elles peuvent sortir librement pour vaquer à leurs affaires, et porter leurs ouvrages à la ville : elles doivent seulement prévenir l’igouménissa.
Cette abbesse est renouvelée tous les ans ; on la choisit ordinairement parmi les plus anciennes religieuses de la maison.
Le noviciat dure une année ; à l'expiration de ce terme, les aspirantes font publiquement profession entre les mains de l'évêque du diocèse, qui vient officier en personne le jour de la Saint-Jean, patron du monastère.
L'église est desservie par un papas logé dans une petite maison voisine du couvent : à la propreté et à la recherche de tous les ornements on s'aperçoit, au premier coup d'œil, qu'elle appartient à des religieuses.
Les campagnes de l'île de Candie sont couvertes de petites chapelles ; mais on ne voit dans l'intérieur des villes qu'un petit nombre d'églises : la Canée n'en a qu'une seule.
Le clergé séculier, répandu dans les campagnes, est généralement aussi pauvre que le clergé régulier est opulent : un curé de village n'a pour vivre que son faible casuel, et le mince produit de la charité des fidèles ; à moins qu'il n'augmente son revenu, comme c'est l'usage, par son travail et son industrie.
Ces curés peuvent se marier avant d'entrer dans les ordres ; mais s'ils deviennent veufs après avoir reçu la prêtrise, il leur est interdit de prendre une seconde femme, à moins de renoncer à la liturgie et à la confession : [399] ils ne conservent plus, dans ce cas, que la faculté de bénir les maisons, le premier jour de chaque mois.
Le clergé séculier ne peut parvenir ni à l'épiscopat, ni aux premières dignités de l'Église, toutes exclusivement réservées aux kaloyers. Le costume des deux ordres ne diffère que par la coiffure, qui, pour les premiers, est une toque ronde, évasée par le haut; et pour les derniers, une simple calotte de drap noir ou bleu.
Je ne crois pas qu'il existe au monde de nation plus superstitieuse que les Grecs; il n'en est cependant pas qui soit moins pénétrée des véritables devoirs de la religion : des signes de croix sans nombre, des métagnais ou salutations aux images, la rigide observance des jeûnes et des carêmes, suffisent à leurs yeux pour satisfaire la Divinité. Quant à la probité et à la bonne foi, elles ne sont chez eux que de vains mots. Le confesseur grec donne l'absolution à un voleur, à un assassin ; jamais à l'infracteur des lois sévères du tessaracosti. Leur pratique tient lieu de toutes les vertus. Leur négligence, fût-elle involontaire, est le plus irrémissible des péchés, le plus impardonnable des crimes.
L'existence d'un peuple soumis à quatre différents carêmes dans le cours de l'année paraîtra difficile à concevoir dans un pays aussi dépourvu de végétaux que l'île de Candie. Le premier, celui de Pâques, dure quarante-huit jours; celui des apôtres, douze jours; celui de la Vierge ou de la Panagia, quinze jours; et enfin celui qui précède les fêtes de Noël en dure quarante. En y joignant les mercredis et les vendredis de toutes les semaines, les vigiles et les jeûnes extraordinaires, les vœux particuliers, etc., le nombre des jours où il est permis de faire gras se trouvera réduit à moins de cent cinquante.
La dernière semaine du carnaval est consacrée, chez les Grecs, à se préparer au grand carême. Durant cette huitaine, nommée par eux thirini, on cesse de faire usage de viandes, et l'on ne se nourrit plus que de poisson, d'œufs et de laitage.
Des légumes, du riz, et des herbages cuits à l'eau, composent toute leur nourriture dans ces temps de pénitence; le beurre, l'huile et le laitage même leur sont alors expressément interdits. La vieillesse, ni l'état de maladie, ne sauraient dispenser personne d'une aussi rigoureuse abstinence.
Les fêtes ne sont pas moins nombreuses que les jeûnes : on peut, sans risquer de faire un faux calcul, porter à quarante-cinq ou cinquante par an, non compris les dimanches, les jours où le travail est défendu par l'Église grecque. A la Canée, les fêtes de Pâques, seules, durent une semaine entière.
Si on ajoute à ce nombre les fêtes de famille, telles que fiançailles, mariages, baptêmes et autres, on verra que les Grecs se reposent et se divertissent plus du tiers de l'année.
Le baptême se fait par immersion, comme dans les premiers siècles de [400] l'Église. Après les cérémonies préalables, le prêtre plonge trois fois le nouveau-né dans un vase rempli d'eau tiède, mêlée d'huile bénite et de quelques grains de sel ; le parrain ou la marraine distribuent ensuite à tous les assistants des paras neufs, ornés de petits rubans rouges ; et la fête finit par un long repas, auquel ne préside pas toujours la sobriété. Les Grecs sont tellement persuadés de l'insuffisance du baptême par aspersion, que lorsqu'un catholique embrasse leur religion, il est obligé de se faire baptiser une seconde fois à leur manière.
J'ai parlé plus haut d'un hôpital entretenu par la communauté grecque de la Canée : il est nécessaire de donner quelques éclaircissements sur cet article, afin qu'on ne confonde pas cet asile avec les établissements du même nom que nous avons en Europe.
L'hôpital de la Canée est situé dans le quartier de l'évêché, et à peu de distance de l'église. Une seule pièce au rez-de-chaussée sert à la fois de chambre à coucher, de cuisine et de magasin ; chaque malade doit y apporter son linge et son matelas. Ces malheureux, entassés pêle-mêle sur une petite estrade qui peut à peine contenir trois lits, sont servis par une vieille femme qui reçoit les ordres d'un Grec, revêtu du titre pompeux d'intendant de l'hôpital. Les indigents, hors d'état de payer les remèdes et les visites du médecin, soit qu'ils meurent ou qu'ils sortent guéris de ce lieu de douleur, sont soignés aux frais de la communauté; ceux au contraire qui possèdent encore quelque chose au monde doivent, en sortant morts ou vifs, payer les drogues et le docteur, et faire un présent à la gardienne et à l'intendant, qui n'ont d'autres revenus que ce faible casuel. On voit que cet établissement n'exige pas de grandes dépenses de la part de la ville.
Paysans, agriculture, climat, productions et commerce.
La plus misérable des conditions est, sans contredit, celle des paysans grecs de l'île de Candie. Ne possédant, pour ainsi dire, rien en propre, soumis à tous les caprices de leurs agas ou seigneurs, à la brutalité de leurs soubachi i, et à des corvées pénibles et journalières, qui, jointes au nombre prodigieux de fêtes dont nous avons parlé, réduisent à peu de chose leurs moyens d'existence : tel est le sort de ces malheureux, qu'on peut, sous quelques rapports, comparer aux serfs de la Pologne et de la Russie. Au premier appel de \'aga, qui veut réparer sa maison ou en bâtir une nouvelle, ses vassaux doivent abandonner leur travail, pour fournir, transporter et mettre en œuvre, à leurs frais, tous les matériaux nécessaires. La récolte d'un autre est-elle terminée? les habitants de son village sont forcés de la lui acheter sans délai, au prix qu'il lui convient d'établir.
1. Les sou-bachi sont, dans les villages de l'Ile de Candie, les intendants des seigneurs, qui viennent y passer la belle saison. Leur charge a quelque analogie avec celle des anciens baillis de nos campagnes; mais leur autorité est en même temps civile et militaire. Il ne faut pas les confondre avec les officiers du même nom, chargés du maintien de la police dans plusieurs villes de l'empire ottoman.
Le moindre murmure, [401] la moindre résistance à des ordres aussi arbitraires coûtent à ces infortunés d'horribles avanies, une cruelle bastonnade, et quelquefois même la vie, sans qu'il y ait pour eux aucun recours contre une aussi odieuse oppression. Un esclave arabe se querellait un jour avec un paysan grec ; ce dernier, dans sa colère, ayant traité le nègre d'esclave : « Je suis, répondit-il, l'esclave d'un seul maître; et toi, tu es celui de tous les musulmans. » Cette réponse suffirait seule pour donner la mesure de l'affreuse servitude où gémit cette partie de la population.
Malgré la terreur continuelle que lui inspire le barbare sou-bachi, toujours armé de pistolets et de poignards, le paysan candiote est l'homme du monde le plus insouciant et le plus gai. S'il peut, huit jours de suite, travailler librement pour son compte, il revient joyeusement à son village, boire et manger, dans un dimanche, le fruit d'une semaine entière de peines et de fatigues; il oublie pour un moment, au sein de sa famille et de ses amis, tout ce qu'il a souffert la veille; il cherche à s'étourdir sur ce qu'il doit souffrir le lendemain. Mais les vapeurs du vin sont-elles dissipées? il sent plus que jamais tout le poids de sa chaîne : son bonheur n'est plus qu'un songe, et son réveil est toujours celui du malheureux.
L'état languissant de l'agriculture dans l'île de Candie est la conséquence naturelle de l'oppression du cultivateur. Partout où, privé de sa liberté, et sous la dépendance d'un maître ardent à spéculer sur sa sueur et sur son existence, l'habitant de la campagne est incertain de recueillir le fruit de ses travaux, il est sans vigueur, et pressé de jouir, et plus porté à l'ivrognerie et à tous les vices qu'au travail et à l'industrie. Toujours en proie aux alarmes, le paysan candiote ne sème que la quantité d'orge nécessaire à sa consommation, et cueille ses fruits encore verts, dans la crainte qu'un moment plus tard, un autre ne vienne les lui arracher.
La population de l'île de Candie ne s'élève pas aujourd'hui à plus de trois cent mille âmes (1). Sa longueur est d'environ quatre-vingt-dix lieues, de l'est à l'ouest, et sa plus grande largeur, de quinze lieues, du nord au sud. A raison des sinuosités de la côte, on peut estimer son circuit à près de deux cent cinquante lieues.
Le climat est sain et agréable; jamais on n'y ressent les rigueurs de l'hiver, et les vents du nord y viennent régulièrement tempérer les chaleurs de l'été.
Peu de maladies affligent cette belle contrée ; la lèpre seule paraît s'être spécialement attachée à une classe indigente et peu nombreuse, chez laquelle l'insouciance du gouvernement la laisse se propager sur des générations entières. Un moyen bien siroble suffirait cependant pour en arrêter les progrès : en interdisant les mariages et toute communication entre les lépreux, on parviendrait peut-être à extirper le germe de cette affreuse maladie, qui de puis longtemps semble concentrée dans les mêmes familles.
1. Environ 150 030 Turcs, 150 000 Grecs, et 4 ou 500 Juifs.
[402]
Quelquefois aussi la peste y vient exercer ses ravages. Celle de Constantinople s'y naturalise difficilement. La plus dangereuse est celle qu'on lui apporte de l'Égypte.
Productions. — Le sol de Candie est généralement aride et montagneux; mais dans les plaines et dans les vallées la terre est excellente, et prodiguerait toutes ses richesses aune nation plus industrieuse. Les myrtes, le laurier-rose, le thym et le serpolet croissent naturellement au milieu de ses rochers ; parmi les herbes aromatiques, on distingue le ladanum et le dictame.
Le premier est une gomme visqueuse, produite par la rosée, qui s'attache aux branches et à la tige d'un petit rosier sauvage ; on le recueille au printemps avec des fouets, dont Tournefort a donné la description.
Le dyctame ne se trouve que dans l'île de Candie. C'est une plante cotonneuse et blanchâtre, dont l'infusion est stomachique et agréable au goût. Elle est excellente dans les indigestions, et bien préférable au thé, en ce qu'elle n'irrite point les nerfs et ne fatigue point l'estomac. Le dyctame de Crète était un remède universel chez les anciens Grecs, qui le croyaient propre à toutes les maladies.
L'île de Candie réunit presque toutes les productions des pays froids et celles des pays chauds : les unes viennent dans les plaines, et les autres sur les montagnes. Les pommes, les châtaignes, les poires, les cerises et tous les fruits y sont, comme les végétaux, d'une qualité médiocre; mais on doit excepter de cette règle générale des melons délicieux, des oranges, des citrons et des cédrats, qui l'emportent sur ceux même de Scio. La chasse et la pêche y sont des plus abondantes. Ses marchés sont remplis de toutes sortes de gibiers, tels que lièvres, perdrix, bécasses, bec-figues et tourterelles sauvages, qui s'y vendent au plus bas prix ; le poisson y est seul fort cher, vu les taxes énormes dont il est imposé.
Si elle recevait toute la culture dont elle est susceptible, cette île pourrait suffire elle-même à la subsistance de sa population actuelle. Elle y suffirait pendant plus de la moitié de l'année, si elle était aussi peuplée que le comporte l'étendue de son territoire : dans son état actuel, à peine peut-elle nourrir ses habitants pendant quatre mois. Le meilleur blé du pays, celui de Messara, plaine voisine de la ville de Candie, est toujours accaparé par des pachas avides qui le vendent aux Anglais, aux mépris des défenses réitérées de la Porte, et au détriment de leurs administrés, obligés d'acheter à grands frais, de l'étranger, cette denrée de première nécessité, que leur fournirait abondamment leur sol, s'il était en de meilleures mains.
La seule richesse de Candie consiste dans ses oliviers, qui, cultivés avec plus de soins, rapporteraient à leurs propriétaires un profit double de celui qu'ils en retirent: toute son industrie se réduit à la fabrication du savon.
La récolte des olives commence au mois de novembre, et ne finit qu'au [403] mois de mars. On emploie à ce pénible travail de pauvres paysans des deux sexes, dont le salaire est un mistache (1) d'huile sur cinquante.
Les olives sont ramassées au pied de l'arbre, à mesure que leur maturité les fait tomber d'elles-mêmes. Transportées au moulin, on les broie sous des meules de pierre ou de marbre : et lorsqu'elles ont subi cette première opération, on les réunit en gâteaux ronds et épais de trois ou quatre pouces, qu'on enveloppe d'un léger tissu de joncs ; c'est dans cet état qu'elles sont mises au pressoir. L'huile coule par une rigole dans plusieurs bassins, d'où elle est bientôt retirée pour passer dans des jarres de terre, ou dans des outres de peau de chèvre. Cette première huile s'appelle en grec agouro-lado, ou huile vierge : c'est la plus délicate et la plus chère.
Ces mêmes gâteaux, et les noyaux eux-mêmes, sont une seconde fois broyés sous la meule; on remet enfin le tout au pressoir, jusqu'à ce qu'il n'en sorte plus aucune liqueur. L'huile qu'on obtient dans cette dernière opération est de beaucoup inférieure à la première : les pauvres sont les seuls qui en fassent usage pour assaisonner leurs aliments. On la réserve en général pour les lampes et pour les fabriques de savon.
L'huile d'olive est ici un article de première nécessité. Elle remplace le beurre, dans la cuisine des Turcs et des Grecs ; elle tient lieu de chandelle et de bougie pour l'éclairage de leurs maisons. Le renchérissement de cette denrée occasionne souvent des émeutes populaires : le peuple se presse alors autour du palais du pacha, et ne désempare que lorsque ce gouverneur en a fait diminuer le prix. Il existe aujourd'hui une nouvelle taxe en faveur des pauvres, à laquelle sont sujets tous les navires étrangers qui chargent de l'huile d'olive dans le port de la Canée.
On peut attribuer la hausse des huiles à trois causes : aux mauvaises récoltes, aux trop fortes exportations, et aux accaparements des fabricants de savon.
On compte au moins quarante-cinq savonneries dans l'île de Candie. Les Turcs doivent, dit-on, la connaissance de cette précieuse branche d'industrie à un Marseillais que des malheurs forcèrent, il y a près d'un siècle, a s'établir dans cette contrée.
Les savons de Candie sont généralement préférés à ceux de la Canée. Les fabricants dela première de ces deux villes ne permettent point l'exportation de leurs huiles, et n'emploient que X agouro-lado (l'huile vierge), que les Provençaux désignent sous le nom de lampante. Ceux de la Canée, au contraire, plus avides et plus empressés de vendre leurs produits, y mélangent toujours la liqueur grossière qui provient du noyau de l'olive; du choix et de la bonne qualité de la soude, dépend aussi celle du savon. Les soudes d'Espagne et de la Sicile sont réputées les meilleures; celles de la Barbarie sont d'une mauvaise qualité.
1. Le mistache, est la mesure des liquides, eu usage à la Canée.
Plusieurs vins de l'île de Crète ne seraient pas indignes de figurer dans les [404] caves de dos gourmets. Les meilleurs sont celui du mout Ida, dont le goût approche du Madère, et une Malvoisie du môme territoire, dont la saveur se rait comparable à celle du Malaga, sans les ingrédients que les vignerons grecs ont l'habitude d'y faire entrer. Il ne manquerait à ces vins, pour les rendre égaux et peut-être supérieurs à ceux de l'Europe, que de meilleurs procédés dans la fabrication, et moins de friponnerie de la part des fabricants. On trouve des vins exquis dans plusieurs monastères; mais les religieux assurent qu'ils ne sont pas de nature à se conserver, ni à supporter le trajet de la mer.
La province de Sélino et le village de Galata produisent également avec abondance plusieurs vins de table, qui ne le cèdent en rien à ceux des Dardanelles et de Rhodosio, exclusivement estimés à Constantinople; mais rien n'est plus détestable que la boisson qui se débite dans les tavernes ou cabarets. C'est pourtant la seule de la plupart des Grecs, qui, pour répéter ce que j'ai dit à l'article de leur carnaval, savent sur ce point se dédommager de la qualité par la quantité.
Commerce. — En temps de paix, la Fiance retire de l'île de Candie, en échange des draps du Languedoc, des quincailleries, merceries, et autres denrées de son sol et de ses manufactures, une quantité- considérable d'huile d'olive, qui sert à alimenter les savonneries de Marseille; mais, dans ce dernier port, l'importation des savons fabriqués est souvent défendue, ou du moins soumise au droit excessif de vingt pour cent. Dans le court espace de temps qu'elle y fut librement permise, on assure qu'on trouvait en France un bénéfice de cinquante pour cent en remettant à la chaudière les savons de Candie, dont le défaut principal est d'être trop gras et trop huileux.
Avant la dernière guerre maritime, cette île faisait avec les Français tout son commerce d'importations et d'exportations. A peine y voyait-on, dans le cours de l'année, une vingtaine de navires de Trieste ou de Venise, tandis que, dans le même espace de temps, plus de cinquante ou soixante bâtiments sortis de nos ports ne cessaient d'aborder dans celui de la Canée. Le pavillon anglais y était à peine connu, et la place de Marseille avait pour ce riche commerce jusqu'à six établissements dans cette ville, sans compter des facteurs à Candie et à Rétimo.
Pendant plus de vingt ans qu'a duré cette guerre, et surtout depuis qu'ils sont maîtres de Malte, les Anglais se sont exclusivement emparés de ce Commerce, les établissements français ont disparu, et Candie a cessé d'avoir des relations avec la France. Mais quelques années de paix suffiront peut- être pour rétablir les choses dans leur état primitif; et les Anglais cesseront tôt ou tard d'être pour nous des concurrents dangereux, malgré l'engouement général des Levantins pour leurs produits. Cet engouement a déjà considérablement diminué, et se détruira bientôt de lui-même, s'ils continuent à n'ap porter en Turquie que des rebuts de manufactures, qui s'y vendent à des prix [405] excessifs, comparativement aux produits de l'industrie française, qu'on y trouvait de meilleure qualité et à meilleur marché.
Dans les cinq années qui viennent de s'écouler, Malte retirait de l'île de Candie une prodigieuse quantité de savons fabriqués, dont elle trouvait difficilement à se défaire : la cessation des hostilités a depuis ralenti ce genre de spéculation, qui doit désormais se diriger vers la France, et tourner au profit des manufactures de Marseille. La Sicile, de son côté, n'exporte annuelle ment de la Canée que deux ou trois chargements de savons, qu'elle échange, par le moyen des navires ottomans, contre ses soudes, qui y sont fort recherchées. Le surplus se consomme dans l'île même, ou se transporte à Constantinople, à Smyrne, à Salonique, en Egypte, et dans toutes les échelles du Levant. Je n'ai vu pendant mon séjour en Candie que trois navires anglais y charger directement pour l'Angleterre : tous les autres bâtiments, quoique sous le pavillon de cette puissance, n'étaient que des maltais, des esclavons et des ragusais, destinés pour Malte et pour des ports de la Méditerranée.
Colonie européenne de la Canée. — Hadji-Turk-Osman-Pacha, gouverneur de cette ville, et sérasker de toute l'île de Candie.
La France entretient un consul à la Canée et un vice-consul a Candie. L'Angleterre et l'Autriche se font représenter dans la première ville par des vice-consuls ; et la Russie, quoiqu'elle ait fait depuis longtemps sa paix avec la Porte Ottomane, n'y avait pas encore d'agent commercial à la fin de 1814.
Le consul de France jouit seul de la prérogative d'arborer sur sa maison le drapeau de sa nation. Tous les efforts des autres consuls pour obtenir le même avantage ont été, jusqu'à ce jour, inutiles et sans effet.
La colonie européenne de la Canée se réduisait, à l'époque citée plus haut, à trois facteurs de différentes maisons de commerce de Marseille. Un religieux romain dessert leur petite chapelle, qui est sous la protection de la France.
Le voyageur, conduit à la Canée par ses affaires ou par la curiosité de voir un beau pays, y trouvera peu de ressources et d'agréments, sous le rapport de la société; mais il y jouira du moins de la tranquillité la plus parfaite, et de la sûreté de sa personne et de ses biens : c'est à Osman-Pacha qu'il sera redevable de ce dernier avantage.
Hadji-Turk-Osman-Pacha, tombé depuis quelques années dans la dis grâce du Grand Seigneur, avait servi dans la dernière guerre contre les Rus ses, et siégé à Constantinople dans le divan. Dépouillé de tous ses biens, et relégué dans un village du golfe de Salonique, il y paraissait condamné à un éternel oubli, lorsque le sultan, alarmé des progrès de l'insurrection qui se manifestait de toutes parts dans l'île de Candie, fit choix de ce gouverneur, pour ramener à la soumission une province qui déjà marchait à grands pas vers l'indépendance. Hadji-Turk-Osman-Pacha reçut dans sa retraite la nouvelle que le souverain lui rendait ses bonnes grâces, et le nommait au pachalik de la Canée : il arriva à la Sude au mois de septembre 1812, sur une corvette de guerre du Grand Seigneur.
[406]
Sa tâche était difficile à remplir: son prédécesseur y avait échoué. Il fallait lutter contre l'esprit d'insubordination qui avait gagné et gagnait journellement toutes les classes. Il commença cependant son ouvrage sous les plus heureux auspices. Sa conduite, d'abord juste et pleine de fermeté, lui attira bientôt l'estime générale : les méchants tremblèrent, et les gens de bien conçurent l'espoir d'un plus heureux avenir.
Osman fit à son arrivée rechercher tous les assassins qui depuis quelques années infestaient la ville et son territoire. Plus de soixante tombèrent sous son glaive exterminateur; un plus grand nombre parvint à se soustraire par la fuite à son inexorable justice. Dans l'espace de trois mois, il rétablit enfin la tranquillité et le pouvoir des lois dans un pays qui semblait ne plus en reconnaître d'autres que celui des chefs de parti qui le déchiraient.
Pendant l'hiver de la même année, un des riches feudataires de l'île, vieillard plus qu'octogénaire, nommé Jénitchéraki, ayant fait évader son fils, accusé d'assassinat et de rébellion, le pacha ordonne qu'on s'assure de la personne du père. Ce malheureux, n'écoutant que son désespoir, se renferme dans son château avec tous ceux de ses paysans qu'il peut rassembler, parvient à se procurer des armes et des munitions, et se déclare en révolte ouverte contre le gouverneur.
Osman-Pacha, éprouvant pour la première fois de la résistance, sort sans délai de la Canée avec deux pièces d'artillerie et quelques centaines de soldats, et vient en personne attaquer Jénitchéraki jusque dans sa retraite. Pressé de tous côtés, le vieillard ne tarde pas à tomber entre les mains de son ennemi : son château est rasé, et lui-même, ignominieusement conduit à la ville, est étranglé dans le Sou-Koulé, sans la moindre forme de procès.
La terreur et l'épouvante se répandaient de toutes parts. Les crimes les pJus anciens, ceux qu'on croyait oubliés, étaient recherchés et punis immédiatement avec la même sévérité que les plus récents; et les coffres du pacha se remplissaient des dépouilles de toutes ses victimes.
Cependant Osman faisait bâtir à ses frais un nouveau bain dans la ville, et faisait réparer le fanal et la muraille de clôture du port.
Une conduite aussi énergique que soutenue, dans une île que le sultan regardait déjà comme perdue pour sa couronne, lui valut bientôt une nouvelle marque de la bieuveillance de ce monarque, qui joignit à son gouvernement celui de Rétimo, dont le pacha fut envoyé dans une autre province.
A dater de cette époque, il fut permis de pénétrer les vues secrètes d'Osman-Pacha. L'avidité et l'envie de s'enrichir promptement remplacèrent tout à coup chez lui la justice et la droiture, et il oublia bientôt les intérêts de son maître, pour ne plus penser qu'aux siens propres.
Jusqu'alors il avait négligé de punir les grands criminels. Les plus riches propriétaires de la Canée, presque tous compromis par d'anciens délits, et plus coupables encore que ceux dont le pacha venait de faire des exemples [407] si éclatants, parvinrent à racheter leur vie et leurs fortunes par des sacrifices d'argent considérables. Les moins opulents tombèrent sous ses coups. Lors qu'il n'eut plus rien à prendre aux grands, il commença a ruiner, par des avanies, la classe indigente et tranquille.
Le plus léger prétexte suffisait pour être dépouillé et mis à mort. Deux malheureux Grecs s'étant enivrés un jour de fête, et l'un d'eux ayant tiré, dans l'intérieur de sa maison, un coup de pistolet chargé à poudre, il eut la barbarie de les faire pendre le lendemain à la porte de la ville, le premier avec sa lyre, et le second avec un pistolet attaché à son cou.
Mais voici l'affaire qui lui fit le plus de tort dans l'esprit des musulmans :
Hadji-Emin-Effendi, ouléma ou homme de loi d'un âge très avancé, aussi riche qu'avare et opiniâtre, refusait constamment d'offrir au pacha le présent que lui font, au sujet de sa bienvenue, les principaux habitants de la ville qui ne veulent pas être inquiétés : sa famille l'avait plus d'une fois conjuré de prévenir, par un don quelconque, le fâcheux éclat que produirait tôt ou tard une plus longue résistance.
Hadji-Emin-Effendi se refusa aux plus pressantes sollicitations ; il disait ouvertement qu'en sa qualité d'ouléma, il n'avait rien à redouter du pacha, qui se garderait bien d'attenter à sa vie ou de toucher à ses biens (1). La suite ne tarda pas à lui prouver toute la fausseté de son calcul, et combien il était dangereux de heurter de front un homme aussi vindicatif qu'Osman.
Le pacha le dénonça bientôt au Grand Seigneur, comme un des principaux instigateurs des troubles qui avaient existé à la Canée, et comme ayant na guère recélé dans sa maison un des assassins qui désolaient la ville. Ce vieil lard fut, un matin, enlevé au milieu de sa famille, et embarqué sur un na vire qui le transporta à Constantinople ; les scellés furent mis sur ses biens ; et, à son arrivée dans la capitale, il fut jeté dans les prisons du bostandji-bachi, sans que depuis on ait eu de ses nouvelles.
Le Grand Seigneur nomma peu de temps après Osman sérasker ou gouverneur général de tout le royaume de Candie ; et ce pacha se mit immédiate ment en marche pour aller établir sa résidence dans le chef-lieu de File.
Arrivé à Rétimo, il apprit que les habitants de Candie, informés des vexations qu'il ne cessait d'exercer dans ses deux pachaliks, refusaient ouverte ment de le recevoir. Grande fureur de la part d'Osman-Pacha; sommations sur sommations à cette ville de se ranger à l'obéissance, si elle ne veut éprouver tout le poids de sa colère. Pour toute réponse, ses envoyés sont honteusement chassés; et on leur fait même des menaces de leur ôter la vie, s'ils osent reparaître.
1. Les oulémas, ou hommes de loi, ne peuvent être ni mis à mort, ni dépouillés judiciairement de leurs biens : on voit cependant, par l'exemple de Hadji-Emin-Effendi, qu'ils ne sont pas plus que les autres musulmans à l'abri des vengeances particulières.
C'est de la classe des oulémas qu'on tire les imams, ou prédicateurs des mosquées ; les muphtis, les cadis, etc., etc.
Osman prend alors le parti d'expédier un de ses officiers à [408] Constantinople, et d'attendre à Rétimo de nouveaux ordres du Grand Seigneur, et un renfort de soldats.
Ce retard devint une véritable calamité pour les habitants de cette dernière ville, aux frais de laquelle il se fit bâtir un palais, et qui furent bientôt, comme ceux de la Canée, réduits à la dernière extrémité par ses nombreuses exactions.
Plusieurs firmans du Grand Seigneur arrivèrent coup sur coup à Candie. Le sultan menaçait chaque fois les Candiotes de toute sa vengeance, s'ils refusaient plus longtemps de recevoir au milieu d'eux le chef de son choix. L'exaspération était alors à son comble dans cette ville contre le pacha ; on y recevait journellement la nouvelle des tyrannies qu'il exerçait à Rétimo, et l'on y craignait d'autant plus pour soi-même. Les habitants de Candie protestèrent contre tous ces firmans, et déclarèrent qu'ils s'enseveliraient plutôt sous leurs ruines que d'obéir ; et le Grand Seigneur, soit crainte de compromettre plus longtemps son autorité, soit que les plaintes qui lui parvenaient de toutes les parties de l'île contre Osman lui eussent enfin ouvert les yeux, se vit dans la nécessité de céder, et de nommer un autre pacha à Candie.
Hadji-Turk-Osman-Pacha fut de nouveau réduit à ses deux gouvernements de la Canée et de Rétimo, qu'il possédait encore à la fin du mois de décembre 1814.
La Canée jouissait toujours à cette époque de la plus parfaite tranquillité. Puisse le repos de ce malheureux pays être de longue durée, et puisse le successeur d' Osman-Pacha lui ressembler par sa fermeté et son énergie, sans avoir son insatiable avidité !